Actualités




Vous pouvez commander mes livres en cliquant sur chaque titre :
Je participe à cette exposition à la Bibliothèque Universitaire de la Faculté de Lettres d’Aix en Provence.

Cette exposition vous amène à envisager le vécu de l’autisme de manière sensible et artistique.
Exposition du 19 mars au 4 avril 2026
Bibliothèque Universitaire des Fenouillères (au rez-de-chaussée).
167 Avenue Gaston Berger / Aix-en-Provence.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 10h à 17h.
Vernissage le jeudi 19 mars à 18h
L’entrée est gratuite mais l’accès à la BU est régulée dans le cadre du plan vigipirate. Si vous n’êtes ni étudiant-e, ni salarié-e d’AMU, il vous est demandé de prendre un ticket d’entrée à présenter au vigile.
Billet gratuit https://www.helloasso.com/associations/autiegirls/evenements/expo-de-l-autiste-a-l-artiste. Cette procédure est valable pour toute la durée de l’exposition.
Dans cette exposition collective, j’expose 3 encres et dorure sur papier encadrées avec un texte : “Je suis celui qui va”, “La fille bleue” et “Moi penchée”. Ce sont 3 voix intérieures, un fragment de la relation aux mondes : monde extérieur – monde intérieur. Une friction, un croisement : une rencontre et les traces qu’elle laisse. Des personnages en errance qui nous donnent le goût du monde.“Des nouvelles du monde”, c’est aussi un recueil de nouvelles dont sont extraits ces textes.
Je participe à la Journée de la Femme samedi 8 mars à Gardanne (13). L’aparté m’invite à lire des extraits de mes livres à 19h. Cette lecture sera suivie d’un échange avec le public.

J’ai écrit le texte « Vivre là » pour participer à la proposition de Pictur Music sur le thème de l’eau. J’ai lu mon texte en public à Rouge Belle de Mai à Marseille le 13 octobre 2023.
Vivre là
Eau, perdue à jamais.
Coulée sous la terre comme une boue. Mais non.
Eau pure sous les lianes du temps. Eau comme berceau. Eau comme nid. S’asseoir au bord des lacs. Tout dessous. Tout au fond. Attendre la nuit, le jour. Dormir là. Sous les choses et les miracles. Sous les poussières déposées par le printemps. S’asseoir dormir. S’ensevelir de mousse rivière au fond des lacs ou des étangs. Étendre. Se mettre debout, sous l’eau, là où l’on vit sa vie de nénuphar. Là où pleurer ressemble à une pluie. Rassemble. Semble autre chose encore autre. Dans le marécage des nuits. Dans le sable mouvant émouvant des heures tendres. Vivre là. Dans l’haleine des coquillages éteints depuis longtemps. Vivre là. Dans les montagnes et les gouffres qui vivent aussi au cœur des lacs. S’arrondir comme les rochers, comme la main des ruisseaux passée là. Chevelure. Une joue, une bulle. Le scintillement éternel de ce qui chuchote à la surface. Là-haut où nous ne savons aller. Vivre là. Une brume promenée par la main. Les minutes bleues des orages éclairants. Berges, contours, amas de terre, de pierres, de pattes douces.
Vivre là, tout dessous. Où les animaux viennent boire. Museaux aux parfums d’été. Quand je tends la main de ma ville sous l’eau, je traverse un bleu sombre. Je ne sais pas arriver jusqu’à la bouche des hommes, jusqu’aux yeux des enfants. Je sais seulement tenir mes rues et écouter. Je sais seulement laper le temps. Ramener mes souvenirs de village enseveli, de choses abandonnées. Frapper à la porte d’une mémoire. Déglutir ma tristesse. Sous le lac endormi, mes fenêtres battent au gré des courants. Mes murs sont devenus des algues et des mousses, des herbes folles. Parfois le vent vient jusqu’à moi, jusqu’à une maison autrefois habitée, une école, une église. Rires oubliés. Les chansons qu’on chantait pour se donner du courage quand on rentrait avec la nuit. Chaque chose avait sa place.
Parfois, les cloches sonnent encore les messes abandonnées à l’oreille des vivants. Épousailles de roches et de fleurs d’eau.
Je suis un village enseveli. Des pierres qui dorment, des pierres qui chantent. Des maisons ouvertes aux poissons.
J’ai participé à l’exposition de Marina ÓÁZ à la Maison de l’Espagne à Aix en Provence en 2023 en écrivant des textes reliés à 3 oeuvres : Burka, #MEETOO et Paura. Voici les textes et les tableaux associés.

Burka

Tu sais, je te vois.
Il y a des lignes blanches dans ton regard. Comme les lignes entre deux routes qui ne vont pas au même endroit.
Tu sais, je te vois.
Je franchis cet espace de papier, ce craquement dans le dos ou dans la joue. Je franchis des grilles et des miracles. Je marche jusqu’à toi à l’intérieur de moi. Je vis à l’envers du monde. Dans l’invisible de l’angle mort. Je vis là, par intermittence. Je respire. À peine. Je patiente à l’ombre des cœurs tendus. Un craquement dans le dos ou dans la joue.
Tu sais, je te vois.
Il y a des larmes noires dans ton regard. Comme les larmes entre deux routes qui ne vivent pas au même endroit.
Tu sais, je te vois.
Un ciel cubique où se cogner parfois. Un soleil cabossé par la main des hommes. Ici, où je vis. Voir, ne pas voir, être vue. C’est comme un secret. Une cachette brindille où tenir sa langue serrée. Où coudre ses lèvres et son nombril.
Ici, où je vis. Une toile d’araignée tisse avec les dents une pelote emmêlée de lianes et de murmures.
Dans mon corps il y a une fenêtre. Des grincements de portes. Portières avec les doigts dedans. Des choses qui s’articulent. Charnières et verrous et clés.
Ici, où je vis. Il ne faut pas respirer trop fort sinon on pourrait mourir.
#MEETOO
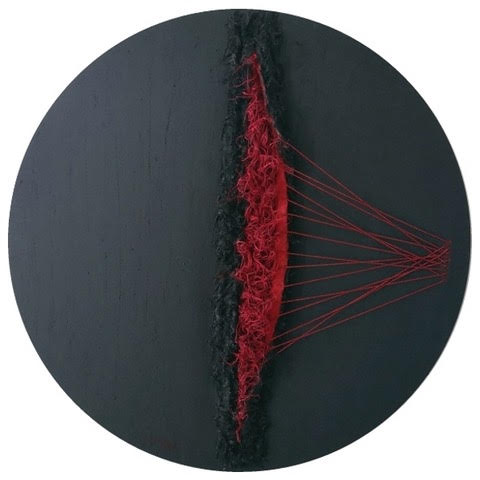
Effraction. Une fente, une déchirure. Chose cassée.
Du rouge dans nos yeux. Du rouge dans notre cœur corps meurtri. Rouge écarlate éclate et pisse son sang. Et coule. Et pleure. Se noie. Une rivière sang qui s’en va sans nous.
Il est arrivé quelque chose. C’était une langue ou des mains. Une surprise. C’était des mots. Des gens qui voulaient venir dedans nous sans permission. C’était un bras sur une épaule. Ce n’était pas le nôtre. Un regard qui pourfend. C’était un corps entier sur notre corps entier. C’était hier, demain, aujourd’hui. C’était croiser quelqu’un dans l’escalier. C’était une main sur notre main sur une poignée. Frôlements. Chuchotements. On pourrait nous entendre. On pourrait nous voir. Y a-t-il un secret à garder de la vérité de nous ?
C’était ce que nous ne voulions pas. Ce que nous n’avions pas déclenché. Une tempête ?
La présence, là, dans notre bouche. Quelqu’un en nous arrivé si vite. C’était non qui pensait être un oui.
Revoir le même, le même, le même. Entendre les pareils mots. Dépareillés.
Être réduite à une protubérance, un organe, un orgasme. Être réduite. Une chaire. Une bidoche. Mille morceaux qu’on ne sait rassembler. Nous rebricolerons nos lèvres une autre fois.
C’était se rétrécir pour échapper aux gestes, aux regards, aux paroles insistantes. Vouloir disparaître. Se soustraire. S’absenter. Ne pas trop exister. Devenir transparente. Rentrer dans un trou, un trou noir. Pour pas qu’on nous voie, pour pas qu’on s’approche encore trop près toujours tous les jours.
La salissure. Tu crois que ça se lave. Non, ça ne se lave pas. Tu es sale toute ta vie. Une trace sur ta peau. Un souvenir cauchemar. Une peur. Tu as changé. Tu ne sais plus. Es-tu autre chose que ce qu’ils veulent voir et toucher et baiser ? Parfois tu te frottes très fort avec une pierre. Tu t’arraches la peau. Faire partir ce qui est entré sans frapper. Parfois tu te frappes de ne pas avoir su dire plus tôt, dire plus fort, dire plus loin. Comment dire les mots propres ? Comment dire quelque chose qu’on ne sait pas dire ? Trou noir.
Parfois dormir ne revient plus.
Parfois aimer ne revient plus.
Paura

Ne sors pas.
Il fait nuit et il est tard. Reste à la maison. On ne sait jamais. Il fait nuit.
Ne passe pas par les rues qui sont mal éclairées.
Ne parle pas à un inconnu.
Ne t’habille pas trop court.
Ne mets pas de décolleté.
Mets plutôt tes basquettes. On ne sait jamais. Si tu as besoin de courir.
Ne marche pas dans les rues peu fréquentées.
Ne souris pas trop. On ne sait jamais.
Ne te maquille pas trop.
Ne reste pas seule dans la rue.
Ne t’habille pas trop en femme.
Ne regarde pas les gens dans les yeux.
Baisse la tête.
Ne sors pas.
Parce que la nuit pourrait rentrer en toi. Parce que des monstres rôdent, s’attaquent aux petites filles et aux grandes filles. Parce que des bêtes surgissent le soir pour te prendre, te voler, t’assassiner. Parce que quelqu’un croit que tu es faible et que ça sera facile.
Quelque chose glisse dans l’ombre. Un bruit de pas. Quelque chose arrive tout lentement. Tu le sens, tu frissonnes.
Tu te retournes. Il n’y a personne.
Quelque chose comme une main qui pourrait t’attraper. Quelque chose comme une voix. Les doigts de la peur. Elle n’a pas de forme ni de corps. Elle est là tous les jours, la peur. Une promesse de la rue ou des champs. Une mauvaise rencontre.
Tu te retournes. Il n’y a personne.


« C’est bientôt le printemps. Mais pas encore. C’est bientôt le doux, le foisonnant et le chant de rivière des oiseaux. Mais pas encore. C’est juste avant. C’est ce qui se prépare. Ce qui invisiblement éclot à l’ombre. C’est avant la lumière. Une robe posée sur une chaise. Une attente. C’est l’avant heure des collines où courir. Ce qui glisse sans bruit. Ce qui chuchote sous la pierre. C’est le moment où marcher dans l’entre deux. Le crépuscule des choses. Quand on devine ce qui se cache sous l’herbe. Quand pousse ce qui devient. Quand devient ce qui pousse. C’est bientôt le printemps. Mais pas encore. Allons marcher ! «
Venez participer à la rando-yoga du Voyage intérieur dimanche 27 février de 14h à 16h à Meyrargues.



Rendez-vous parking du cimetière (Avenue du Château) à Meyrargues à 14h
Adolescents-adultes à partir de 15 ans. Pas de niveau requis. Accompagnatrices : Rozenn Guilcher et Stéphanie Delion.
Réservations et informations :
Tenue confortable, chaussures de marche, bouteille d’eau. Amenez votre tapis de yoga si vous en avez un, sinon nous le signaler : nous vous en prêterons un. Annulé en cas de pluie
Une marche tranquille, des lectures de textes inspirants, une pause yoga, un moment de méditation, un espace de relaxation. Et puis nous reviendrons en marchant autrement, sereins, approfondis et légers.
Lors du récital « Seuls les arbres », je lirai mon texte « Devenir » en 1ère partie avec d’autres poètes invités. Toutes les informations sont ci-dessous.
Vendredi 28 janvier 2022 à la Cité de la Musique à Marseille
Auditorium de la Cité de la Musique -20H30
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette soirée poétique.
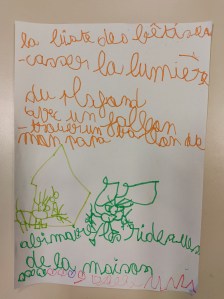
J’anime des ateliers d’écriture « Lire et écrire en s’amusant à l’école » pour l’association L’Aparté auprès d’enfants de CP. 10 ateliers créatifs autour de la lecture et de l’écriture. Ce projet se met en place en janvier et février 2022 à l’école Jules Payot et l’école Joseph d’Arbaud à Aix en Provence.
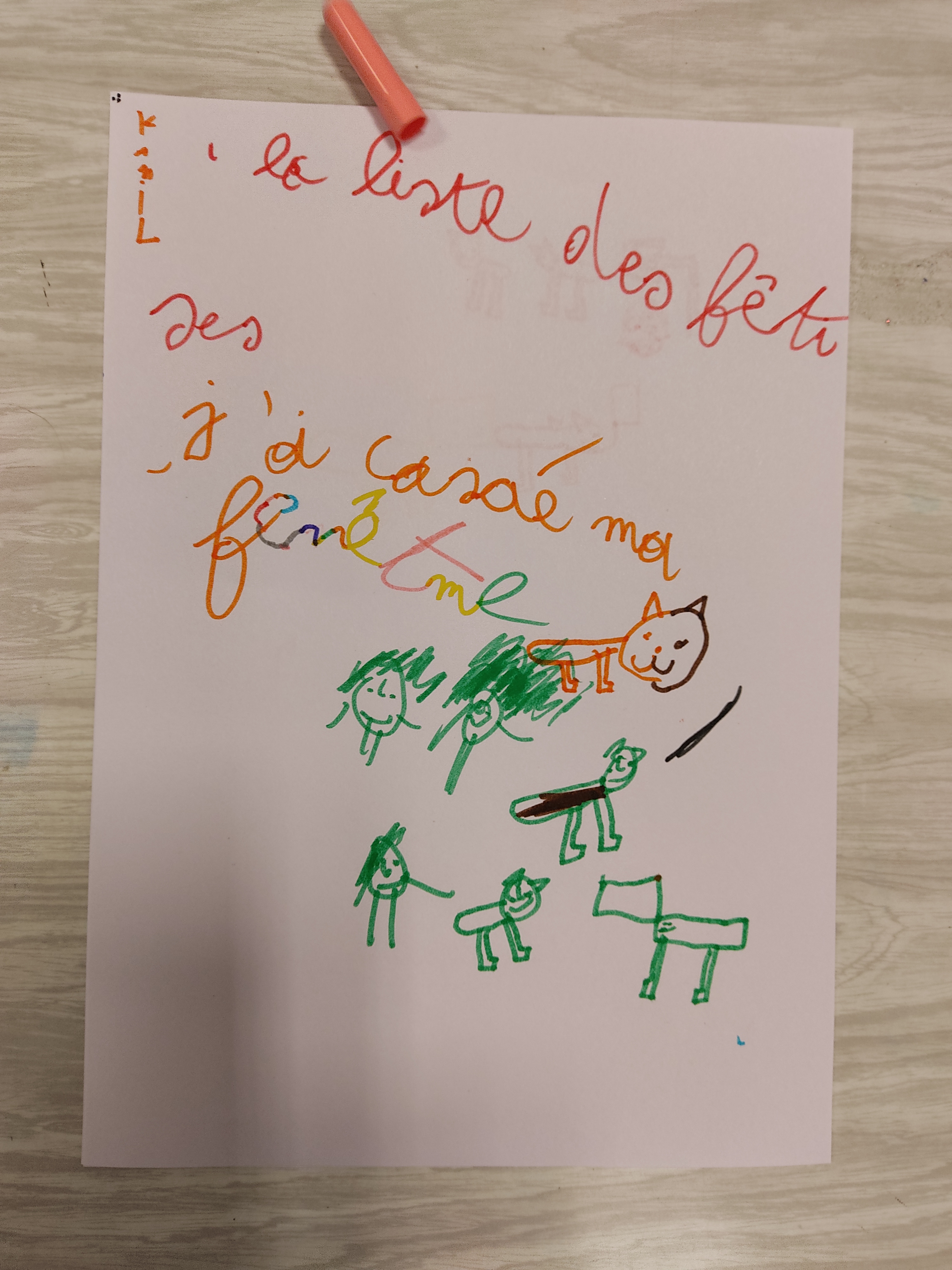
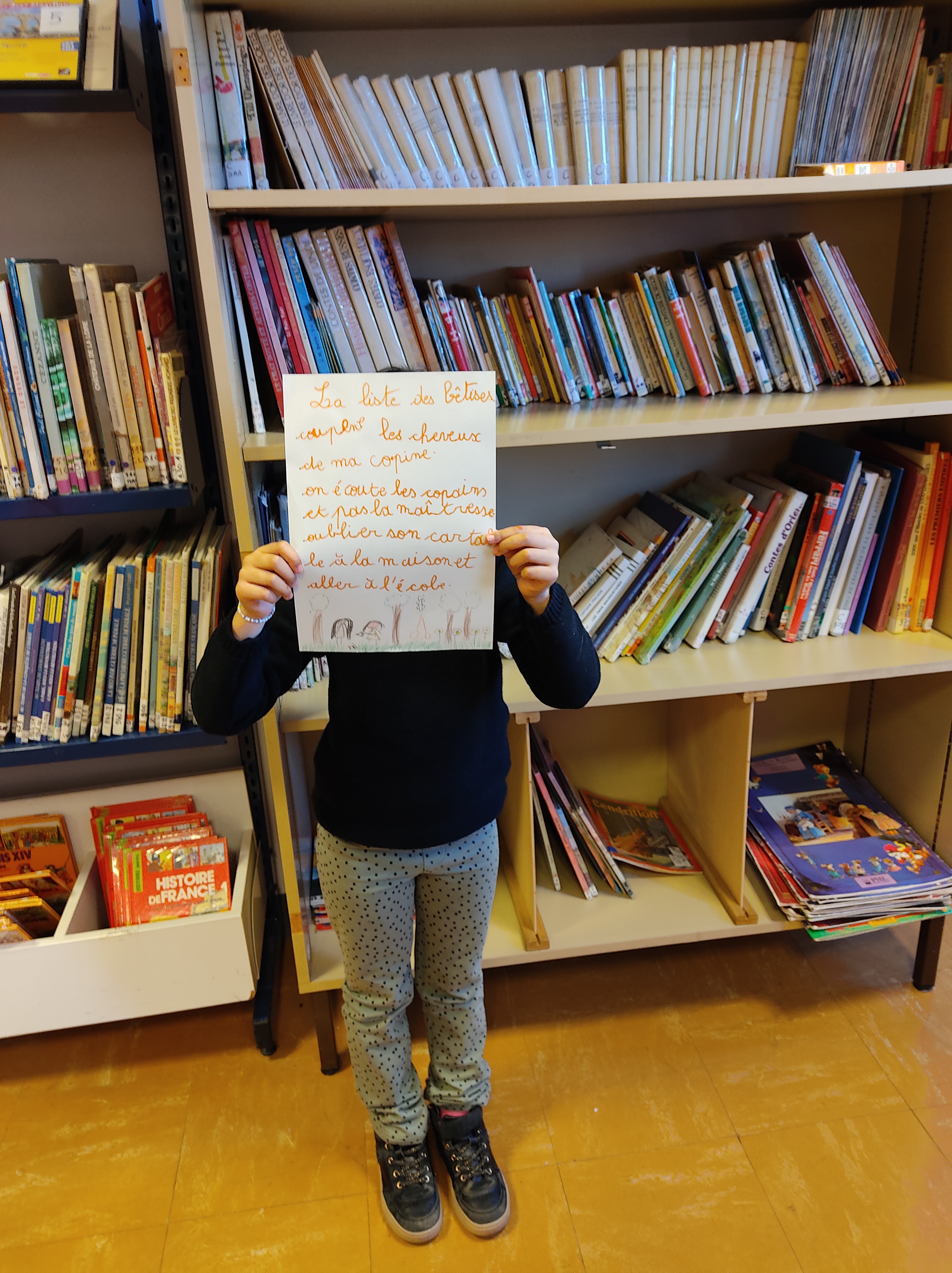
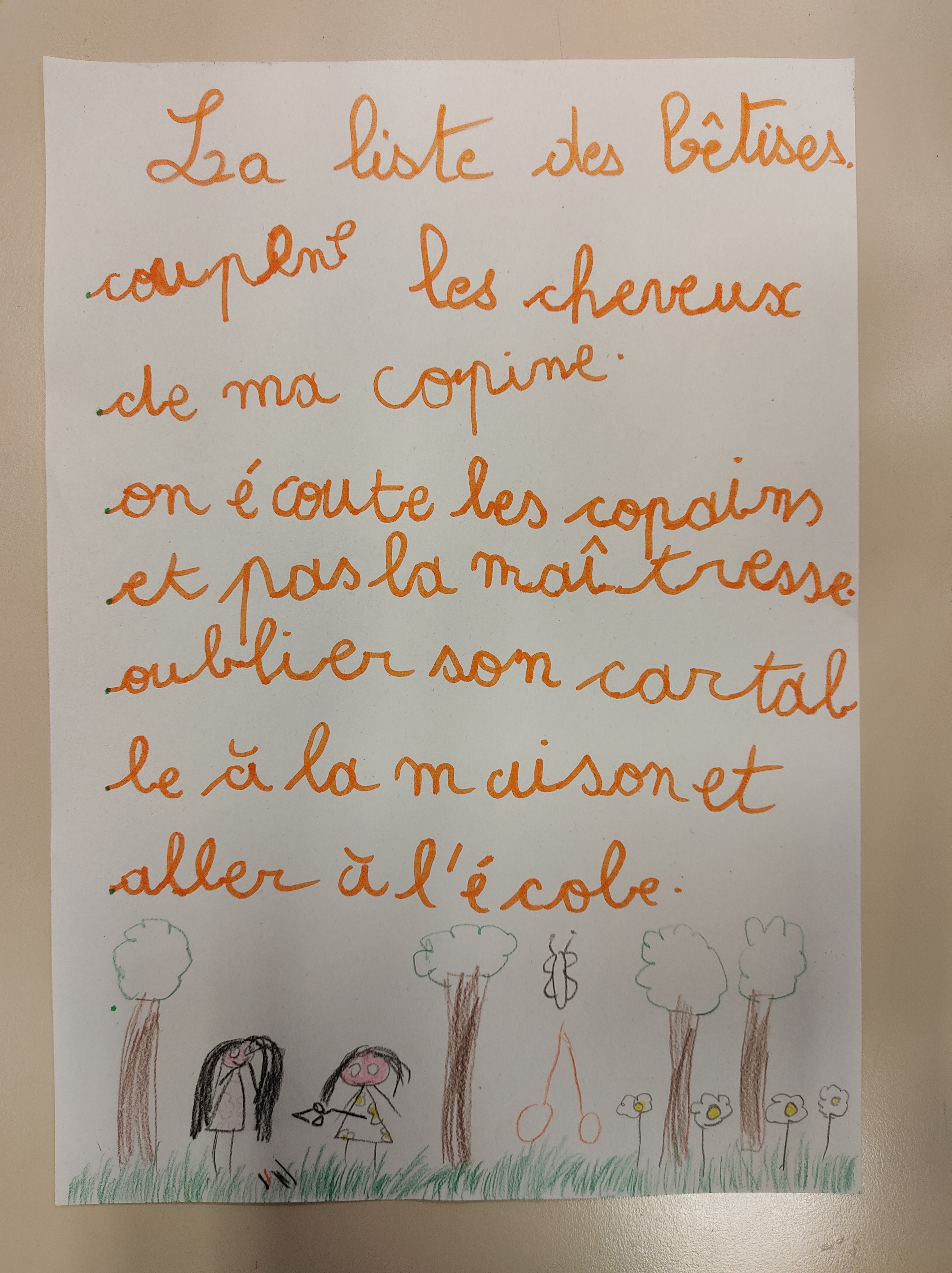
Voici mes voeux pour l’année 2022 !

« Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile qui danse ».
(Friedrich Nietzsche)

Rando-yoga poétique du Voyage intérieur
Offrez-vous une pause ressourçante en pleine nature. Prendre soin de soi, se reconnecter à soi-même et au monde, s’accorder du temps. Un art de l’intériorité !
Dimanche 23 janvier de 14h à 17h à Meyrargues
Marche, yoga, méditation, lectures inspirantes, relaxation, respiration, nature.
Adolescents-adultes à partir de 15 ans / Pas de niveau requis
Accompagnatrices : Rozenn Guilcher et Cécile Cailmail * Association Le Voyage intérieur
Réservations 20€ (dont 5€ d’adhésion à l’association)
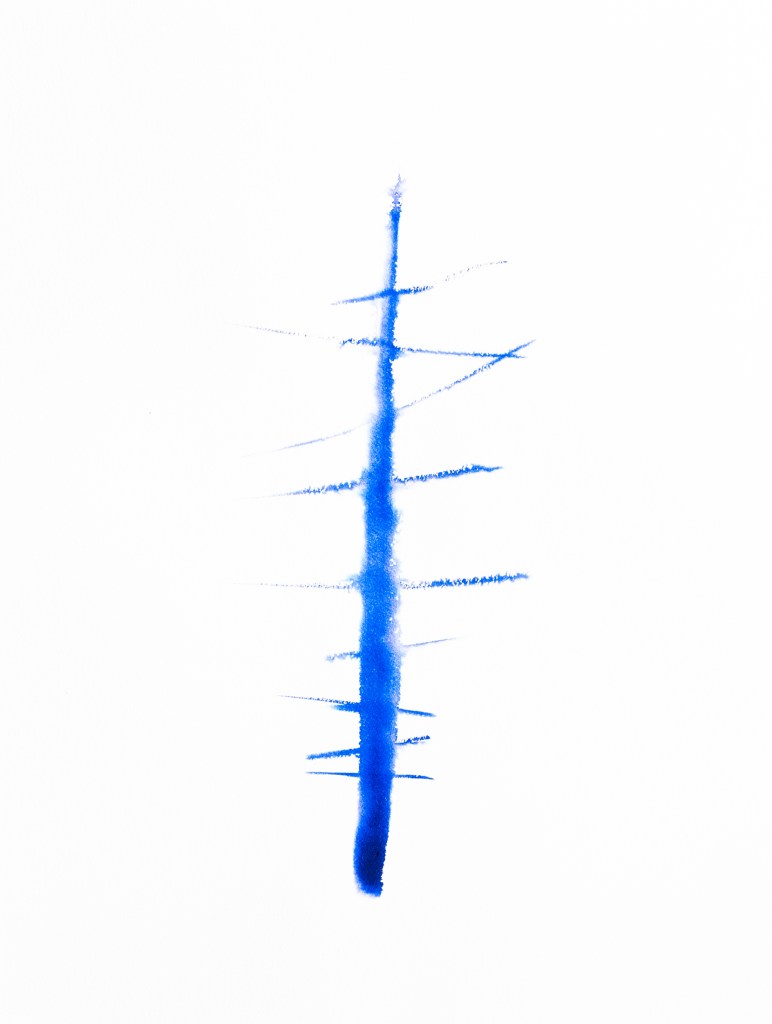
Rendez-vous au Patio du Bois de l’Aune à Aix en Provence avec l’association ETC Aix
Samedi 20 novembre 2021
15h-16h : Lecture-rencontre poétique avec Rozenn GUILCHER : « Peuple-Forêt »
Laissons-nous porter par les bruissements du monde, le visible, l’invisible, la brume des mots et le chuchotement de la nature. Un univers d’arbres, sensible et délicat.
Au plaisir de vous y rencontrer.
Mon texte « Devenir » a été sélectionné par Pictur’Music et je le lirai en 1ère partie de ce récital poétique :
« SEULS LES ARBRES … »
Récital poétique pour piano et arbres
Samedi 16 octobre 20H30 TRETS – Cinéma le CASINO
ENTREE LIBRE
N’hésitez pas à venir à Trets samedi 16 octobre à 20h30.
C’est de la poésie et c’est gratuit !
Au plaisir de vous y rencontrer.
Je viens de recevoir le 1er prix de prose poétique lors du 8ème Grand Concours International de Poésie et de textes courts AMAVICA 2021 pour mon texte « Dériver ».
Dériver
Dériver. Se laisser emporter. Ne plus rien tenir. Aller. Suivre le mouvement. Oui. Non. Accueillir. Dériver, serait-ce quitter sa rive ? Détacher chaque brin d’herbe. La patience qu’il faut au départ, à ce qui commence. La patience qu’il faut au déracinement. Dériver. Défaire les cils. Défaire les contours anciens. Déboutonner nos cœurs. Ne pas savoir. Découdre le rivage des habitudes, de ce que nous avons tricoté d’année en année. S’en aller. Libérer nos bouts de tissus. Nos parts rétrécies tenues si fort si fort. Partir. Flotter. Lâcher nos mains et ce qu’elles gardent serré. Ouvrir nos bras. Bords de route abordés si souvent. Casser des fils, des nœuds, des promontoires. Voyager. Chemin d’eau et de pluie. Dégrafer nos robes de solitude. Courir sur la rivière. Où tu vas je vais. Glisser. Dérober des paysages. Arbres. Ciel. Oiseaux. Partir avec le chant des matins rassemblés et joyeux. Rouler sa bouche aux bouches de lumière. Enroule. Déroule. Danse sur l’eau. Rencontre des ponts. Passe d’autres rives, d’autres rivages sauvages. Traverse le temps. Être soi sans savoir, sans vouloir. Vivre avec les libellules. Les ailes effarouchées du désir. Rire. Regarder ce qui coule. Lécher les bordures naissantes. Dériver. Sourire dans l’instant. Démêler nos miracles. Oui, je dérive. Je quitte et je détache chaque brin d’herbe. Je flotte dans le courant. Ce qui commence. Ce qui pleure. Ce qui part. Flotte dans le courant. Ce qui ouvre. Ce qui lâche. Ce qui patience. Ce qui défait. Ce qui déracine. Flotte. Ce qui découd. Ce qui casse. Ce qui part. Ce qui dégrafe. Ce qui court. Ce qui déboutonne. Dans le courant. Ce qui va. Roule. Rencontre. Passe. Traverse. Rit. Vit.
« L’art de l’intériorité », deuxième volet ! Grâce à la vidéo de Sophie Avedian Expertimo vous allez découvrir mes activités d’écrivain et de peintre. N’hésitez pas à commenter et à partager ! Au plaisir de vous revoir et d’explorer ensemble l’intériorité !
Résidence d’écriture du 19 juillet au 1er août au Centre de loisirs de Velaux !
Je travaille à l’écriture d’un roman « Cœur éphémère » : une adolescente à la recherche de son père. Un voyage de Marseille à Brest. Une errance. D’où je viens, où je vais, c’est aussi qui je suis. Ce que je transporte de souvenirs ou d’imaginaire. Je laisse des traces de moi dans le monde et le monde aussi me traverse. Je vis une histoire chaque jour, je me raconte une histoire. Qu’est-ce qui est réel ? Qu’est-ce qui s’invente ?
Je propose ces ateliers pour rencontrer le « ici » et le « d’où je viens », tirer des fils, dessiner des lignes, les traces de mon passage. Ici, c’est le centre de loisirs. Ici, j’ai saigné du genou, j’ai mangé un gâteau au chocolat et j’ai joué au foot. Ici, j’ai aussi chevauché un dragon, marché sur l’eau, j’ai pourfendu des démons. Le réel, l’imaginaire. Ce qui m’habite.
Et puis, il y a aussi d’où je viens. C’est un pays, un village, une rue ou un jardin. C’est une maison ou une chambre. Et je viens d’un pays où l’on chante la nuit, je viens d’une rue où vivent des oiseaux, je viens d’une chambre qui s’allume en bleu.
2 ateliers d’écriture : « ici » et « d’où je viens » qui donneront lieu à des collages de rues (sur le sol et les murs extérieurs du centre de loisirs) et à une lecture à plusieurs voix par les enfants des textes écrits en ateliers. Une façon de poétiser le monde !
N’hésitez pas à regarder le replay « L’art de l’intériorité », concernant mes activités et le lien entre écriture, peinture et yoga. Grâce à Sophie Avedian Expertimo vous allez découvrir mes cours de yoga et de méditation qui reprennent en septembre. N’hésitez pas à commenter et à partager ! Au plaisir de vous revoir et d’explorer ensemble l’intériorité !

Lors de ma résidence d’écriture au Centre Dramatique des Villages, à Valréas, en septembre, j’ai écrit 2 monologues de 20mn. J’ai le plaisir de vous convier aux représentations dans le cadre du Festival « Les Nuits de l’Enclave ». Deux dates à retenir : les 18 et 24 juillet 2021 à Grillon ! Les réservations sont à faire ICI. Au plaisir de vous rencontrer le 18 juillet !
Jardin partagé de Gardanne, dimanche 13 juin 2021. Des lectures sous les arbres !

Extraits :
Il paraît que c’est le printemps. Il paraît que les jours s’allongent s’allongent jusqu’à devenir des nuits pleines. Jusqu’à devenir un seul jour, énorme. Jour sans fin et sans heures. Jour sans commencement. On a perdu l’origine. Ou peut-être l’a-t-on trouvée ? On ne sait plus. Il paraît que c’est le printemps. Il paraît que des oiseaux chantent plus fort que d’habitude, que la terre s’habille de fleurs, que les grenouilles s’apprêtent. Les choses interdites sont beaucoup plus vivantes. Elles s’épanouissent quand nous ne sommes pas là. Elles dansent dans notre absence. Toute chose respire mieux sans nous. Le monde retrouve sa liberté, sa croissance, sa naissance. Il paraît que c’est le printemps. Ce qui ne se voit pas existe-t-il vraiment ? Ce qui n’est pas pris dans mon regard a-t-il une corpulence de chair ? Où habite-t-il si ce n’est pas en moi ? Si je ne témoigne pas, si je n’atteste pas, si je ne nomme pas. Où va ce qui n’a pas de mots, de mains, de regards ? Moi, homme, serai-je si petit que rien n’a besoin de moi ? Moi, homme ? Il paraît que c’est le printemps. Enfermée dans ma chambre, c’est une idée saugrenue. Idée d’hier, d’ailleurs. Un égarement sans fin. Une chose qui cloche, une chose qui boite. Une chose bancale. Il suffit d’un mot dans mon agenda car mon corps ne sent plus les choses. Pour qu’elles existent, il faut que quelqu’un me les dise. Alors j’écoute ce qui s’écrit dans mon agenda. Ah ! Aujourd’hui c’est le printemps ! C’est marqué ! Il paraît que c’est le printemps. Moi, homme, serait-je si grand que tout est en moi ? Le printemps, il est dedans. Il est quand le cœur bat. Entends-tu la chanson de ton cœur ? Il est, quand, sur la langue, naissent des mots-fleurs, des mots d’amour, des tendresses folles, des chuchotements pour des enfants fatigués. Il est quand ça respire, quand ça sent les odeurs de cuisine, quand ça rit, quand un amour énorme comprend le monde entier. Il paraît que c’est le printemps, dedans.
Lecture musicale avec Bruno le 4 juin 2021 lors du Festival du collectif New Art’Aix !

Je participe à 2 expositions collectives en présentant mes encres et mes textes à la bibliothèque Méjanes à Aix en Provence :
La première partie du festival du New Art’Aix (collectif d’artistes) aura lieu du 1erau 5 juin à Aix en Provence.
* Exposition « Les rêves de la tomate » dans l’espace « Société, civilisation, sciences et techniques » du mardi 1er au samedi 5 juin de 10h à 18h.
* Exposition « Lignes, cheminement, une forêt imaginaire » dans l’espace d’exposition de la Cour carrée du mardi 1er au samedi 5 juin de 14h à 18h.

J’anime un atelier « Art de l’intériorité » jeudi 1er avril de 14h à 16h au CHAS Henry Dunant (3 Avenue Marcel Pagnol à Aix en Provence : près de la Fondation Vasarely).
Cet atelier est ouvert à toute personne en recherche de sérénité et d’intériorité. Je propose une exploration de soi par une approche douce.
Relaxation, méditation, lecture de textes, yoga.
Les sensations du corps, la respiration, le relâchement, le mouvement ralenti. Tout invite à un retour à soi et à une rencontre du monde renouvelée. Un atelier ressourçant pour se relier à son intériorité, s’écouter, se ressentir et se sentir vivant !
Réservation sur : collectifnewartaix@gmail.com
Gratuit pour tous les participants des assos/structures du NewArt’Aix (ALPA, Orée du jour, GEM, Isatis, Socio Montperrin ….) et 2 euros pour les invités extérieurs.
site du collectif : https://collectifnewartaix.wixsite.com/arts
Instagram : https://www.instagram.com/collectifnewartaix/
Retour sur l’atelier d’écriture sur le thème de l’arbre que j’ai animé jeudi 25/04/21 au CHAS Henry Dunant à Aix pour le Collectif New Art’Aix.
Le témoignage d’Aziliz, 15 ans, participante : « Une ambiance où les gens pouvaient se permettre d’échanger librement sans se sentir jugés. Un temps d’écriture assez long, ce qui a permis de laisser venir des choses et de ne pas se contrainte dans le temps. J’ai trouvé intéressant de pouvoir consulter des images dans des livres car ça permettait de se créer un imaginaire et de s’autoriser à être plus libre. Le mot qui résume cet atelier d’écriture : LIBERTÉ ! ».
Et pour continuer à rêver, le texte « Quand la porte se souvient » de Hamid Tibouchi :
« Quand la porte se souvient,
Quand la table se souvient,
Quand la chaise, l’armoire, le buffet, la fenêtre se souviennent
Quand ils se souviennent intensément
De leurs racines, de leur sèves, de leurs feuilles
De leurs branches,
De tout ce qui les habitait,
Des nids et des chansons
Des écureuils et des singes
De la neige et du vent
Un frisson traverse la maison
Qui redevient forêt ».
J’anime 10 ateliers « Lire-écrire en s’amusant » dans 2 écoles primaires d’Aix en Provence. Il s’agit de jouer avec les mots, inventer, créer avec des enfants de CP en difficultés d’apprentissage.

Mon installation « Peuple-Forêt », programmée à La Galerie G à La Garde. Une présentation de 2 mn en cliquant ICI.
Une présentation de mon travail de plasticienne par la Galerie G à La Garde en suivant ce lien Facebook : https://www.facebook.com/GalerieG

L’événement Them’Art #9, qui devait se dérouler au mois de février, est annulé.
Message du service culturel :
« Nous sommes au regret d’annuler notre évènement Thèm’Art associant art contemporain et sujets de société prévu au mois de février 2021.
Le thème « Providence » de cette année nous tenait à cœur en ces temps incertains et nous donnait la motivation de vous offrir une édition de qualité dans un monde appauvri par la cruelle absence de la Culture sous toutes ses formes.
Merci beaucoup à tous les messages et appels de soutien des acteurs de ce Thèm’Art avorté, artistes, jury, conférenciers…
Gardons espoir pour un avenir plus serein ! »

Extrait d’un texte écrit en massage poétique : « Peut-être se rencontrer en dedans. S’arrêter. Manger l’instant et celui d’après, et celui d’après. Se donner rendez-vous maintenant, au bord de la lumière. Une chose fragile, délicate, voyageuse. Une chose infime infinie. Peut-être se rencontrer en dedans. S’asseoir en soi. Se déguster. Habiter là. Peut-être s’aimer ? »
Mon installation « Peuple-Forêt » a été sélectionnée par la Galerie G de La Garde et devait prendre place dans une exposition collective en février. Malheureusement cette exposition vient d’être annulée au vu de la situation sanitaire. Un avant-goût de mon travail d’encres sur papier, de textes et de voix :

Écoute
les arbres
et
tu sauras
tout
de moi.
C’était il y a longtemps.
C’était au détour d’un chemin.
C’était un champ de blé,
de fleurs, de ronces.
Les mots savent si mal dire.
C’était un arbre au milieu d’un champ, deux arbres ou trois, au bout, au coin.
Les mots.
C’était l’idée d’une grandeur dans nos vies quotidiennes.
.
L’haleine
des
arbres
s’appelle
brouillard
.
Lecture de mon texte « Peuple-Forêt » :
Mon texte « Devenir », sur la thématique « Les arbres du désir », a été retenu par Pictur Music ! Je devais le dire sur scène le 22 janvier, en introduction du récital « Seuls les arbres.. », à la Cité de la Musique à Marseille. La lecture est reportée mais vous pouvez le lire sur le site de Pictur Music en cliquant ici.
Mes voeux 2021 !

« La vie est bien trop courte pour perdre son temps à se faire une place là où l’on n’en a pas, pour démontrer qu’on a ses chances quand on porte tout en soi, pour s’encombrer de doutes quand la confiance est là, pour prouver un amour à qui n’ouvre pas les bras, pour performer aux jeux de pouvoir quand on n’a pas le goût à ça, pour s’adapter à ce qui n’épanouit pas.
La vie est bien trop courte pour la perdre à paraître, s’effacer, se plier, dépasser, trop forcer. Quand il nous suffit d’être, et de lâcher tout combat que l’on ne mène bien souvent qu’avec soi, pour enfin faire la paix, être en paix.
Et vivre.
En faisant ce qu’on aime, auprès de qui nous aime, dans un endroit qu’on aime, en étant qui nous sommes vraiment ».
Alexandre Jollien

Dans cette situation de reconfinement, j’ai décidé de déposer un texte poétique chaque jour ou presque. J’ai intitulé cette série de textes « Le jour d’avant » car ils ont été écrits dans nos vies libres, avant. Je posterai chaque jour mon message d’espoir et de douceur sur Facebook et sur cette page. Parce que la poésie, ça fait du bien. Parce que la poésie. Bonne lecture et à bientôt en vrai…
Si vous souhaitez mettre des commentaires, rendez-vous sur Facebook.
Le jour d’avant 40
La forêt. Rien n’est là et pourtant tout est là. Le parfum. Les branches. L’inquiétude du noir tout dessous. Les bruits. Une façon de marcher comme une petite fille et pourtant. Nous savons que des chemins se tracent et se perdent. Nous savons des choses que nous ne voulons pas savoir. Nous croyons. Nous croyons voir. Nous lions nos mains entre elles pour dessiner quelqu’un d’autre. Une présence toute là. Une silhouette blanche entraperçue. Une chose ailée douce. Je suis toujours là pour toi. C’est ce que nous écoutons sous les arbres. Et la nuit peut bien tomber, oui, la nuit. Nous avons notre lumière.
Le jour d’avant 39
Vivre avec des choses qui s’en vont. Des routes molles, des pluies salées. Des murs qui tombent. Tricoter des maisons avec des bougies usagées. Se fendre. S’effilocher dans le vent, le ventre des nuits. Ne plus voir ses mains. Ne plus sentir ses pieds. Les perdre.

Le jour d’avant 38
Marcher où l’eau marche. Courir où l’eau court. Se demander s’il fera jour demain. Si des mains se tendront. Se demander si le silence enserre les roses. Se tenir droit. Sentir la Terre tourner sur elle-même. Voyage de planètes. Départ des îles. La mer lave les chemins. Oiseaux, poissons, et c’est pareil. Articule les plaines aux branches des arbres.
Le jour d’avant 37
Ce cœur qui te cherche annonce la pluie. Un endroit où danser, une musique de nuit. Une fenêtre de bouche. Il n’y aura plus de mots. Les choses seront neuves et éclatantes. Et si simples. Et si nous. Je flotte. Je dépose mon visage. Je souris.
Le jour d’avant 36
Le vent et ce qu’il nettoie. Arbres, plages, sable. La mer descend. Les crabes, nus, se cachent du soleil et des mains d’enfants. Le monde fait un bruit d’eau, un chuchotis de flaques. Algues émoussées. Coquillages multicolores. Des seaux à trésors se promènent. Ici, on ramasse les cailloux, les étoiles de mer ou les coquilles vides. Ici, tout est précieux. Tout témoigne de la vie. Celle qui meurt et celle qui vit. Celle qui attend.

Le jour d’avant 35
Des ponts, des chemins d’herbe, des lumières telles qu’on n’en connaît pas. Des choses toutes petites. Des choses toutes grandes. L’ombre et le glissement du temps. Parfois je regarde dans ton cœur. Parfois tes yeux disent des choses qui éloignent. Je vois devant moi. Le soleil se couche et les phares allument leurs présences. Cette chose ne peut pas me tuer. Je reviens. Je sens ta main. Je sais tout ce que je laisse à jamais derrière moi.
Le jour d’avant 34
Ongle rongé tombé aux oubliettes. Collier de cheveux. C’était quand l’enfance marchait en tombant. C’était des pieds, des mains et l’urgence des ventres. Dans des bouteilles attendent des coquillages. Dents de lait retenues trop longtemps. Usure du pain mâché. Oublier l’étagère des souvenirs. Nostalgie d’un soleil dans l’herbe des jardins. Il est temps de rentrer.
Le jour d’avant 33
Demain m’attend comme un horizon neuf. Je viendrai avec tout ce qui me fait. Je n’ai pas oublié les sourires, les regards et les mains posées. J’ai gardé trace de vos humanités. Aussi des choses non dites. Aussi des silences rassemblés. Des bouquets de rires et des paysages de larmes. Nous avons composé un pays. Nous avons rêvé nos vies. Et maintenant ?
Le jour d’avant 32
Parler, ne pas parler. Savoir habiter un regard. Naître dans un parfum. Porter des êtres défaillants, défaillir à son tour. Être grand et fort, être petit et fragile. S’habiller d’humanité pour aller vers nos frères. Chacun bat un cœur, une musique de monde.

Le jour d’avant 31
Ce qui nous arrête est un rêve. Une faille dans les cuirasses qui laisse passer la lumière. On a vu quelque chose. On ne sait pas. Ce n’est pas là que ça habite. C’est une source ancienne, un jardin de naissance. C’est avant le naître de nous. C’est quand nous nous connaissions. Pays d’oubli et de glace.
Le jour d’avant 30
Un arbre habite une fenêtre. Crépuscule incendie. Nous partons conquérir la nuit. Nous sommes seuls plusieurs ensemble. Un piano se joue de l’herbe. Des oiseaux dorment à côté du jour. Jardin assoupi au bord du chemin. Boire de la musique. Regarder les cheveux devenir ombres dansantes, vagues, fleurs. Tomber dans la pluie, au milieu d’une goutte. Embrasser des montagnes.
Le jour d’avant 29
Le bruit de l’herbe. Insectes et paradis. Ce qui tombe des arbres et ressemble à des pommes. Craquements. Le pas de l’homme. Le feu. L’horizon vert des forêts. Les vagues chantent. Elles annoncent des retrouvailles d’ambre et d’or. Des mains de flaques. Des marées et des langues de sable. La mer. Ses poissons rassemblés comme des fleurs. Bouquets chauds des corps scintillants. C’est le matin. Le passage entre ce qui dort et ce qui ne dort jamais. C’est l’aube des enfances. Ce qui commence et se tient au bord des pierres. Un oiseau. Un coquillage jeté par-dessus le mur. Un œil avancé venu de la nuit.

Le jour d’avant 28
De l’autre côté, c’est toi aussi. Cabane fabriquée. Chose d’enfance et de solitude. C’est le loin de toi que tu ne regardes plus. Parce qu’il y a tant de chemins à prendre. Ce qui t’appelle erre dans une forêt ancienne et pleine de chants. Des robes suspendues perdues aux branches du souvenir. Sourire dans le temps ou pleurer ?
Le jour d’avant 27
Marcher où l’eau marche. Courir où l’eau court. Se demander s’il fera jour demain. Si des mains se tendront. Se demander si le silence enserre les roses. Se tenir droit. Sentir la Terre tourner sur elle-même. Voyage de planètes. Départ des îles. La mer lave les chemins. Oiseaux, poissons, et c’est pareil. Articule les plaines aux branches des arbres.
Le jour d’avant 26
Gouttes prolongeant la nuit. Étoiles tombées ? La chute des rivières précipite le jour. Les heures folles s’agglutinent. S’épouillent, s’épousent. Le roulement des haches. Arbres atrophiés qui s’enfuient. Le hibou s’envole. Le puits tombe en lui-même. La langue se tourne 7 fois, s’enroule, perd ses mots. La mère s’endort, confond le soleil et la lune. Elle vit dans une fleur de coton.

Le jour d’avant 25
Délier les bras du chemin pour que chacun trouve sa place. Tenir chaque lettre de notre prénom. Rire sur des ponts. S’éblouir des vagues, des vagues, des vagues. Apporter du lait au chat, celui qu’on ne connaît pas. Dormir dans la rue avec lui. Miauler. Ne plus aller à l’école. Faire la grève des pommes. Se pencher par-dessus les toits. S’asseoir dans le soleil.
Le jour d’avant 24
Tout aimer. Aimer la pluie. Aimer la nuit. Ce qui tombe. Ce qui se relève.
Aimer chaque heure. Les heures endormies. Les heures lentes. Les heures espiègles ou capricieuses.
Le jour d’avant 23
Temps incertain sous les étoiles ou dans la bouche d’ombre du soleil. L’ombre des arbres appelle dans la nuit. L’ombre de l’ombre tressaille de tant de temps. De tant de silence qui ne se partage pas. Je m’enroule aux lianes du sommeil. J’attends le jour, le moment où d’autres êtres croiront au bleu et à la clarté. J’attends le mensonge des heures molles et voleuses d’âmes. Quand plus rien ne fait peur. Quand l’insouciance de l’enfance dépose un sourire. Un souvenir ?
Le jour d’avant 22
Tenir une main, un cheveu dans le soleil. Tenir la mer entière dans nos yeux. Le temps de rire. Le temps de moissonner les chardons du matin. Horloges tendues de flèches. Choses précipitées comme le feu. Les sabots du passé tonnent au bout du ciel. Des vagues se rapprochent et creusent des sillons. Terre éventrée. Sang arbre glapit son frein.

Le jour d’avant 21
On ira courir dans des champs, dans des rêves. Dans des couleurs qui n’existent pas. Tu sais, les couleurs de derrière les yeux ? Tu sais ? Aurores boréales. Des fleurs parleront notre langue. Tu sais, après, c’est encore. Après, c’est dans pas longtemps et il faudra s’en souvenir. Et il faudra dire des mots sans oubli, sans disparition. Des mots solides comme des montagnes. Des choses ou des traces ou des manteaux pour l’hiver. Que garderont de nous les gens vivants ?
Le jour d’avant 20
Je sens ton souffle à mon cou. Ce qui vient si près qu’il partage mes rues. Je sens ta main en trop. Ton corps trop là. Se resserre le temps, le temps de respirer. Se tient une minute qui pourrait s’échapper. Pourtant, rien ne me prend de toi. Je connais trop les choses qui veulent garder et retenir. Je connais trop la possession des hirondelles. Quand tout meurt dans l’instant.

Le jour d’avant 19
Dans les rochers, le visage d’un homme attendu, attendu longtemps. La danse de la mer. Hirondelles de l’été, sorties de terre comme un miracle. Morceaux dedans dehors échappée. Attendre l’heure de partir. S’impatienter aux frontières du jour. Égrainer les minutes. Chapelet de sable retrouvé à la mémoire des doigts. Respirer le vent comme un chant.
Le jour d’avant 18
Partir. Franchir du bleu derrière le bleu. Traverser une mer de rochers. S’enfoncer dans un soleil ou une heure. Se résoudre. S’asseoir devant le ciel. Partir. Loin. Longtemps. Oublier d’où l’on vient. Récolter ce qui se mange sous les algues. Un bruit d’eau. Des vagues. Le glissement chaud du temps. Des flaques humides lèchent la pierre. Choses emprisonnées qui attendent la marée. Devenir cette attente. Ce qui, dans les yeux, se confond. Ce qui s’ignore. Ce qui se décapsule. Devenir ce silence. Les mots interrompus et la respiration.

Le jour d’avant 17
Limites, frontières floues et mouvantes qu’il faudrait fixer aux parois. Garder sa maison et ses murs comme des vaches. Pourtant tout passe, l’herbe, le nuage, la pluie d’été. Tout marche dans notre sommeil. Et je marche aussi pour trouver une montagne qui m’habite que j’habite.
Le jour d’avant 16
Sous la pluie pattes d’oiseaux. Insectes endormis sur les toits. Graines perdues des moissons du ciel. Toutes les plumes égarées rassemblées sur nos têtes. Une rivière dans nos cheveux. Un chant de maison. Ou le feu et sa voix d’arbre ? Que nous dit l’eau ? Que murmure l’envolée des nuages ? Certains glissements empruntent nos sabots. Ou parcourent nos dents de frissons de nuit.

Le jour d’avant 15
Bouche fermée pour garder ce qui reste de bon. Ne pas laisser entrer l’obscur du monde. Sourire. Ouvrir les doigts comme ça. Respirer pour rejoindre ses pieds. Et puis le fil de la Terre, celui qui relie. Et puis l’autre côté de nous. Un hémisphère retourné et fragile. Et puis sentir une toute petite chose bleue, comme un cœur. Et puis tout revient de ce qui était parti vivre. Et puis tout s’en va de ce qui restait mort.
Le jour d’avant 14
Je t’aime. Je cueille tous les jours tes petites présences. Avant que le toi de toi s’en aille. Avant que le cassé des heures vienne hanter notre bouche et puis notre lit et notre sommeil. Je t’aime comme je pourrais ne plus aimer personne. Et puis peut-être. Et puis quand ? Je t’aime parce que tu es encore là. Et je ne sais pas si tu sauras habiter, si tu sauras choisir la lumière et ce qui brûle parfois et ce qui nous donne un horizon.

Le jour d’avant 13
Réveil. Quelques oiseaux. Quelques feuilles tombées. Ce qu’il reste de pluie. Des champignons approchent la terre. Le monde avance à l’unisson. Quelques hommes, éveillés avant le soleil, font un bruit de mastication. Ils préparent leurs mots de nuit. L’humide du jour. La naissance d’une heure, d’une lueur consacrée. La blancheur sur la mer. Brouillard avant la clarté. Des poissons commencent leur voyage. Personne n’a encore enroulé ses vagues. Il est trop tôt. Les fougères boivent le crépuscule d’hier. Paysage en attente. Chose verte et bleue dans une tasse de thé.
Le jour d’avant 12
J’ai oublié mes balançoires quelque part. J’ai oublié le rire des jours heureux. Comment écouter des mots doux ? Où égoutter le sucre sous la langue ? Entendre. Respirer sous un arbre. Te quitter comme une saison. Partir avant la pluie. Remuer mes doigts dans ma poche. Garder les minutes pleines de toi. Les temps de parcs et de vallées. Repartir sans regards. Dormir des nuits entières.

Le jour d’avant 11
Je reviens vivre dans tes yeux. Je traverse un paysage avec ta main. Je ne demande rien. Car l’habitude endort ses plantes. Nos espaces séparés respirent dans le noir. Nous habitons une plage de coquillages, un virage, une colline pleine de fleurs. Nous arrivons en haut du jour et il faudra bien redescendre. Il faudra bien défaire nos bouches liées pour aller chacun sur notre chemin.
Le jour d’avant 10
Des choses s’échappent. Des choses minuscules qui sont nous. À peine. Composer, décomposer. Laisser couler son sang sur les genoux des autres. Rivières où se cacher, se fondre, se fouler le cœur. Chemin de veine dans le cou du passant, où nous prenons place. Et puis non. Tout voyage. Et c’est nous.
Le jour d’avant 9
Dérouler des montagnes. Cheveux d’anges aux troncs de sèves. Des poissons nagent dans les roches. Les tentacules du temps. Coquillages enfermés. Êtres arrêtés et contenus dans la salive du moment. Je marche sur les sursauts d’amour. Je marche sur les rivières oubliées. Je saisis les chemins. Je regarde passer ce qui meurt.
Partir. Quitter. Aller ailleurs composer un silence. Se dire au revoir, adieu ou à bientôt. Partir avec nos rires ensemble. Partir avec les yeux rencontrés. Garder nos instants. Tenir dans sa main la chose douce des inconnus. Entendre encore les mots entrevus. Marcher avec nos présences. Ne pas oublier. Ne pas perdre. Et sourire dans le vent.

Vivre dans la forêt. Dormir dans le ventre blanc des écureuils. Dans le duvet d’une grotte de bois. Des pattes nous prennent. C’est la nuit et ses lenteurs de soleil. C’est le rêve. Quand le corps tombe au centre de la Terre. Quand il dérive avec une rivière. Un bord de lac. Une île et l’horizon bleu des choses. Ce que nous pouvons attraper avec nos yeux. Souvenirs. Bouts colorés de passions, de patiences, de blés. Poissons argentés qui vivent ensemble et qui ne se quittent jamais. Le fond des eaux. Où la lumière dessine des rayons verts. Des bancs de sable. Où plus rien ne dessine plus rien.
Le jour d’avant 8
Il y a certains jours qui ressemblent à des nuits. Des nuits sous les draps avec une main qui n’est pas à nous. Il y a des respirations proches. Des choses douces qu’on ne savait pas exister. Ruisseaux. Cheveux. Vent. Museaux. Odeurs de forêts. Le bruit des pas lents. Une chanson murmurée. Quelqu’un avec nous.
Le jour d’avant 7
Je pensais que ce qu’on ne pouvait pas nommer n’existait pas. Nous passons nos vies à tenter d’écrire ce qui n’a pas de nom. L’éclat d’un regard. Le bruit de la pluie qui nous fait souvenir d’une autre pluie. Les mots qu’on ne dit pas. Les silences habités. Ce qui n’est pas nommé existe plus que tout.
Le jour d’avant 6
Froid d’un matin couleur d’ange. Les vaches précoces. Les tourterelles. Un oiseau. Le mouvement des corps chauds tout près. Aucun souvenir d’aucun rêve. Des arbres sont venus. Des lacs ont attendu. Ils ont préparé leurs eaux pour les rires et les enfants. Prolonger l’engourdissement des nuits de grillons. Voir une maison. Voir un homme. Et des gens tout autour. Voir un chemin défait de roses. Un chat. Une gouttière pour la pluie.

Le jour d’avant 5
Le sable. Une vague tendue comme un drap. Nous marchons. Le vent nous porte. Nous regardons notre reflet sous nos pieds. Quelques nuages y glissent comme un masque. Comme des cheveux nouveaux. Ils s’en vont et nous nous en allons. Nous quittons le connu. Nous enroulons nos langues car nous n’avons plus rien à manger. Nous buvons notre salive. Passage entre deux êtres de nous. Moment du rien. Sur la pointe des pieds, nous voyons. Ce qui arrive grandit et nous grandissons. Nos habits neufs. Notre peau. Tout est à notre taille. Jusqu’au prochain passage.
Le jour d’avant 4
Des chemins jamais empruntés ou qui ne mènent nulle part. Qui disparaissent dans le soleil, derrière un arbre. Qui s’effacent au bord d’un champ. Des choses dessinées par l’homme, par un animal égaré. Blés couchés. Feuilles écrasées de vent. Le passage incertain des chaleurs ou des pluies. Tornades éphémères. Bruits d’eau aussitôt perdus. Frôlements entre les herbes. Le rugueux du monde. L’épine du jour. Et puis tout passe ou devient autre. Et puis se fanent les heures, les minutes, le mouillé de nous.

Le jour d’avant 3
Des bateaux nous attendent. Blancheur de cailloux. Enfants perdus dans une forêt sous-marine. Le bruit des nuits. Les chats qui vivent sous les algues. La mastication des flaques. Nous sommes arrivés au pays des fées. Le long de la mer, d’autres mers, des pays paysages et quelques arbres. Des enfants marchent pieds nus. Froissent les fleurs à bourdons. Des vagues molles détendent leur fatigue. Journée à patienter son temps. Sentir ses dents sous sa langue. Établir son nid sous les branches de noisetiers. Dormir.
Le jour d’avant 2
Églises habitées d’oiseaux. Les piaillements du jour arrivent avec une brume. Des hommes ont peint des dieux et tout s’est effacé. Tu ne peux pas posséder l’impossédable. Une corde tend une cloche. Des nids tombent du ciel. Quelque part, entre un champ et une route, des livres attendent dans une maison. Les vaches ont laissé leur haleine sur les arbres. Se réveiller dans le silence. Et puis le premier oiseau. Et ceux qui lui répondent. Le souffle des roses au bord du château.
Tenir des cœurs. Tenir des distances, des éloignements, des séparations. Prendre racine dans le temps. Prendre corps. Prendre vie. Où est-elle, cette vie, qui coule parfois si loin ? Où est-elle qui ? Jusqu’où quitte-t-elle l’endroit de moi ? Jusqu’à qui ? Point de rupture et miracle des heures. Les secondes se sèment dans chaque regard.

Le jour d’avant 1
Les pies sont revenues. Elles baladent leur blancheur, leur noirceur et ce qui n’a de nom bleu. Elles vont par deux. On ne les aime pas. Il paraît qu’elles volent les œufs des autres, qu’elles se nourrissent de bébés écureuils. L’amour d’une fenêtre n’est pas le même que l’amour d’un arbre.
Passer sa main sur le silence. Le caresser. Le chuchoter au cou de l’autre. Éclabousser ta voix de mon rire. Tenir tes cheveux, tes yeux. Tenir ton corps qui couche le monde. Tenir le vent. Celui qui vient de ton visage ou de tes mains. Celui qui habite en moi aussi. Et c’est le même. Et c’est pareillement autre. Et c’est tout toi tout moi.
Le jour dans la nuit est pareil. Et pareille la lumière obscurité. Tout glisse, coule, se dérobe. Oui, la robe du temps approche, tombe ou s’élève. Être nu dans la brume. Être nu dans la neige. Tout est dans le même moment. Nuit jour. Colère douceur. Solidité souffrance. L’invisible au cœur du visible. Je goûte le sel au goût de sucre. Je ne cherche rien. J’apprête mon cœur à ce qui est. La terre tangue ou c’est moi. Une vague oscille ce sont mes yeux. Reflets du ciel.

Mon monologue a été joué dimanche 11 octobre à Saint Pantaléon Les Vignes.
Une superbe interprétation de la comédienne Aïni Iften. Merci !
Le message du Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse :
« Le monologue écrit par Rozenn Guilcher dans le cadre de la résidence d’écriture collective de la pièce « Les gens qui penchent », produit par le Centre Dramatique Des Villages et mis en scène par Gilbert Barba. Avec Aïni Iften.
« Les gens qui penchent », une pièce collective écrite avec Guy Robert, Rozenn Guilcher, Jeanne Bézier et Leïla Cassar, se produira tout au long de l’année. Vous pouvez commander un ou plusieurs monologues chez vous, dans votre entreprise, bibliothèque ou médiathèque etc. »
LES GENS QUI PENCHENT
Le projet de résidence d’écriture de 4 auteurs, intitulé « Monologuons ensemble », a donné lieu à 8 monologues.
Nous avons appelé notre pièce « Les gens qui penchent ».
Des dates sont déjà programmées par le Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse :
Vendredi 9 octobre à 21h30 au Théâtre de Verdure de Mollans-Sur-Ouvèze (Rue Porte Major)
Dimanche 11 octobre à 15h30 et à 16h30 au Château d’Urdy à Saint-Pantaléon-Les-Vignes
Biographie envoyée au Centre Dramatique des Villages de Valréas pour ma résidence d’écriture de septembre.
Une façon de me présenter :
« Rozenn GUILCHER écrit des nouvelles, des romans, de la poésie. Certains de ses livres sont publiés aux éditions Sulliver. Elle écrit des choses étranges qui ne devraient pas aller ensemble. Elle écrit ce qu’il y a entre. Cette voix qui rassemble toutes les voix. Ces choses qui n’ont pas de nom. Qui n’en ont pas besoin. Ce sont toujours des gens ou ce qu’il y a dans leur regard ou ce qu’on oublie d’eux. Ce sont toujours des errances, des grains de blé égarés. Partances magnifiques. Le bout des forêts et la profondeur des rivières. Les intranquilles, les cabossés de la vie. Les nous, descendus dans leur propre puits. Ce sont des histoires quotidiennes. Ce sont des mots dans notre tête. Ceux qui parlent et qu’on n’entend pas. Ceux qui ne parlent pas. Ceux qui vivent, qui croient, qui rient. Ceux qui aiment. Ceux qui ne savent pas. Ceux qui nous ressemblent. Une quête de lumière. Ce qui vole dans le temps, au coin d’une fenêtre. Ce qui nous appelle ».

Un projet ambitieux.
8 monologues mis en scène
par Gilbert Barba.
« Les gens qui penchent »…
« Les gens qui penchent » : une écriture à 4 auteurs.
8 monologues, 8 comédiens, 1 metteur en scène.
La résidence d’écriture de septembre à Valréas se prolonge
par une mise en scène de Gilbert Barba.
Les monologues seront joués en octobre !

Merci au Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse d’avoir permis cette écriture nomade !
4 auteurs : Jeanne Béziers, Leïla Cassar, Rozenn Guilcher et Guy Robert.
Article paru dans Le Dauphiné Libéré Haut Vaucluse du 19 septembre 2020.
La Journée de l’Environnement,
prévue au Loubatas à Peyrolles demain,
est ANNULÉE.
J’ai le plaisir de vous convier à me rejoindre à la fête de l’environnement au Loubatas à Peyrolles.
Je vous accueillerai samedi 26 septembre de 11h à 18h.
Je proposerai des lectures sous les arbres, une exposition de mes tableaux et des « instants poétiques » (écriture de textes en direct et chuchotements).
Je lirai mes textes sur les arbres mais également des extraits de ce que j’ai écrit en confinement.
Un moment poétique à partager.
Je vous attends au stand 11.
À partir de 18h30 : soirée festive (Batucada, concerts, soupe au pistou…).
Voici le programme et un extrait de texte pour vous donner envie :
« Il y aura d’autres soleils. D’autres arbres naîtront dans nos yeux. Il y aura d’autres matins. D’autres rues peuplées et criardes. Il y aura d’autres visages inconnus et fugaces. D’autres oiseaux vivront sur d’autres branches. D’autres villes qui seront semblables et transformées. D’autres choses avancées dans le temps et qui habiteront pour nous. Il y aura d’autres naissances et chacun neuf, né à peine aujourd’hui. D’autres hommes les mêmes autres autrement. Il y aura un monde nouveau, une lumière limpide et nettoyée. L’univers se lave et prépare ce que nous attendons. La robe des saisons tourne et se pavane. Dans notre maison, la rivière passe sa langue sur le ciel. Tout est bleu. Tout est habillé de transparence claire. Tout rit. Le monde, le nouveau, attend l’homme, le nouveau. Et c’est bientôt ».
Fête de l’environnement, Le Loubatas, Peyrolles
J’ai été sélectionnée par le Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse pour une résidence d’écriture de 15 jours à Valréas avec 3 autres auteurs (du 7 au 20 septembre) !
Écrire des monologues pour la scène, quel plaisir !!!

En 2013, j’ai publié un livre qui traite du monde d’après : « Futura».
C’est un recueil de nouvelles publié aux éditions Sulliver. « Futura » ouvre les brèches du monde contemporain et porte un regard sur la société que nous construisons. Où courons-nous si vite ? Qui parquons-nous si facilement ? Qu’abîmons-nous que nous ne saurons reconstruire ? Sommes-nous sur le point de donner naissance à l’homme préfabriqué ? L’être humain est-il un objet du monde contemporain ou un sujet ? S’achète-t-il comme une marchandise ? Qu’est-ce qui s’achète dans l’homme ? Son sang, son foie, son cœur, son âme, son temps, sa vie ?Dans notre monde précipité, parvenons-nous à vivre nos enclaves de temps humain ?Ce sont des voyages, ce sont des traversées où le monde extérieur et le monde intérieur se mêlent parfois pour nous faire entendre le chant des hommes. Les contrées de « Futura » nous parlent d’un endroit où nous avons vécu, où nous aimerions vivre, où nous irons vivre, où nous vivons peut-être. Ce sont d’étonnantes peuplades qui croisent notre route, ce sont de bien étranges rites. Planètes insondées, parcelles du temps, enclaves de l’espace. Nous pouvons nous promener dans les jardins sauvages de « Futura », nous pouvons croire que c’est un rêve. Est-ce bientôt ? Est-ce ailleurs ? Est-ce vraiment bientôt ? Est-ce vraiment ailleurs ?
Extraits : « Phare en pleine mer. Jeudi 28. Je pense au jour où je viendrai te donner des nouvelles du large. Je viendrai te donner des nouvelles de tout ce qui est grand grand à jamais. Je viendrai te donner des nouvelles de l’infini des choses de ce qui ne s’arrête pas la lumière le lointain. Je viendrai te donner des nouvelles de ce qui ne finit pas. Je viendrai te parler. Je viendrai te parler de mon endroit au milieu de l’océan de la pluie battante sur ma lucarne et de la sensation si particulière d’habiter au sein de la tempête. Te parler de l’ondulation des vagues. Te parler des nuits qui se ressemblent et puis des nuits qui ne se ressemblent pas et puis des nuits qui ne se ressemblent plus. Je viendrai te donner des nouvelles d’une mer éteinte et d’une myriade d’étoiles toutes allumées en même temps. Je viendrai te donner des nouvelles du silence et de la solitude quand rien ne traverse ton ciel et qu’il faut encore vivre. »
« Dis Thérame la fin du monde est-ce que ça a commencé ? »
La presse : « Le style, scandé, rythmé, s’affirme mais s’allège, plus libre, plus ludique aussi… On s’éloigne à grandes enjambées de La Fille dévastée, un premier roman superbe et dérangeant, pour s’ouvrir à l’humour et la poésie. L’auteur y dévoile un panorama de notre monde actuel vu au travers de sa lorgnette avec une anticipation, une projection de ce qu’il a de fortes chances de devenir ». Christiane Courbon – La Provence
« Chronique de la fin d’un monde. C’est, en premier lieu, une entreprise littéraire parfaitement réussie […]il s’agit des fragments d’un seul et même grand texte (une sorte de livre sacré) dont l’unité perpétuellement menacée est assurée par le moyen, ici tout puissant, d’une écriture si personnelle qu’il est impossible de l’imiter sans la caricaturer. […]De la première à la dernière ligne, c’est donc un livre de rébellion à plusieurs voix (souvent inextricablement mêlées) qu’il faut savoir parfois lire entre les lignes. […] Ce petit livre ? Une bible ! ». Jacques Lovichi – La Marseillaise
« Futura » est en vente au format papier sur le site Les Libraires ou en livre numérique en cliquant ici.
Déconfinement Covid-19
Dans cette situation de déconfinement, j’ai décidé de continuer d’écrire un texte chaque jour. Jusqu’à quand ? Voilà, c’est parti ! Bonne lecture !
Déconfinement Covid-19 / 13 juin 2020
Jour 34
Des gens dansent. Des gens boivent de la bière. Des gens discutent. Se regardent. Mangent du pain et du fromage. Guitare. Quelqu’un dit des mots dans un micro. La nuit sent la pluie. La nuit sent le pin et le bois des terrasses. Chacun s’empresse au bord des lèvres des autres. Chacun tombe dans des yeux. Les regards glissent sur des chemises et des mains. On rencontre les amours qui sont si loin. Ceux qui se serrent un peu plus au coin des verres. Ceux qui attendent. Ceux qui parlent fort et se rapprochent. Rencontres. Musique bleue. Les souvenirs arrivent. Sourires. La jeunesse est venue avec ses cheveux lâchés. Ceux qui mangent de la bière. Ceux qui grignotent une assiette de charcuterie. Ceux qui arrivent tout doucement à la frontière des foules. Ceux qui cherchent les toilettes. Ceux qui restent où ils sont. Ceux qui dansent et crient. Oui, des gens crient, sautent, fébriles. Des gens donnent leur corps au soleil couché. Des gens s’assoient sur des genoux. Des gens fument. C’est quand l’ombre avance à la surface de la Terre. C’est quand la lune s’installe. C’est quand la musique électrise les âmes. Nous fait voyager dans le temps. Nous rend notre passé. Quand nous étions jeunes et insouciants. Quand nous dansions dans des soirées amies. Dans des boîtes, dans des jardins, sur les tables des bars. Dans des salons transformés en dancing. Là où des inconnus nous abordaient. Où nous rencontrions des autres assoiffés de joie. Où nous venions oublier qui nous étions. On rendait les clés de nos vies. On perdait le temps, la réalité du quotidien, le sens. On déposait nos consciences avant de rentrer. On riait, on sautait, on interpellait, on touchait les épaules, on fumait, on disait tous les mots qu’on n’avait pas dits, on buvait, on chantait, on se recoiffait. En partant, on reprenait les clés de nos vies, notre conscience, notre voiture. Et parfois, on partait sans rien. On oubliait. On égarait. On tombait dans un trou. Une mémoire noire ou blanche. Un endroit où l’on ne savait plus. On s’endormait. On cherchait ce qui était passé à notre portée et qu’on n’avait pas pris. On rêvait d’un petit garçon qu’on invitait à dormir chez nous pour une nuit. On lui donnait des jouets pour qu’il reparte vivre dans la rue. On rêvait de nous attendu quelque part. De soirées claires. De moments empilés qu’on saurait désensabler. D’un monde solide sur lequel marcher. On rêvait de déserts de sel. De pays sans obstacles. D’horizons qui grandissent en avançant la main. Des yeux dans lesquels on pourrait habiter.

Déconfinement Covid-19 / 12 juin 2020
Jour 33
Bienvenue aux jours gris. Aux jours de multiples saisons. Bienvenue aux mondes passagers qui offrent un peu de lumière. Aux gris. À tous les gris. Aux nuances des heures. Le ciel se nettoie. Il laisse sortir ce qui l’encombre. Il ouvre ses placards au vent. Nuages, noirceurs, turpitudes. La chevelure perdue des autrefois. Les vieilles choses. Les colères et les tentatives d’étranglement. Le bruit assourdissant des arbres cognés. Les tambours de la pluie qui prépare sa boue. Bienvenue aux jours gris. À ce mouvement de planète. Nous voulons fermer portes et fenêtres. Nous voulons porter nos cœurs à l’abri. Mais pas tout de suite. Le soleil viendra plus tard. Il faut de la rigueur au dénuement. Il faut de l’obéissance. Ouvrir le ciel aux tornades. Des choses anciennes restées coincées dans les dents du chemin. Il faut des mains pour envoler les pleurs. Les histoires d’avant. Les bols cassés. Pots inutiles. Déchets abandonnés sous des tas de pierres. Rancœurs. Les mots qui blessent. Les sourires rouillés. Les choses retenues. Collier métallique pour des nuques emportées. Muselières. Interdit. Une grande liberté. Et les mots, les murs, les barrières. Cascader les pentes. Les montagnes infranchissables. Clouer les masques. Et puis déverser sa souffrance, ses souvenirs douloureux. Laisser partir avec l’eau des fleuves la décomposition de nos visages. Laisser partir. Déshabiller nos minutes. Le temps de nous se dissout momentanément. Nous quittent les mémoires de sable. Poussières entreposées sur nos étagères. Appartenances dérisoires. Objets qui croient être nous. Jetons les cendres de nos morts. Jetons les meubles qui dessinent des ombres. Le galop des savoirs. Les choses qu’on pense. Les mots qu’on dit. Tout est usé, rapé. On voit le jour au travers. Tout est terni et sale. Les traces qui broient la lumière. Les morceaux de bois qui pillent nos âmes. Lavons notre passé. Allons voir derrière les choses. Quand nous serons nus et nouveaux. Quand nous serons impatients. Alors les grisailles deviendront des clartés. Nous verrons loin. Nous verrons haut.

Déconfinement Covid-19 / 11 juin 2020
Jour 32
Où es-tu, renard ? Depuis la précipitation du monde, je ne te rencontre plus. Depuis que le monde refuse de grandir. Il veut redevenir le petit d’avant. Il rebrousse chemin pour remettre les vêtements qui ne lui vont plus. Tout est trop court, trop serré, trop usé. Il faudrait se débarrasser de tant de choses. Vider nos placards. Trier nos tiroirs. Jeter ce qui ne nous sert plus. Perdre du poids. Se déposséder. Il faudrait. Amoindrir nos mots. Faire de la place. Espace. Silence. Horizon. Se désencombrer. Se dénuder le cœur. Laisser partir ce qui est vieux. Où es-tu, renard ? Enfant de la lenteur. Pelage battant dans le soleil. Creux. Terrier. Quand la boue est de l’or. Quand tu colles ton front à mon front. Moustaches. Dans tes yeux de blé, c’est moi que je rencontre. Quand tu enroules ton corps et que tu tiens mon cœur en haleine. Quand tu viens, la nuit, apporter des réponses. Quand tu viens le jour dans l’assise des solitudes. Tu miroites la lune. Tu es la forêt et toutes les sèves rassemblées forment une rivière de feu. Arrivent avec toi les montagnes dépeuplées. Où es-tu, renard ? Attends-tu que s’arrête le temps pour venir boire de mon eau ? Que s’arrêtent les bruissements, les tentacules des hommes affamés et les accélérations. Ce qui nous engloutit et nous fait vivre à la surface des choses. Ce qui agglutine nos émois. Dans ce monde-là, le monde du monde, notre corps est dur et fermé. Dans ce monde-là, notre âme ne saurait exister. Alors parfois nous promenons un semblant de nous sur les routes. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous parvenons si peu à être. Dans ces moments, le renard ne se montre pas. Il s’endort. Il s’éloigne derrière la mâchoire des matérialités. Ce qui nous mâche. Ce qui nous déglutit. Ce qui nous broie. Ce qui nous absente. Les choses reviennent. Une foule de choses. Nous prennent. Nous déprennent. Nous détournent. Sommes-nous ces apparences magnifiques ? Sommes-nous seulement cela ? Sommes-nous l’ombre du monde ? Sommes-nous ces bruits ? Sommes-nous ces agitations ? Sommes-nous ces empêchements ? Quoi d’autre ? Qu’est-ce qui fait de nous des êtres humains ? Demande au renard qui vient, la nuit, apporter des réponses.

Déconfinement Covid-19 / 10 juin 2020
Jour 31
Les enfants sont là. Avec leurs devoirs, leurs sollicitations alimentaires. Avec les rendez-vous qu’il faut prendre pour eux. Ils n’arrivent plus comme avant, comme des bourrasques. Ils sont là. Ils restent. Ils ferment la porte de leur chambre. Ils travaillent. Ils remplissent des fiches. Ils se connectent pour savoir ce qu’il faut faire. Ce qu’il faut imprimer. Ce qu’il faut apprendre. Ce qu’il faut calculer. Ce qu’il faut rendre. Ils s’agglutinent. Ils se rétrécissent. Ils s’enferment. Ils répondent à des professeurs. Ils notent dans leurs agendas. Ils s’organisent. Ils anticipent. Ils ont des comptes à rendre. Des obligations. Ils ont des exercices pour s’assurer qu’ils ont bien compris. Ils ont des visioconférences, des cours en ligne, des rendez-vous téléphoniques. Les enfants sont là. Ils sont contrôlés. Ils sont occupés comme c’est indiqué sur la porte des toilettes. Ils sont remplis à ras bord. Ils sont over-bookés. Ils se demandent quand ils auront le temps de dormir. De manger. De rêver. De marcher. De lire. De jouer. De ne rien faire. Leurs rêves ? Faire des crêpes. Courir dans des champs. S’allonger avec les nuages. Sauter dans une rivière. Regarder un film. Se cacher. Manger des bonbons. Rouler en trottinette. Prendre le temps au petit déjeuner. Se mettre de la crème qui sent bon sur le corps. Se déguiser. Faire de la peinture. Faire une cabane avec des branches mortes dans la forêt. Voyager. Rester en pyjama. Griller des chamallows au feu de bois. Fabriquer un collier avec des perles. Se maquiller. Voir les copains. Prendre le temps de rester sur les genoux de sa mère même quand on est grand. Faire du vélo. Chercher des crabes au bord de la mer. Chahuter. Regarder par la fenêtre. Visiter un château. Manger des glaces. Se chatouiller. Prendre des photos. Aller dans une grotte. Sauter dans les vagues. Se mettre du vernis à ongles. Aller au marché. Manger des sushis. Rentrer dans une parfumerie. Se promener sur une île. Faire une sieste. Courir. Sauter. Tenir des têtards dans sa main. Flotter dans le courant. Se faire une coiffure originale. Partir. Vivre en maillot. Faire du cheval. Se rouler dans l’herbe. Chercher des coquillages. Camper au bord d’un lac. Jouer à la pétanque. S’allonger au soleil. Se coucher tard. Chercher les étoiles filantes. Prendre un bateau. Découvrir des pays. Se promener sans fin sur des balançoires. Cueillir des fleurs sauvages et offrir un bouquet. Manger avec ses doigts. Ne pas avoir d’heures. Ne rien faire. Dormir dans une maison dans un arbre, une yourte ou un tipi. Admirer les feux d’artifices. Marcher pieds nus. Sauter. Chanter à tue tête. Rencontrer des chèvres. Rire.

Déconfinement Covid-19 / 9 juin 2020
Jour 30
Dire bonjour. On ne sait plus. On se balance d’un pied sur l’autre. On sourit derrière notre masque. On ne sait pas si ça se voit. Notre visage a disparu. On se respire soi-même. On a mis des murs de tissus. Des distances de sécurité. Des éloignements thérapeutiques. Des distanciations sociales. Des barrières. Des barricades. Des barricages. Des fils de fer entre nous. Il faut respirer dans les trous tout petits qu’on a dessinés pour nous. Il faut tenir son rang. Tenir la distance. 1 mètre 50. Dire bonjour. Ne plus s’embrasser. Ne plus se serrer la main, les bras, le cœur. Ne plus se garder contre l’autre, longtemps, comme on faisait avant. Effleurer le monde. Vivre à la surface des choses. Ou à côté. Ou au-dessous. Ne plus fourrer son museau dans les chevelures et les cous. Ne plus étreindre. Ne plus porter, rouler, appuyer. La légèreté d’une plume quand on veut tant peser. Ne plus sentir les os sous la peau. La pulpe d’un pays qui s’en va. Le battement des cœurs qui ne s’entend plus. On est trop loin, ailleurs, absent. Dire bonjour. On ne sait plus. On hésite. On retient un élan, un rapprochement. On retient sa respiration toute petite. On retient son corps rétréci. On est tout seul dans la rencontre. On est tout bas. Même les mots s’étiolent comme des fleurs restées trop longtemps dans le vent. Restées trop longtemps sous l’eau. Restées. Reste une tige. Une chose coupée. Le visage a disparu. Les cheveux sont tombés sous des tas de vêtements, sous des masques. Corolles noyées dans les gels hydroalcooliques. Des solutions gouvernementales. Des potions pour tenir les âmes en laisse. Sortir faire pisser nos cœurs trois fois par jour. Désosser nos émois. Racler nos émotions. Dire bonjour. On ne sait plus. Reculer. Reculer en soi. Adapter ses déplacements à la danse des autres. Contraindre ce qui vibre, brille, tournoie. Raconter des histoires aux étoiles. Des histoires inventées. Des histoires fausses, faussement vraies. Qu’on dirait mais non. Mentir. Vouloir. Avancer sa main. Retenir. Garder. Troubler. Faseyer. Se perdre.

Déconfinement Covid-19 / 8 juin 2020
Jour 29
Préparer les vacances. Ce qui est ouvert. Ce qui est fermé. Campings. Lieux culturels. Traverser la France. Se poser des questions. Ne pas savoir. Imaginer des trous dans une carte. Des endroits blancs. Des choses fermées sur elles-mêmes, fermées définitivement. Des restaurants qui deviendront des salons de coiffure ou des magasins de vêtements. Des bars en attente. Vitres sales. Affiches. Chaises empilées derrière la devanture. À vendre. Des villages désertés désertiques. Traverser la France. Vouloir retrouver des lieux aimés. Animés. Restés les mêmes après tant d’années. La place. La boulangerie. L’église. Le marché. Le grand bazar. Magasin où l’on trouve tout même ce que l’on ne cherche pas. Le glacier. Ne pas savoir. Avoir peur de ne plus reconnaître ses points de repères. Partir dans l’inconnu. Dans la surprise du nouveau. Un voyage à créer. Une sorte d’exploration. Préparer les vacances. Ne pas préparer. Faire autrement. Se surprendre. On verra bien. Où dormir. Où manger. Chercher des lieux disparus. Submergés par les dettes, les interdits, les absences. Suivre la carte. Changer de route. Prendre un nouveau chemin. Nouveau départ. Poser sa nostalgie. Poser sa mémoire. Partir à l’aventure. Traverser. S’asseoir au bord de l’eau. Prendre tout son temps. Oublier sa direction. Tourner à droite parce qu’on aime bien le nom de cette route. Continuer tout droit. Un champ. Des chevaux. Se laisser bercer par le paysage. Tomber sur une rivière, une église, un troupeau de moutons. Aller où l’on n’est jamais allé. Prendre tout. Le soleil. Le virage. La clarté dans les yeux des chats. Le vol des oiseaux, ensemble. Les maisons. Les montagnes. S’allonger dans des champs. Manger des glaces. Les pieds nus. Courir devant l’orage. Lire. Rester longtemps sous les étoiles. Il paraît que c’est la nuit des étoiles filantes ! Sentir la terre chaude sous notre dos. Écouter le bruit de la mer. Son bruissement doux et crépitant qui parle de notre cœur. Attendre que les phares s’allument. Saisir le battement du monde. Les grillons. L’odeur des feux. Le chuchotement des rêves. Le chant de nos pas dans les hautes herbes. Les cloches. Nos jambes dans les ruisseaux. Une musique, le soir. Un château. Un jardin fait de roses. Nos yeux sur les reflets. Nos mains dans des cheveux. Les vacances.

Déconfinement Covid-19 / 7 juin 2020
Jour 28
Rejoindre la lumière. Mémoire dans la bouche. Être là. Entièrement. Savourer les plis du temps. Les choses dont on se souvient. Et celles dont on ne se souvient pas. Le goût des bonbons. Le bruit des rivières. Et ce que l’on sait présent comme un sable. Avant. Avant avant est là entièrement. Et encore. Les feuilles froissées. Les rides. Les rires. Je suis toutes ces choses empilées. Sédiments. Coquilles de coquillages. Pierres polies par des mains anciennes qui ne savaient pas parler notre langue. Les chemins pris. Les chemins abandonnés. Ceux qu’on n’a pas vus se dessiner à l’horizon. Les chemins cachés de l’existence. Je suis un corps fait de ponts et de traces. Fossiles sous la terre tout dessous. Bricoles insues. Fabriquées par des pattes, des vagues ou des pluies diluviennes. L’univers sculpté au fil du temps. Suspendu dans le maintenant de moi. Tricoté de bouts de ficelles perdues ou tenues à jamais. Rejoindre la lumière. Devenir cette substance. Une chose qui éclaire. Un faisceau dans le noir. Une boue de mots découverte sous nos pieds. Transparence. Traversée. Jusqu’à l’endroit où il n’y a plus de parole. L’endroit sans mots. Jusqu’à l’endroit sans endroit. Un envers méconnu. Une enclave de paix et de silence. Rejoindre la lumière. Se mettre debout. Flotter dans un ciel nocturne. Étoiles et firmament. Avoir passé la porte verte. Il n’y a plus de poids. Corps sans corps. Membrane renoncule. Être à sa place. Le passage des planètes. La danse des astres. Aimer. Sourire. Tout de moi. Tout de toi. Tout de nous. Temps sans temps. Verger enclos et tout offert. Le cosmos comme un ciel en haut et en bas. Rejoindre la lumière. Ravissement.

Déconfinement Covid-19 / 6 juin 2020
Jour 27
Une fleur chante dans mon salon. Un troupeau de fleurs. C’est quand Hermine m’a offert une plante. Une azalée rose ou orange. Une azalée pêche. Couleur de la peau. Elle s’émerveille toute seule. C’est quand Hermine m’a remercié infiniment de lui avoir fait ses courses pendant le confinement, un peu après, jusqu’à ce qu’elle soit rassurée de côtoyer de nouveau les vivants. C’est quand Hermine. J’entends sa voix qui grelotte. Je vois ses mains qui tremblent. Ses yeux mouillés. Hermine tout entière dans son azalée. Finalement, nous ne nous sommes pas quittées, finalement ! Des fleurs rient dans ma maison. Elles me saluent le matin. Présences douces et rondes. Elles invitent d’autres boutons à fleurir. Elles dansent. Elles sont fières de leur fragilité. Elles attendent un peu d’eau, une caresse, un regard. Parfois, je leur parle. Nous avons quelques familiarités. Je les touche du bout des doigts. Je les respire. Petites femmes rassemblées quand la lumière décline. Elles coquettent. Elles batifolent en secret. Que font-elles, le soir, quand je quitte leurs rires ? Parlent-elles ? Glissent-elles dans la nuit ? Visitent-elles la maison ? Ou bien viennent-elles se pencher sur mon sommeil ? Avec leurs corps ouverts. Se serrent-elles dans le froid ? Chuchotent-elles dans une langue fleur ? J’entends parfois comme un bruissement. Un frémissement dans les rêves bleus. Quand elles boivent. Quand elles grandissent et poussent leurs racines plus loin. Quand elles s’étonnent de la lumière. Peut-être cherchent-elles Hermine ? Du bout de leurs pétales. Une chose nue qui touche le ciel. Une évidence sans question. Pureté du temps suspendu là. Splendeur et abandon. Je les regarde vivre. J’essaie de faire comme elles.

Déconfinement Covid-19 / 5 juin 2020
Jour 26
C’était le jour des têtards. Des taches noires dans la lumière. Une eau dessous les arbres tout dessous. Un bruit de clairière dans la pluie. C’était passer sa main sur leur peau douce. Ceux qui font semblant d’être morts et ceux qui veulent s’échapper. Des taches noires dans la lumière. Et l’émerveillement de l’enfance dans notre vie adulte. Nous avons grandi avec la surprise au cœur des fleurs. Le sautillement des sauterelles. Caresser les naissances. Les petites choses de boue. Branches tombées. Troncs cassés. Ombre des moments morts. Nous serons là encore et le monde aussi. Il y avait des filles rieuses. Des cheveux longs. Nous ramassions nos corps pour être plus près des miracles. Nous venions du chemin des cerisiers. Du chemin des soleils. Nous cherchions le bruit de ce qui court. Nous cherchions le mystère qui sommeille. Chemin des immortelles. Chevaux. Brindilles. Le thym et son goût de terre. Nous avancions pour rencontrer la main blanche des heures. Le lièvre apeuré. L’arbre déraciné, rattrapé par la foudre. Les abeilles et leurs maisons bleues. C’était le jour des têtards et nous ne le savions pas. L’herbe haute. Un champ. Une plante inconnue. Les pas qui craquent. La poussière des forêts. La poudre des nuits à nos épaules. Il faisait chaud. Mai ou juin. Nous attendions un sentier dessiné par quelqu’un d’autre. Par tout un monde. Traces des passages et des migrations. Présences. Ce qui vit si bien quand nous ne sommes pas là. Ce qui habite le crépuscule ou le temps. Ce qui se cache dans la journée. C’était le jour des têtards. Tenir dans sa main des formes enfants. La vie tout entière. Tache noire frétillante. Garder de l’eau en creux. Tenir dans sa main le monde. La lumière recroquevillée. Nous regardions ce nous de nos existences. Oiseau effrayé. Être penché vers du grand. Nous ajustions notre enfance. C’était elle, au cœur de l’eau, que nous allions chercher. C’était elle, la tache noire, la lumière, la frayeur et la vie. Elle, saupoudrée au bord d’une rivière, que nous revenions attraper, grandis et majestueux.

Déconfinement Covid-19 / 4 juin 2020
Jour 25
Il fallait se cacher pour lire la nuit. C’était l’enfance interdite. L’enfance arrêtée en plein vol. Plumes tombées au fond du jour. Lire la nuit. La dérouler sous la langue, dans un lit, derrière des draps. Une obscurité, une autre. Porter sa lampe sur le chemin des mots. Voyager. Parler avec des gens de papier. Écouter leur mémoire. Aimer le murmure qui nous tient éveillé. Il fallait se cacher pour prolonger les heures. Remonter à la surface pour respirer. Avoir chaud. Laper l’air. Prendre des réserves de souffle. Retourner au labyrinthe d’ombre. Tunnel tissu ombilic. Retenir les foules, les âmes et les animaux. S’en faire compagnie. Des amis plus vrais que les vrais. Des choses plus vivantes que la vie. Reculer le sommeil. Manger encore les pages d’une histoire infinie. Et puis une lumière s’allumait. On entendait des pas. Quelqu’un dans le couloir. Éteindre. Remonter. Faire semblant de dormir. D’être un enfant normal. Se cacher le cœur. Sentir le livre impatient à nos pieds, la lampe, la chaleur. Fermer les yeux pour de faux. Écouter. Retenir son sang. On entendait des pas. Quelqu’un dans le couloir. Une lumière s’éteignait. Replonger au fond du lit, la tête à l’envers. Gourmandise des heures volées. Des secrets. Cachette. Trouver la page. Voyager. Dire aux mots qu’on ne les oublie pas. Rassurer nos compagnons de nuit. Partir dans le noir sans savoir. Saveur des livres qui parlaient notre langage. Qui chuchotaient un monde si connu. Qui laissaient naître qui nous étions. Nous nous comprenions si bien. Là-bas, sous la langue, dans un lit, derrière des draps, j’étais chez moi. Je dérobais des silences. Souvenirs d’un temps sans temps. Enfance. Je cueillais les choses perdues. Les abandonnées. Les choses délaissées. Cailloux, coquillages, bouts de bois. Je vivais dans un monde sans monde. Feuilles poussiéreuses au bord d’une bibliothèque. Je ramassais des trésors. Je les mangeais. Je les mangeais. Je les mangeais. Je dormais le jour quand les vivants étaient si là. Enfance. Se cacher. Lire la nuit. Entrer dans sa profondeur d’étoiles. Découvrir un autre monde. Souterrain. Soupirail à soupirs. Le centre de la Terre. Flotter dans le vent. Déglutir les mots. Boire les secrets du jour glissés derrière. Enfance.
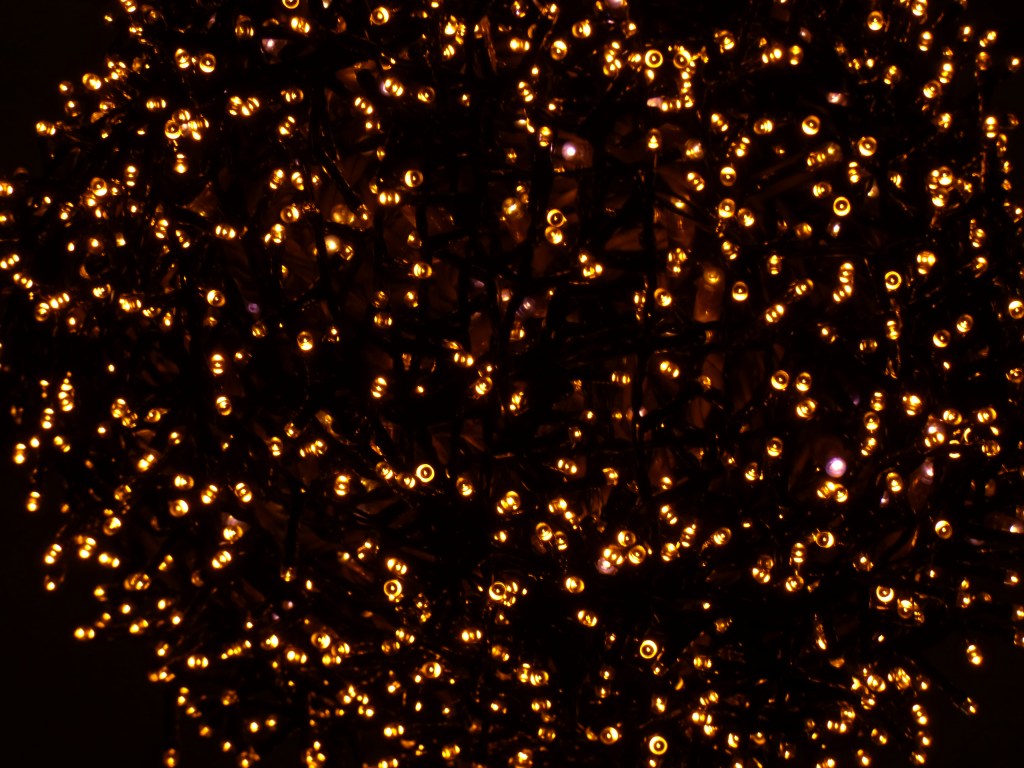
Déconfinement Covid-19 / 3 juin 2020
Jour 24
Champ d’oliviers. Au pied d’une montagne. Se blottir dans l’ombre. Faire comme si on n’était pas là. Immobile présence. Se demander comment c’est sans nous. Sentir. Fleurs jaunes hautes et fières. Le goût du sucre. Comprendre les abeilles. Devenir un arbre ou un caillou. Un bout de terre en attente de pluie. Devenir un regard, une écoute, un silence. Insectes. Il est 16 heures et plus rien n’a d’importance. Le chahut du vent. La pause du papillon. Soleil entre les feuilles et ses dessins dentelles. Ses obscurités de lumière. Ce qui bouge sur la peau. Ce qui tangue. Ne rien retenir. Perdre notre vie d’homme. Ne rien retenir. Être. Tendresse pour ce que le temps déroule. Se laisser laper par le bruissement du monde. Sourire. Entendre le passage des bourdons, des clartés, des humains. Des voix qui disent des mots au loin. Des choses ignorées. Cachette. Ce qui ne se voit pas, existe-t-il vraiment ? Moi. Appartenir au tronc de cet olivier. Appartenir à ces années de labeur pour grandir. Glisser ses racines sous les pierres. La terre est chaude, rouge et solide. Épouser les fêlures. Les choses cassées tombées au fond, tout au fond. Embrasser les falaises souterraines. Gouffres. Abîmes. Précipices où égarer ses dents. Ces morceaux blancs de nos enfances. Ceux qu’on gardait dans une boîte. On ne sait plus où on l’a mise. Enterrer nos ossements inutiles. Vieux. Poussiéreux. Les rendre. On n’en a plus besoin. Champ d’oliviers. Débris ou ruines. Maison abondonnée faite de pierres et de terre. Le temps. Grandir là. Vivre là. Dans les draps du présent. Dans la blancheur des jours francs. Être de passage. Oiseau sur la route du soir. Être ce qui bouge, ce qui tangue, ce qui ne retient rien. Bourdon, clarté ou ombre. Fleurs jaunes. Silence insecte. Dentelle.

Déconfinement Covid-19 / 2 juin 2020
Jour 23
Anniversaire. On se prépare à fêter la naissance de quelqu’un. Venu au monde il y a longtemps ou pas trop. Arrivé sur terre dans son habit de sable. Chose légère qui se tient à peine dans les bras. Fantôme porteur du monde d’avant. D’où vient-il ? Quelqu’un sorti d’un corps. On ne connaît pas son origine. Son jardin secret fait de pierres et de feuilles. On ne connaît rien de son voyage jusqu’à nous. Anniversaire. Préparer un gâteau. Le faire soi-même. Choisir des cadeaux. Des surprises pour aimer. Chaque année on honore le mystère d’une arrivée. On compte le temps. Le sable est devenu caillou puis montagne. On peut toucher ce miracle. On peut entourer ses épaules de notre chaleur. On regarde cette profondeur. On rit. On ne sait rien de cet être de lumière. On côtoie des gouffres et des ciels. On cherche les bougies. On a mis nos beaux habits. On a choisi les assiettes colorées. On sait qu’il y aura des rires, des gens, des clartés. Il y aura des attentes. Des bousculades. Des yeux ouverts. Des plaisirs partagés. Il y aura des silences tout petits. Des mots grands. Plein de mots. Il y aura des gestes. Des mains sur une nuque. Des rires dans les cheveux. Du chocolat sur la joue. Des courses poursuites. Tu te rappelles ? Souvenirs de moments coincés dans nos temps mélangés. Papiers cadeaux. Fruits d’été. Les amis. Tissus étalés sur l’herbe des parcs. L’espace entre nous. Tout ce que nous ne savons pas. Le cri des enfants. Les absences. Les jours où on s’est fâchés. J’en veux encore. Les soirées au bord de l’eau. L’inconnu de nous. Merci. Se retrouver. On a changé. Tenir l’ancien. Joyeux anniversaire ! Un fil dans nos doigts. Un pont. Entre hier et aujourd’hui. Une construction fragile et délicate. Une dentelle éphémère. Tricotée de poussières de nous, de morceaux qu’on a gardés, de débris qu’on n’a pas voulu laisser partir. Rivière de nous, vivante et morte. Illusion d’une permanence. Et l’histoire comme un hiéroglyphe. Quel âge ? Nager entre deux rives. Qui on a été. Qui on est. Et avant ce jour, qu’étions-nous ? Avant notre naissance ? Tout ce qu’on ne sait pas dire.

Déconfinement Covid-19 / 1er juin 2020
Jour 22
Quelque chose nous a changé à l’intérieur. Nous a sidéré ou quelque chose comme ça. Cœur pétrifié qui a besoin de temps. Quelque chose s’est arrêté. De battre, de vibrer, de danser. Ça a retenu notre bouche, notre horizon. Ça a coincé notre gorge. Les mots ne pouvaient plus sortir, se donner, se dire. Mutisme des jours. Ils erraient à l’intérieur. Ils étaient surpris et apeurés. Ils étaient tristes et mélancoliques. Les mots rêvaient de temps anciens. Quand on pouvait courir et chahuter. Quand on partait se cacher pour jouer. Quand on criait « je suis ici » de peur qu’on ne nous trouve pas. Quand on fermait les yeux pour compter. « J’arrive ! ». Quand on partait seul et qu’on voulait rencontrer d’autres mots. On se baladait. On écoutait le silence. On tenait les minutes par un fil. On savait patienter. On savait ne pas venir tout de suite. Les mots. Chantaient leur chanson. S’allongeaient sur le bout de la langue et prenaient tout leur temps. On oubliait et ce n’était pas grave. « Comment ça s’appelle ? Tu sais, le truc ? Oh ! Ça reviendra plus tard ! ». Et maintenant, on ne jouait plus. On oubliait pour de vrai, pour toujours. On oubliait comment on s’appelait. On oubliait les noms, les mots. Quelque chose nous avait changé à l’intérieur. On perdait le sens, l’ordre du temps. On perdait le goût des choses à mettre dans le monde. Ouvrir la porte. Prendre sa voiture. Faire ses courses. Travailler. Répondre aux messages. On restait regarder une tache de lumière se promener avec le vent. La forme des nuages. Le bruit des arbres. Tout était si important. Tout était si vivant. Tout était si nous. Les mots s’éloignaient ou étaient inaccessibles ou étaient inutiles. Nous vivions, derrière une porte, dans le silence. C’était notre nouvelle maison. Un abri. Encore un peu de vent et d’oiseaux. Encore un peu d’arbres. Les yeux fermés. Je suis ici. La solitude. L’oubli. Le souvenir. Mémoire ancienne. Nous allons où nous avons toujours été. À l’intérieur. Dans le cœur pétrifié du temps. Dans l’étonnement de l’insu. Carapace de ville dénudée. Pays montagne. L’incertain habite là. Miracle des jours où se rencontrer. Mélodie douce de l’instant. Pleurer de ce paysage. Pleurer d’une beauté permanente. Émerveillement.

Déconfinement Covid-19 / 31 mai 2020
Jour 21
On est reparti s’enfermer pour trois jours. Sans enfants, sans chien, sans chat, sans poisson rouge ! Rester à la maison comme dans sa grotte d’or. Les hommes sont loin. On a ouvert la fenêtre. Le vent. Les cloches. Les oiseaux. Un bruit de vie, au bout du ciel. Le soleil entre. S’enfermer pour trois jours. Ou peut-être sortir demain ? Parce que les arbres. Parce que les montagnes. Cuisiner. Chanter dans le salon. Écrire. Regarder ce qui traverse notre carré bleu. Respirer. Écouter. Des voix dehors. Des interpellations. Tu vas bien ? Et la famille ? Et les enfants ? Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vus ! Des gens qui parlent de politique ou de vacances. Partir ? Aller où ? On a le droit ? Parler à ses plantes vertes. Surtout la nouvelle : une azalée magnifique offerte par Hermine. Couverte de fleurs roses. De l’eau ? On a ouvert toutes les fenêtres. Il fait beau. Dedans aime ce qui vient. Le cri des pies. Le balancement des fleurs. Magnolias. L’ombre. Une musique de piano habite nos jours. S’enfermer c’est vivre avec ceux du dehors. Traversées d’ailes. Ébruiter les rêves. Dormir avec des singes ou des moutons. Des gens autour de tables. Des accordéons. C’est s’arrêter au bord des immeubles. Tomber dans des jardins. Étirer la nuit pour danser encore. Ne plus compter les heures. Ne plus savoir compter. Donner. Donner nos mains à des passants. Des capes. Des filles blondes et on ne les connaît pas. Songes d’étoiles. Coller nos fronts aux fronts des autres. Rester là, dans un silence plus grand que nous. Rencontrer Albert Camus. Savoir que c’est exactement ça. Oui, l’amour. Une chose où s’allonger tout entière. Une lumière insensée, infinie, immobile. Mirage de l’obscurité. Un endroit où d’anciens amis nous serrent dans leurs bras. On nous offre des gâteaux. On nous entraîne vers des champs, des voitures, des chemins. Des gens morts arrivent aussi. On leur parle. On a peur d’être en retard. On rencontre des renards. Des ours. On traverse des villes. Des êtres nous disent des choses que nous ne comprenons pas. On se réveille.

Déconfinement Covid-19 / 30 mai 2020
Jour 20
Tout revient si vite. Les courriers dans la boîte aux lettres. L’école. Le travail. Les mails nous demandent de nous inscrire. Ou de répondre rapidement. Ou de télécharger le document. Tout nous appelle. Tout nous happe. Nous répondons à ces sollicitations. Nous notons le jour. Nous écrivons, dans notre agenda, qu’il faudra téléphoner pour. Et le prochain rendez-vous. Et ne pas oublier de. Le monde d’avant arrive. Cogne à notre porte. Il a peur qu’on l’oublie, qu’on le remplace, qu’on le transforme. Il réclame sa part. Il manifeste sa présence. Il dit qu’il faut faire vite. Que la date butoir. Que c’est urgent. Que passé ce délai on ne pourra plus. Le monde d’avant. On le pensait perdu ou tout petit. On le pensait réduit ou dépassé. Il dit. Et nous écoutons sa chanson de ferraille. Sms. Mails. Appels téléphoniques. Courriers. Répondre. Lire. Constituer le dossier. Prévoir. Noter. Envoyer. Inscrire. Photocopier. Écrire. Se connecter. Se tenir au courant. Remplir les cases. Connaître son mot de passe. S’adapter. Déposer le document. Réfléchir mais vite. Tenir son agenda. Réserver. Organiser. Fermer l’enveloppe. Le monde d’avant, il est là, maintenant. Tout s’ouvre et aussi tout se ferme. Les magasins et la lenteur. La Poste et l’intériorité. Les restaurants et la contemplation. Les routes et l’immobilité. Le vacarme et le silence. L’agitation et l’être. La consommation et la sobriété. La foule et la solitude. L’inconscience et l’observation des oiseaux. Il dit. Et nous écoutons ses mots de brume. Nous suivons son bruit de chute d’eau, son bruit assourdissant. Nous dévalons des rues comme des chevaux affolés. Nous courons vers ce que nous connaissons. Ce qui remplit. Ce qui empêche de réfléchir. Ce qui nous prend en sa mâchoire et nous fait croire que c’est la nuit. Nous courons. Parce sinon. Il faudrait laisser le monde d’avant à sa place et fabriquer un monde d’après. Un sans savoir. Un sans assurance. Un sans consistance. Un monde, ailleurs, autrement. Et on ne sait pas. Et on ne sait rien. Et on ne sait pas comment faire. Et on ne sait plus tout à fait qui être. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Car on sait que le monde d’avant, on n’en veut plus.
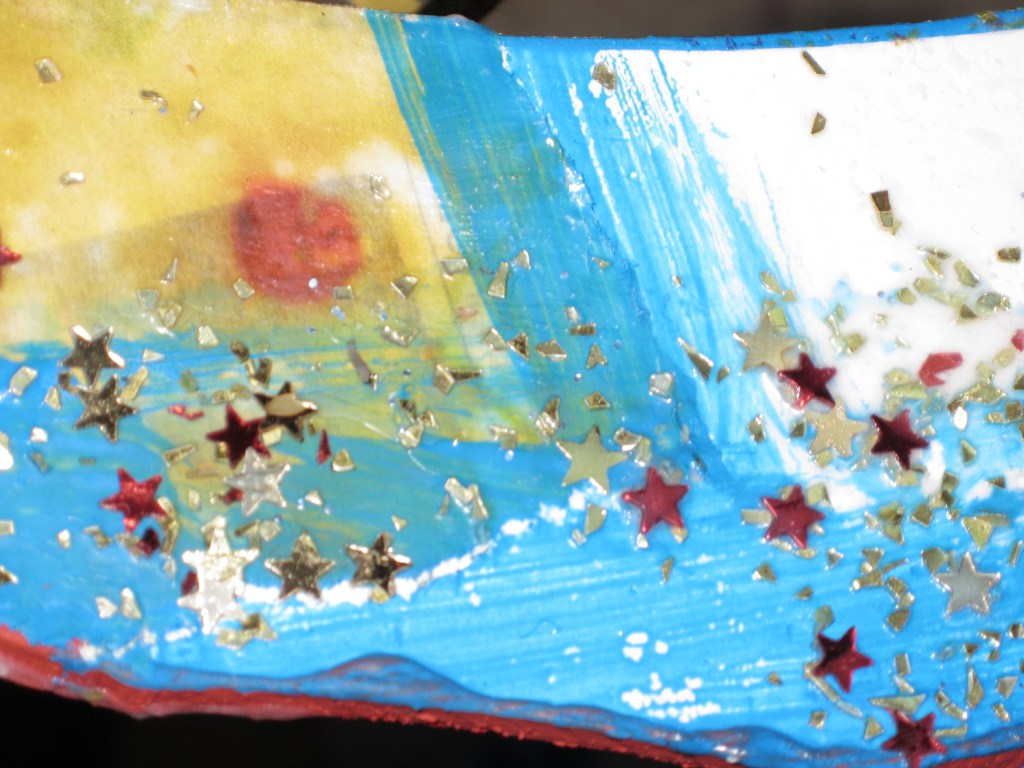
Déconfinement Covid-19 / 29 mai 2020
Jour 19
Se couper les cheveux. En quatre. En huit. En choses qu’on ne peut pas compter. Se couper les cheveux. Ce qui part de nous sans souffrance. Ce qui déroule des lianes de patience. Comme pousse l’herbe, la pluie, le vent. Infiniment. S’éparpille sur la terre. Une main. Chez le coiffeur. Une voix. Le son de la porte. Le parfum. On sait qu’on ressortira avec une nouvelle tête. L’élan qu’on avait perdu. On ne sait pas pourquoi. On retourne aux racines de nous. Notre jeunesse. Nos doigts sur un crâne. La dureté. La douceur. Tout revient. Les rides. Les cheveux blancs. De grands miroirs dans lesquels se voir grands. L’attente. La surprise. L’envie que quelque chose nous ressemble. Nous ? L’envie de découvrir nos yeux. D’allumer notre front. L’envie de beauté. De révélation. D’apparaître tout à coup dans le monde et c’est nous. C’est nous totalement. Que tout se voie, tout, vraiment. Ce qu’il y a à l’intérieur. Ce que l’on cache aux autres. Ce que l’on ne connaît pas de nous-mêmes. Se couper les cheveux. Faire de la place à la tendresse. Débroussailler. Débarrasser nos visages de tous ces murs. Éclairer nos joues d’enfance. La petite ride au coin des yeux. Tu sais ? Celle pour de rire. Tu sais ? La nuque offerte à la lumière. Et la blancheur de nos années. Et rire. Et courir dans la rue. Sauter pour attraper les arbres ou les oiseaux ou rien. Se couper les cheveux comme on prend un raccourci. Un chemin de traverse en bordure de jardins. Un endroit de silence. Comme on goûte la confiture avec son doigt. Comme on écoute les grenouilles, la nuit. Une chose d’enfant. Un secret. Une toute petite ruelle qu’on ne connaissait pas et on ne sait pas où elle mène. On l’emprunte. On explore. On se laisse attraper par les odeurs de fruits et de fleurs. On croit être chez quelqu’un, avoir franchi un seuil, s’être trompé. On croit avoir touché la délicatesse. Celle des autres. La discrète. Et l’on arrive dans une vraie rue. Le bruissement du monde. Un instant, dans le miroir de ce jour, on a cru se rencontrer.

Déconfinement Covid-19 / 28 mai 2020
Jour 18
Tenir le vent. Ouvrir la bouche, comme ça. Patience de sable. Quand la pluie est partie vivre ailleurs. Quand, derrière le bleu, des ruisseaux se rassemblent. Tenir le vent. L’accueillir au palais. Enclave douce et généreuse. Se coucher dans un champ. Accepter le sommeil du soleil. Ce qui bouscule les forêts. Ce qui secoue la chevelure des femmes. Offrir une maison aux tornades. Aux déluges de lumière. Tenir le vent et ce qu’il transporte d’espoir et de graines. De choses à naître. Celui qui déplace des montagnes. Celui qui déboussole des pays. Celui qui traverse. Il parle toutes les langues. Il vit de saveurs et de fruits. De feuilles de menthe et d’origan. Il plante des arbres. Il fait ça toute la journée. Toute la nuit. Il sème des vagues et des silences. Tenir le vent. Celui qui parle à l’oreille du monde. Celui qui chante. Caresse la fourrure du renard. Défait des branches pour que chacun se fabrique un nid. Chaque pie ou chaque pigeon. Celui qui pousse les nuages. Qui ramasse la toison des incendies. Qui retient ce qui tombe. Qui déforme les fleuves. Qui construit la fontanelle des peuples. Vent ou poussière. Transparence des jours. Invisible danse qui chahute ce qu’elle touche. Chose têtue, indisciplinée. Habite la sève et le miel. Celui qui nous donne des contours. Qui entre par la fenêtre ou par la porte. Qui inquiète l’essaim des heures. Qui affole les chemins. La mer n’est pas loin. Tenir le vent. Sa joie souveraine. Ses enfants qui courent. Ses oiseaux qui volent. Héberger, dans sa bouche, un instant, les bourrasques et les bruissements. Ce qui est sans naissance et sans mort. Ouvrir une ruche à ce qui brille. Ce qui contient le monde. Offrir une cabane mouillée à ce qui ne se voit pas. Qui perd son origine. Qui perd son horizon. Qui tourne, glisse, rencontre. Qui sait. Qui ne sait plus. Virevolte, fonce, flotte, frise. Tournoie et rampe. Fouille, échappe, tend, penche. Ondule, tord, déstabilise, hérisse. Sur la langue sentir un bout de vent. Un goût salé. Un goût de terre. La saveur du voyage, de ce qui ne se voit pas. De ce qui vient dans les rêves. De ce qui s’étiole et se déprend. Patience de sable. Rencontrer l’infini de nous. La disparition et l’éclosion. L’absence et le présent.
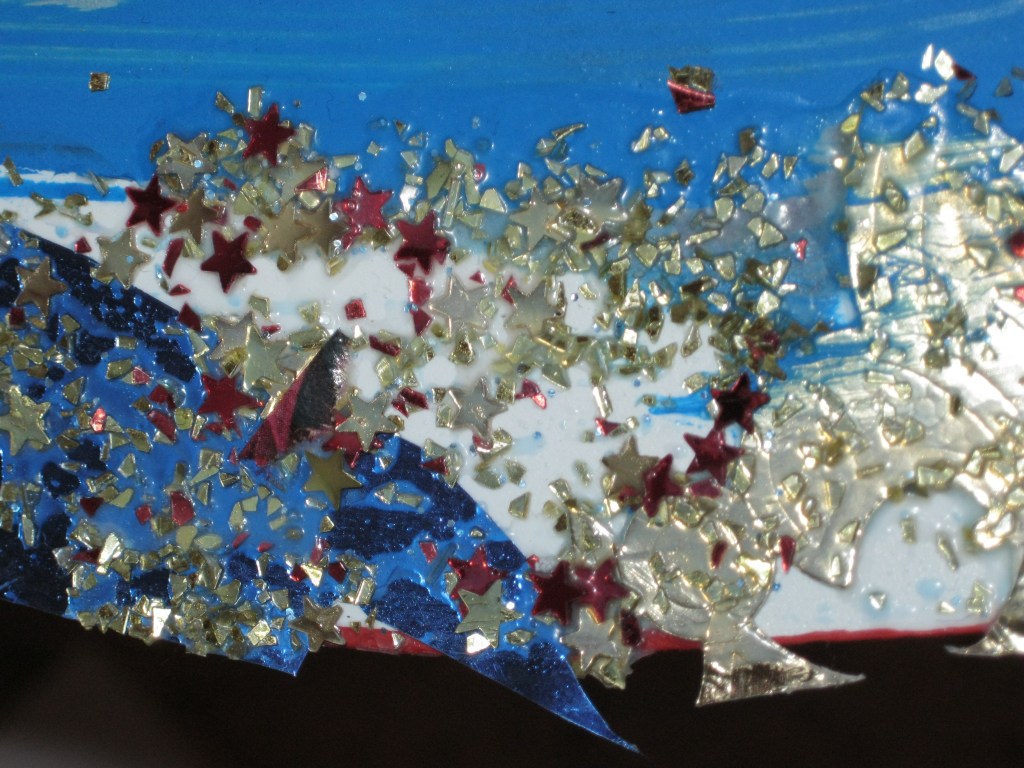
Déconfinement Covid-19 / 27 mai 2020
Jour 17
S’asseoir sur l’herbe d’un parc. Attendre quelqu’un. Fraîcheur. Ombre. Des voix, assises aussi. Des gens qui enfin se parlent en vrai. Se regardent. Des mains dans le vert. Arbres aux troncs amoureux. Des jeunesses bruyantes. C’est le presqu’été. La peau se promène sur des sentiers ronds. Des gens qui marchent, des gens qui rient. Et ceux qui promènent leur chien, leur solitude, leur vie. Attendre quelqu’un. Regarder passer le soleil ou les sacs. On se cherche. On a rendez-vous. On s’adosse aux nuages. On sourit. On lape l’air, le dehors, la liberté. On boit la balade des humains. On mâche ce temps de lait. Le souvenir de ce goût de parc. La joie des enfants. Leurs cris. Oui, il y a longtemps, tout était possible. Et puis tout s’est arrêté. Tout s’est amoindri. Tout s’est interdit. Et puis tout s’est autorisé. Tout s’est agrandi. Tout s’est recommencé. On avait le droit, de nouveau, de s’asseoir sur l’herbe d’un parc. On avait le droit. On n’osait à peine. Le grincement du portillon. Le bruit, après. Trouver un endroit. Loin des autres. Fraîcheur. Ombre. Trouver un endroit où laper l’air. Attendre quelqu’un. Les gens. Les sacs. Les rires. Ceux qui se cherchent. Ceux qui téléphonent. Ceux qui font leur circuit quotidien. Ceux qui parlent. Ceux qui dorment. Ceux qui jouent. Ceux qui hésitent. Ceux qui s’installent. Ceux qui lisent. Ceux qui baillent. Ceux qui boivent. Ceux qui courent. Ceux qui s’appellent. Ceux qui suivent les pigeons. Ceux qui choisissent l’ombre. Ceux qui s’adossent aux arbres. Ceux qui écrivent. Ceux qui rêvent. Ceux qui observent les fourmis. Ceux qui se perdent. Ceux qui préfèrent le banc. Ceux qui posent leurs sacs. Ceux qui accompagnent des enfants. Ceux qui ferment les yeux. Ceux qui jouent de la musique. Ceux qui écoutent le train. Ceux qui éloignent les mouches. Ceux qui s’allongent. Ceux qui se déshabillent. Ceux qui regardent passer les nuages. Ceux qui écoutent. Ceux qui ont le temps. Ceux qui traversent. Ceux qui trottinette. Ceux qui vont travailler. Ceux qui chantent. Ceux qui regardent. Ceux qui paressent. Ceux qui mettent leurs lunettes de soleil. Ceux qui respirent. Attendre quelqu’un.

Déconfinement Covid-19 / 26 mai 2020
Jour 16
Douceur. Douleur. Une lettre à changer pour deux mondes. Quitter la douleur. La noirceur. Quitter une nuit sans étoiles. Une épaisseur ténébreuse. C’est comme marcher avec ses mains devant. À tâtons. Glisser ses pieds au sol, les enfoncer pour anticiper les failles. Fissures ou interstices. Petites choses où tomber. Où dérober nos corps. Oui, enlever nos robes jusqu’à la limite de nous. Nudité amincie. Enlever encore. Gouffre tentacule. Bouche avaleuse. Trou. Endroit où tomber. Tomber entièrement. Tomber comme quelque chose qui ne s’arrête pas. Douleur. Une circonstance. Dévaler des montagnes. Des hauteurs inouïes. Être aveugle devenu. Le corps échappe. Vertige. Égarement. Le noir absorbe, aspire et noie. Tomber devant mais en arrière du temps. Oui, derrière des penderies, des manteaux passés, des choses d’hiver. Une saison oubliée sous la poussière des jours ou des années. Derrière le givre. Derrière la glace des cœurs. Quand la respiration s’est arrêtée. Quand on vivait sans vivre. Avant. Douleur. Et puis remonter à la surface. On ne sait pas comment on fait ça. On le fait. Une lettre à changer pour deux mondes. Quitter. Remonter. Légèreté. S’éloigner des nuits. Des choses se détachent. Des choses chancellent. Des choses tremblent. Chavirent des tissus usés comme des peaux. Remonter à la surface. S’alléger des fissures. S’alléger des gouffres. Des bouches. Des trous. On ne sait pas comment. Se pleuvoir. Douceur de l’eau. Ce qui ruisselle. Ce qui renonce. Pleurer. Se laver des jours sombres. Nager. Voler. Chaque plume naît d’elle-même. Prendre un corps volatile. Devenir. Transparence des passages. Traversée. Visage ouvert et franc. Retourner ses mains, ses pieds. Bruissements. Crépitements. Avancer vers une clarté. Un soleil. Lumière éblouissante. Voir. Rire. Douceur. Remonter à la surface. Le cœur. Le corps. Épouser. Danser. Ce qui vole. Ce qui brille. Vivre sur l’herbe du temps. Douceur. Se tenir debout.

Déconfinement Covid-19 / 25 mai 2020
Jour 15
On pourrait garder ce qu’on a trouvé. L’endroit où l’on s’asseyait pendant deux mois. Où l’on dormait avec le temps. Où l’on embrassait la lenteur, et puis parfois on la prenait dans nos bras, et puis parfois on lui chantait une chanson. On pourrait retrouver notre enclave magnifique. Un terrier couvert d’or. La sensation de vivre dans le soleil. Et puis les bruits éloignés du monde. Et puis les hommes ralentis et clairsemés. Et puis soi dans cet embryon de maison. On pourrait garder. Notre descente dans la terre. L’odeur de la pluie. Son langage de fleurs et de feu. Le soulèvement des cœurs. Et notre corps enraciné. Et nos os reconnus. Ce qui fait montagne en nous. Ce qui fait rivière. Ce qui fait puits. On pourrait vivre là toute la vie. Tenir ce pays dans ce qui court autour. Tenir cette respiration. Être de passage. Être clandestin. Être un contrefort qui voit haut, qui voit loin. Sourire de nos différences. Regarder ce qui va. Danser une autre danse. On pourrait. Entendre encore les pies. Attraper les écureuils dans notre regard, ou les chats ou les renards. Dormir dans notre creux d’or. Faire des rêves de ficelles. Rêves de robes. Rêves de prairies et de balançoires. Garder ce qu’on a trouvé dans l’enfermement. Les passages du ciel. Les graines transportées par les oiseaux. Les cathédrales et leurs bras qui balancent des semailles. Garder le vent et ses humeurs soudaines. Ses éclats de voix. Ses turpitudes. Le vent et sa maison. Le vent et son horizon de feuilles. Retenir encore. Retenir par les yeux ou par les mains. Retenir par la bouche qui se souvient du goût des choses. L’épaisseur d’un fruit. L’épaisseur d’une lumière. Celle de l’attente. Celle du chemin encore à faire. À fabriquer avec nos petits doigts. L’épaisseur des nuits que nous gardons dans notre poche. Et quand nous marchons sur la terre dans ce monde affolé, nous touchons notre bout de nuit. Nous le faisons glisser dans notre main, nous l’étreignons pour ne pas perdre ce fil d’étoile. Nous le réchauffons. Et nous croyons détenir la nuit entière, toutes les étoiles. Et nous croyons détenir les planètes et les trous noirs. La profondeur de qui nous sommes. Oui, nous croyons.

Déconfinement Covid-19 / 24 mai 2020
Jour 14
Que nous est-il arrivé ? Comment avons-nous pensé gagner du temps en allant plus vite ? Et pour quoi faire ? Nous ne nous posons plus la question. Avant, oui, il y a longtemps. Des gens s’interrogeaient. Ils étaient encore si proches d’eux-mêmes. Si proches de la terre. Ils savaient. On les emmenait dans un rêve qui n’était pas leur rêve. Et ils y sont allés en regardant en arrière ce qu’ils quittaient. En hésitant. Que nous est-il arrivé ? Tout s’est accéléré et tout s’accélère. Nous sommes reconnus par cette société quand nous allons vite, quand nous faisons plusieurs choses à la fois. Conduire et téléphoner, parler et envoyer un texto, écouter une conférence et cuisiner…Nous nous démultiplions. Nous accélérons encore. Nous courons. Nous nous épuisons. Cela n’a pas de fin. Il y a toujours quelque chose que nous n’avons pas eu le temps de faire, quelque chose que les autres attendaient de nous. Il y a toujours quelque chose qui manque. Tout manque. Et nous courons. Après l’argent, le temps, le bonheur. Après une autre voiture, une autre femme, un autre enfant. Nous courons. Nous accumulons. Nous pensons que le poids d’une vie s’évalue. À la quantité de vêtements, de maisons. Nous comptons les nuits sans sommeil, les rendez-vous chez le médecin, les insatisfactions. Tout manque. Car c’est le rêve des autres. Moi, mon rêve, ça serait qu’on ralentisse. Qu’on freine. Qu’on s’arrête. Qu’on regarde le soleil dans les yeux. Qu’on s’aime assez pour dire non. Qu’on garde sa solitude, qu’on la garde précieusement. Qu’on embrasse le temps sur la bouche. Le temps des oiseaux et des lumières. Les heures qui ne font rien d’elles-mêmes. Les paresses. Des jours entiers à regarder, à écouter. Qu’on s’entende respirer. Qu’on redevienne humain. Qu’on vive au chant des clochers. Que tout prenne sens. Qu’on retourne cultiver nos jardins. Les trésors sous nos pas. Qu’on cueille ce qui naît à nos épaules. Et qu’enfin on soit riche. Et qu’enfin on soit plein. Que nous est-il arrivé ?

Déconfinement Covid-19 / 23 mai 2020
Jour 13
Quitter Shéhérazade. Dernier colis alimentaire livré dans deux jours. Maintenant, on est déconfinés. Il faut bien reprendre ses activités, ou son temps, ou sa vie. Il faut bien détricoter le fil entre nous. S’en aller. Se séparer de ce qui nous liait pour tenir debout. Oui. Nous respirions mieux de nous nourrir mutuellement. Nous avions des mots qui s’arrêtaient. Nous avions des regards qui allaient loin. Deux inconnues. Des existences côte à côte qui se penchaient. Comme fleur vers le soleil. Comme une pente naturelle au pied d’une colline. Cette chose qui nous entraîne à aimer. Qui nous porte. Un élan. Une musique. Cette chose qui ne réfléchit pas, qui ne compte pas le temps que ça va prendre. Cette chose qui n’habite pas dans la raison raisonnable. Non. C’est ailleurs. C’est dans une poésie d’oiseau. Ou peut-être dans le vent. Dans ce qui germe. Dans ce qui danse. Chose insaisissable. Faite de lumière et de paille. Peut-être on ne savait pas faire autrement. Peut-être. Apporter à manger pour la dernière fois. Savoir qu’on est de passage dans la vie de l’autre. Juste de passage. Une traversée. Une rencontre éphémère comme notre cœur. Fragment de vie sur une photo. On était bien. On était là tout entière. Quitter Shéhérazade. Garder trace d’elle. Laisser vivre sa part en nous. Partir dans la vie en tenant dans sa main fermée son regard. Ce qui parle une autre langue. Ce qui est profond comme la nuit. Ce qui tremble et ne sait pas se dire. Une dernière fois. Apporter le sourire du monde. Le don des autres, de tous les autres, rassemblé là. Se souvenir. Marcher avec ce qui fait nous. Ces rencontres improbables. Ces croisements magnifiques. Êtres entraperçus qui rejoignent leur rue, leur maison, leur vie. Se souvenir. Et puis, écrire des mots dans un cahier pour préparer son cœur à la séparation. À l’absence. Pour bricoler à l’avance ce qui nous attend. Anticiper le brouillard. Vivre avant le moment du rien. Quand il n’y aura plus son regard et ce qui est profond comme la nuit. Quand il n’y aura plus ce qui tremble et ne sait pas se dire. Devancer ce qui brise le silence et le constitue tout à fait. Des mots dans un cahier pour vivre ce que nous ne comprenons pas. Qui pourrait nous faire pleurer, nous faire glisser loin des choses de lumière et de paille.

Déconfinement Covid-19 / 22 mai 2020
Jour 12
J’ai rencontré une femme enceinte. Elle portait le monde dans le monde. Elle traversait les virus et les places publiques. Elle traversait le ciel. Elle marchait. Une robe à fleurs échappée du désastre. Des yeux rieurs, insouciants et tenaces. Elle attendait la vie qui viendrait bientôt. Elle accomplissait son miracle sans le savoir, sans le penser. Elle était ce miracle. Miracle de chair. Lumière préparée à l’avance. Comme une surprise et l’inconnu. Comme ce qui est là depuis longtemps caché au cœur des choses. Ce qui existe est-il toujours visible ? Il y avait de la transparence en elle. Une grâce insoupçonnée. Un geste ralenti comme une chanson qui prend le temps des mots. Une chose à l’abri. Loin des regards et tout dedans. La joue des dimanches. Les siestes sous les arbres. Les paniers de fruits. Il y avait elle et ses deux cœurs. Ses battements accordés au sang. Son eau profonde. La rondeur d’un soleil. Je me suis demandé comment la vie pouvait traverser la mort. Comment mettre au monde dans ce monde-là. Quand on compte ce qui meurt chaque jour. Quand on compte ceux qui meurent. Quand on nous interdit de sortir. Quand on nous montre des photos d’un virus ravageur. Qu’on nous dit qu’il nous attend tapi sur nos poignées de portes, nos interrupteurs, nos clés de voiture. Déposé sur nos canapés, nos boîtes de conserves, nos légumes, nos bitumes. Caché sur nos mains, nos cheveux. Et que maintenant, on peut de nouveau sortir. Sortir masqués. Qu’il ne faut rien toucher. Que le virus peut entrer en nous et faire des dégâts considérables. Par les yeux, le nez, la bouche. Par une transmission d’humains. Une femme enceinte dans ce monde méfiant et infesté. Distanciation sociale, gestes barrière, masques. Et il faudrait porter sa robe à fleurs dans ce qui s’écroule. Dans l’incertain de l’après. Rire. Tenir sa rondeur dans des angles morts. Choses invisibles qui nous attendent au coin des rues. Échapper à ce qui nous guette, nous attaque. Marcher joyeusement avec un petit corps dans son corps. Boire le soleil. S’inventer une prairie où vivre. Chanter dans les villes. Une lumière dans la nuit. Dans ce qui ne se sait pas.

Déconfinement Covid-19 / 21 mai 2020
Jour 11
Sentir le cœur des choses battre encore. Ouvrir ses volets. S’accouder au bord du monde. Rester dans des heures qui restent aussi. Respirer le chant des oiseaux. La tête verdoyante des rues. Embrasser du regard un peuple volatile. Une couleur. Une présence bleue et le ballet des papillons. Vivre avec le vent. Parfois s’asseoir au front d’une fontaine. L’eau. Le soleil contenu dans la transparence. Baigner ses mains à la fraîcheur de l’ombre. Ce qui vient des sommets et des neiges éternelles. Ce qui a beaucoup voyagé. Ce qui a rencontré des racines ou des pierres détachées. Ce qui a été bu par la terre. Ce qui a été recraché par les nuages. Pluie d’orage une nuit pour nourrir tant de sources. Parfois s’adosser à des montagnes velues et sauvages. Des majestés collées au ciel. Des maisons d’abeilles et de renards. Grottes. Lacs souterrains. Des senteurs de thym et de champignons. Des choses infranchissables dressées. Des stabilités blanches. Plissements du temps. Posons nos mains. Elles seront gardées par la pierre, gardées pour l’éternité. Posons nos mains. Nous reviendrons les chercher plus tard. Quand le soleil descend. Quand le soleil monte. Et c’est pareil. Quand le blaireau dort. Quand le cerf cherche de quoi manger. Sentir le cœur des choses battre encore. Parfois s’allonger dans des rêves. Des beautés blondes et pleines de fleurs. Des sommeils sous les arbres. Dans des jardins d’aromates. S’endormir plusieurs fois sur les ailes des cigales. Les étés naissants et leurs robes gourmandes. L’odeur des foins. La chaleur qui monte de la terre. L’espace tremblé entre l’horizon et un autre horizon. Ce qui tombe dans le bleu. Ce qui est mangé par le chemin. Tu sais, celui qui serpente et se perd. Tu sais ? Ce chemin-là. Et se perdre avec lui. Ne plus connaître sa maison. Tout est maison. Parfois habiter un bruit. Une chose dont on ne connaît pas le nom. Le laisser venir. Le laisser nous habiter aussi. Le suivre où il va que nous ne savons pas. Devenir ce bruit. Cette chair inconnue et tendre. Qui tient ce qui marche et ce qui vole. Qui tient ce qui rampe. Ce qui saute, ce qui roule. Ce qui brille. Ce qui traverse. Ce qui ondoie. Ce qui creuse, ce qui nage. Ce qui bat. Serait-ce le chant du monde ?
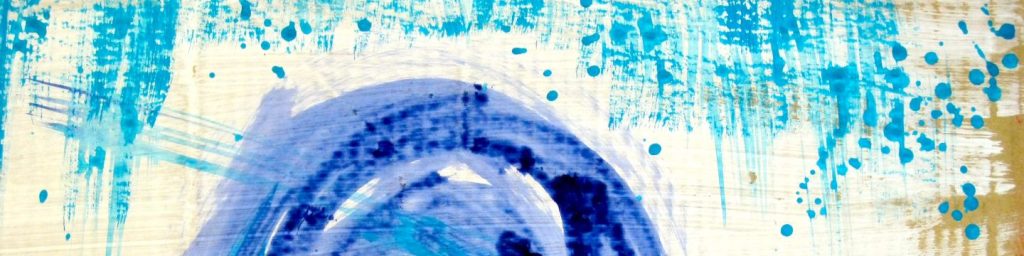
Déconfinement Covid-19 / 20 mai 2020
Jour 10
Écureuils absents. Je regarde l’arbre d’en face. J’attends. J’écoute les bruits de grignote. Je ne bouge pas pour voir bouger le monde. J’attends la présence flamboyante de l’écureuil. Rapide. Agile. Sautillant. Le bondissement d’un ventre blanc. Et puis sa façon de prendre les pommes de pin dans ses pattes. Sa vélocité. Sa vivacité. J’attends l’accélération. Le saut de branche en branche. Cette grâce animale. On prend des risques. On atterrit sur une vague penchée, fragile. On est trop lourd. On s’élance. On danse avec le vent. On joue. On déguste. Graines décortiquées. On est gourmand. On ébouriffe les pigeons. On gambade. On passe d’arbre en arbre. On vole. On grimpe. Tout en haut. On écarte les pattes pour saisir ce qui se mange. On tient. On repart. On virevolte. On fait le chemin dans l’autre sens. On rentre. On déguste. On dévale. On plonge. On s’accroche. On sautille. On cabriole. Écureuil limpide comme un enfant. Chercher ce qui brille. Ce qui se plante et germe. Libre et joueur. Écureuil aventureux. Intrépide. Curieux. Attraper le soleil, le vert des branches. Attraper l’écorce des dimanches. Cacher ses noisettes. Ne plus savoir où on les a mises. Planter des arbres comme on plante des rires. Et puis vivre dans un autre creux, une autre forêt. Batifoler. Courir. Embrasser le soleil. Transporter sa lumière. Le dos des voyages. Ce qui ne se retourne pas. Une enfance de rivières. Une ronde d’hirondelles. Des amis sur chaque feuille. Il est quatre heures à chaque heure. Sourire le matin. Les cheveux dans le bleu. Habiter dans un chêne. Ne pas vouloir descendre quand maman nous appelle. Cachette de ciel et d’étoiles. Laisser tomber ses bras et ses jambes. Le ventre du temps nous porte en ses mâchoires. Comme on porte son petit pour le mettre à l’abri. Le tenir derrière, là où ça ne fait pas mal. Marcher dans la bouche des peupliers. Partir comme on dort. Bercer ses minutes de sève. Compter les racines ou la nervure des feuilles. Rire. Fabriquer un silence de saison. Écureuil ou enfant. Ce qui ne se retourne pas.

Déconfinement Covid-19 / 19 mai 2020
Jour 9
Aujourd’hui, j’ai fait des courses alimentaires à Hermine. Elle commence à sortir petitement depuis le déconfinement. Elle sort tôt le matin, passe dans les rues désertées. Elle porte un masque, bien sûr. Elle hésite encore à reprendre sa vie d’avant où, depuis son appartement du centre ville, elle accédait facilement à tous les commerces. Avant. Avant, dans le monde sans danger, elle était autonome. Elle circulait librement. Elle marchait beaucoup, dit-elle. Elle allait voir la vie de près. Elle côtoyait les sourires, les voix chaleureuses qui la reconnaissaient. Elle avait ses habitudes, ses routines. C’était comme des rendez-vous. Il y avait la boulangère, le pharmacien et la caissière. Il y avait le voisinage poli et rassurant des autres. Un circuit de ruelles. Des éclats de soleil à la croisée des fontaines. Le marché. Elle allait voir la vie de près, et même, parfois, elle avait l’impression d’en faire partie. Avant. Hermine se lève à 6h30. À 8 heures elle arpente la ville. Elle fait son heure de marche quotidienne. Elle déambule dans les ruelles vides. Elle s’éloigne des vivants. Elle tient à distance les regards et les sourires. Elle tient à distance les corps de bras et de mains. Les choses douces et chaudes. Hermine a peur. Si elle attrape le virus, elle meurt, dit-elle. Elle se faufile au bord des portes et des fenêtres. Elle glisse. Ombre légère, fine, si fine, un vent pourrait l’emporter. Une toux. Un poumon encombré. Elle s’immisce dans les absences des villes. Endroits inhabités, oubliés des passants. Heures perdues dans le sommeil du monde. Ce moment du commencement. Quand se lève une brume avec une odeur de pluie. Quand se prépare toute une journée de soleil. Ce début d’un jour à peine entamé. Elle est à la frontière. Une dentelle délicate sur le point d’apparaître. Mais non. Elle porte un presque corps, presque visible, un presque bruit de pas. Fantôme. Une transparence dans la voix. Furtive. Elle se cache. Elle cherche l’absence, le rien. Elle cherche la disparition. L’oubli. La mémoire. Et puis elle rentre en cachette. Elle s’en va vivre dans l’ombre du jour.

Déconfinement Covid-19 / 18 mai 2020
Jour 8
Inverser la pluie. Retourner à l’endroit où naissent les nuages. À l’origine de toute chose. Descendre dans notre naissance. Dans la noirceur des choses fermées et leur transparence de peau. C’est rouge. C’est rond ? C’est mouillé. Descendre encore sous le carmin des membranes. Sous les battements. Inverser la pluie. Arriver à avant notre naissance. Avant ce corps et celui de l’autre. Tomber avec des boucliers. Champ de bataille. Paysages sans pays. Des animaux tués attachés par des cordes. Fourrures providentielles. Feux qui éloignent le sauvage. Chevauchées de jours et d’autres jours. Plusieurs soleils, plusieurs lunes. Descendre. Chasser. Apprivoiser les pigeons. L’aigle nous parle. L’ours. Des montagnes enneigées. Marcher. Porter. Vivre dans la forêt. Connaître les lacs poissonneux. Inverser la pluie. Des amphores et des parfums précieux. Le bain des femmes. La lumière des bougies. Le miel et l’amande. Potions de fleurs. Des chevelures à peigner. Des onguents. Chanter en déroulant le linge. Sécher les draps. Les poser dans le vent et attendre. Découvrir des jardins de fruits et d’ombre. Des palais où ruissellent des fontaines. Poser sa main sur la pierre chaude. Descendre. Connaître tous les oiseaux. Dormir dans un arbre. Se nourrir de baies. Connaître le guépard. Trouver l’eau. S’orienter avec les astres. Traverser des déserts. Des dunes de solitude. Connaître la soif. Connaître la faim. Abricot attendu dans les racines du temps. Inverser la pluie. Talisman donné à la naissance. Anneaux enchevêtrés comme le passé. Liens traversés. Fil. Un seul fil tendu à travers l’histoire. Je suis ces moments, ces empreintes déposées dans la boue des chemins. Je suis ce qui s’efface. Ce qui s’oublie pour être de nouveau. Je suis ce qui se décompose. Ce qui s’effrite. Ce qui se disloque, ce qui se démembre. Je suis ce qui tombe, tombe en poussière. Ce qui poudroie. Ce qui brille au lit des rivières. Ce qui s’ensable. Ce qui se terre. Je suis ce qui s’ébruite pour composer un chant naissant.

Déconfinement Covid-19 / 17 mai 2020
Jour 7
Les pies. Difficiles à observer. Volent, sautent, fuient, attaquent. Mauvaise réputation. Les pies des villes. Y en a-t-il ailleurs ? Elles font la loi. Contraignent les pigeons, poursuivent les écureuils. Inquiètent. Les morceaux sont pour elles. Les miettes pour les autres. S’accaparent. Prennent. Avec les pies, on ne discute pas. Tiennent tête. Se jettent sur celui qui s’est approché du quignon de pain. Tous s’écartent. Ils reviendront plus tard pour picorer ce qu’il reste. Les pies. Vont par deux. Je crois que je n’ai jamais vu une pie seule. Le cri reconnaissable. Est-ce un chant ? Une noirceur. Une idée de celui qui décide, qui prend, qui s’octroie. La meilleure part. Pas de partage, d’empathie. Pas de collectivité. Une personnalité forte, qui effraie. Que personne n’affronte, ne combat. On ne se confronte pas à la pie. On a peur. On s’en va. On accepte. La chance, ça serait d’arriver avant. Quand elle n’a encore rien vu. C’est rare et c’est pour peu de temps. Une noirceur. Une tristesse du plus fort. Une tristesse brutale. Pas de connivence. Pas d’échanges. Une supériorité, une suprématie. Je les regarde dominer leurs congénères. Choisir. Décider. Sauter. Imposer. Traquer. Poursuivre. Voler. Attaquer. Éparpiller. Marcher. Les pies. Elles me font penser à certains humains. Qui se croient différents, supérieurs, dans leur droit. Ceux qui affament et ceux qui piègent. Ceux qui violentent. Ceux qui font autorité. On ne se confronte pas à eux. On a peur. On s’en va. On accepte. La chance, ça serait qu’ils ne nous voient pas. Alors on se fait tout petits. Ceux qui enferment, ceux qui crient, ceux qui insultent. Ceux qui imposent. Ceux qui dominent. Ceux qui soumettent. Ceux qui triomphent. Ceux qui règnent. Il faut respirer moins. Il faut se réduire. Il faut s’amoindrir. Pour bricoler sa petite vie à l’abri. Échapper aux pies. Aux prédateurs. Vivre sous leur regard, tout dessous, où ils ne se penchent pas. Habiter sous la peau du monde. Tout dessous. Là-bas survivent d’autres, beaucoup d’autres. Une noirceur. Les pies. Pourtant elles s’habillent de lumière. D’un bleu profond et mordoré. D’un blanc éclatant. Elles sont faites de nuit. De choses qu’on croit dormir. Elles sont faites de mer. De ce qui s’agite sous la surface. D’une vie inconnue et vorace. De ce qui se cache. Elles sont faites de nous. Les pies. Ce sont nos ombres au bord du jour. Ce sont nos colères et nos impatiences. Nos volontés farouches. Nos frustrations. Nos fragilités. Nos peurs de ne pas en avoir assez. Nos instincts. Nos sauvageries oubliées au fond des couloirs. Nos vies primitives. Nos jardins violents. Nos incompréhensions. Nos brutalités fauves. Nos barbaries. Nos désespoirs. Parfois, sans doute, suis-je une pie. Une ombre au bord du jour.

Déconfinement Covid-19 / 16 mai 2020
Jour 6
Shéhérazade m’a préparé à manger. Une surprise. Un sac recouvert d’un torchon bien repassé. Des fleurs bleues. Une chose de Petit Chaperon Rouge. Un secret. C’était lourd. Et puis, après, la découverte. Une soupe aux épices. Je ne sais pas le nom. Délicieuse. Une salade fraîche. Tomate, poivron, concombre. Décorée : citron découpé et feuilles de menthe. Tajine sucré. Poulet, amandes, pruneaux, abricots à la fleur d’oranger. Et puis des boulettes de viande, des olives vertes, des carottes. Des feuilles de brick fourrées au fromage. Je ne sais pas le nom. Shéhérazade m’a préparé à manger. C’est pour me remercier de lui apporter son colis alimentaire chaque semaine. Des boîtes en plastique pour parler avec son cœur. Parce que, parfois, les mots ne suffisent pas, ou sont impuissants, ou sont trop petits. Les mots pour dire merci. Les mots pour dire ce qu’on ne sait pas comment dire. Ce qu’on ne sait pas. Parce que, parfois, les mots n’existent pas, ou sont cachés, ou on les a perdus. Les mots pour dire qu’on est troublé, ému, qu’on a envie de pleurer, de rire, de prendre dans les bras. Les mots pour dire qu’on s’aime. Donner à manger. Petit Chaperon Rouge. Traverser la forêt. Porter ce qui nourrit le ventre et le cœur. Rencontrer le loup. Rencontrer l’innocence et le sauvage. L’instinct des peuples. Marcher en chantant. Trouver ça important. Donner à manger. Ouvrir sa main. Offrir des secrets. Shéhérazade m’a préparé à manger. Des parfums de son pays là-bas. Du temps. Des attentions méticuleuses. Du soleil. Quelque chose de précieux qui se fabrique dans les cuisines. Qui rencontre, qui rassemble. Une pensée de l’autre. Une invitation. Ce qui danse dans les casseroles. Ce qui s’organise, se prévoit, s’attend. Ce qui mijote. On sourit, comme ça. On traverse la forêt. On compte les fleurs bleues. On parle avec un loup. On va quelque part car quelqu’un nous espère. On porte. On siffle. On est heureux. Donner à manger. Voir les yeux qui s’ouvrent et la porte. On arrive chez l’autre, les bras chargés. On est content de notre surprise. De notre cadeau d’heures patientes. On arrive avec un présent préparé. Nous, on sait. Une joie, un plaisir. Un peu de nous qui s’en va. Il n’y a pas de mots. Il n’y en a plus. Shéhérazade m’a préparé à manger.

Déconfinement Covid-19 / 15 mai 2020
Jour 5
Rencontrer son jour. Écouter une voix dans le téléphone. Quelqu’un se souvient de nous. Quelqu’un s’arrête dans notre sourire. Nous avons rendez-vous. Inconnu. Une éclaircie dans les heures qui viennent. Le cœur du silence entre les mots. C’est simple. C’est doux. Aventure qui ne se connaît pas. Attente. Des choses brillent dans notre chambre. Qu’y a-t-il d’autre de part le monde ? Savons-nous attraper ce qui flotte dans la lumière ? L’air poudré des chemins. La grâce d’une goutte d’eau. Savons-nous ? Tenir en haleine les bouches, les nombrils. Les endroits où naissent d’autres endroits. Rencontrer son jour. Les si petites choses si grandes. Les miracles vécus entièrement. Nous ouvrons délicatement nos regards immobiles. L’empreinte du vent s’assoit en nous. Les traces invisibles de la vie. Bruissements farouches et incertains. Passages d’insectes. Nous attrapons la rondeur d’un soleil. D’une larme. La profondeur de ce qui gît entre les pierres. Nous nous attardons à l’agitation des fourmis. Pattes de boue et de brindilles. Un dimanche d’arbres. L’éclosion des minutes sous la langue. Là où c’est mouillé. Là où l’on cache parfois des bonbons quand il faut parler et que l’on ne veut pas patienter. Endroit lisse. Bulbe naissant où se réfugie la paupière des lundis. Nid. Des oiseaux viendront bientôt chanter là, pondre, dormir ou vivre. Sous la langue. Des ailes ramassées pour des jours meilleurs. Des ventres. Un voile transparent. Une enclave absentée. On peut vivre sans y habiter. Et puis l’on découvre ce qui habite en soi. Ce qui nous fait nous. Rencontrer son jour. Sentir, contre ses dents, la chaleur des palais. Des châteaux. Des forteresses. Des pierres construites comme des cathédrales. La lumière éclatante. L’éblouissement de l’instant. Et tout ce qu’il contient qui bat comme un cœur sacrifice. Qui meurt. Qui vit. Qui hésite. Qui soulève des montagnes, des poitrines, des êtres émerveillés. Rencontrer son jour.

Déconfinement Covid-19 / 14 mai 2020
Jour 4
Sentiment étrange. Avant. Après. Et là, je suis où ? Je flotte. Je marche sur une surface. Un entre deux. Un endroit glissé. Une bordure. Je ne franchis pas tout à fait le pas de mon temps. Mon temps à moi. Mon maintenant. Je ne sais pas encore le faire. Je retrouve le monde et il a changé et j’ai changé. J’ai perdu mes repères. Mes repaires de chambre et de salon. Mes repaires de fenêtres. Je sors de chez moi. J’aperçois l’inconnu. Le presque connu mais pas pareil. Je regarde une ville que je connais que je ne reconnais pas. Je découvre des rues. Je suis une touriste. Je vois des choses qu’il n’y avait pas, ou j’allais trop vite, ou j’étais aveugle. Mon regard monte, s’étonne, s’aventure. Mes yeux partent en balade. Les bruits sont une substance dans laquelle nager. Oui, je nage. Tout a une épaisseur de forêt. Les voix, les bruits de circulation, les oiseaux encore. Des visages s’avancent. Je déroule mes jambes. Bobines étirées et pesantes. Le sol tient bon. J’attends au feu rouge. Je ne m’impatiente pas. Je savoure. Je suis intimidée par les autres corps. J’hésite. Tout est lent, calme. Tout pèse son poids. Chaque geste est une danse. Je ne vais nulle part. Je suis là. Je détricote l’instant. Je me pose. Je souris, comme ça. Le monde est un grand coton. Il entoure ce qui vit, ce qui va. L’air épais nous retient. Nous sommes debout dehors. Nous sommes sous le ciel dans une ville. Le mouvement des autres. Les piétons, les voitures. Des sacs. Des magasins ouverts. Le clocher de la cathédrale. Une porte. Le vent dans les arbres. Une ruelle. Du soleil. Le chuchotement des pas. Une vitrine. Des fleurs au balcon. Regarder les gens. Les aimer. Se tenir à l’écart. Ralentir. S’asseoir sur la margelle d’une fontaine. Attendre. Écouter. Voir son ombre. Admirer la Vierge à l’enfant au coin. Sentir les odeurs de cuisine. Le vent dans nos cheveux. Regarder la vie passer. Ses sacs, ses mains tenues, ses conversations. Sa silhouette, sa démarche, sa direction. Où va-t-elle ? La vie. Ses enfants, ses vêtements. Les choses sucrées qu’elle goûte. Ses splendeurs. Comment entrer dans la danse ?

Déconfinement Covid-19 / 13 mai 2020
Jour 3
Synonyme de solitude. « Situation de quelqu’un qui se trouve sans compagnie momentanément ou durablement, de ses semblables. (… ) État d’une personne qui s’est isolée par manque d’amitié, d’amour, d’affection, de relations, par défaut de communication. (…) Situation (morale, intellectuelle, matérielle) d’une personne dont les préoccupations sont éloignées de celles du plus grand nombre ou qui se singularise par ses choix, ses idées, ses actes, sa manière d’être ». Solitude. Aspirer, prendre goût, être accoutumé à la solitude. Chercher, craindre, fuir la solitude. Souhaiter, avoir peur, se réfugier. Respecter, déranger, troubler la solitude de quelqu’un. Goûter, savourer. Affronter, supporter, être voué à, se retirer, s’accommoder de. Accepter, organiser, rompre, égayer. Solitude. Protéger. Verrouiller. Découvrir, connaître, endurer. Échapper à. Être condamné, livré, réduit à. S’enfoncer, s’abîmer, être plongé, étouffer. Souffrir, guérir de. Solitude absolue, accablante, affreuse, amère, complète, douloureuse, dramatique, effroyable, inhumaine, pénible, poignante, terrible, tragique, vertigineuse. Solitude grandiose, mélancolique, romantique. Solitude sauvage. 55 jours. Ce n’était pas une solitude seule. Non. Ce n’était pas vide, dépeuplé, absent. Ce n’était pas comme avoir envie de mourir, comme perdre ses pieds. Ce n’était pas comme perdre ses mains, non. Ce n’était pas comme tomber. Comme un vertige. Ce n’était pas comme être avalé par un trou ou un puits. Ce n’était pas un noir qui absorbe, qui fait disparaître. Un gouffre sombre et vorace. Non. C’était une solitude habitée. Un endroit de présences, de silences. C’était doux et tendre. C’était l’endroit des apparitions. Il y avait des musiques nouvelles. Ce n’était pas une solitude à laquelle il fallait échapper. Non. C’était une solitude qu’on prenait dans ses bras. Dans laquelle on pouvait s’enfoncer. Où l’on pouvait aller chercher ce qui dort sous le monde. Où l’on pouvait rencontrer. Soi et la vie dedans. On pouvait partir dans des forêts. S’asseoir au bord des rivières. Écouter. Regarder. Respirer avec chaque arbre. Aller jusqu’à l’endroit où naît le vent. Connaître le secret des montagnes. Épouser les horizons. S’abreuver de lumière. Passer ses doigts sur le ciel. Devenir le monde entier.

Déconfinement Covid-19 / 12 mai 2020
Jour 2
La première chose que tu feras quand tu pourras sortir : marcher dans la nature. Mettre son corps en route. Dérouler le chemin. Le vent vient de loin. On l’entend arriver. Il traverse des arbres et des oiseaux. Il traverse la montagne. Et puis il s’éteint comme un feu endormi. Comme une mer oubliée des hommes. Le vent vient de loin. Il revient. Il s’éteint. Passager invisible de nos vies. Il passe ses doigts dans nos cheveux. Il rêve. Il se souvient de nous. De nos voyages sur ses sentiers. Nous venions ici autrefois. Nous marchions sans nous retourner. Nous nous arrêtions au solstice. Nous avions l’insouciance de l’enfance. Sa langueur aux heures pleines. Son front humide étendu sous un arbre. L’enfance endormie, offerte au ciel. Ses songes d’étoiles et d’animaux sauvages. Ses dragons et ses fées. Nous avions la ferveur. Le romantisme des journées au bord de l’eau. Le balancement des fleurs. Chaque signe était un signe. Chaque respiration était un langage. Et nous parlions. Et nous aimions les silences. Nous avions la patience des libellules. Une attente oblongue. Des goûters dans l’herbe. La compagnie des oiseaux et des cerfs à longues ramures. L’insistance de l’invisible. Nous avions des voix qui venaient avant la nuit, avant l’heure du départ. Le glissement des roches. Le jaune des prairies préservées. Le vent se souvient de nous. La marche est semblable à autrefois. Le chemin. Et puis nous oublions. Des choses nouvelles s’abritent à nos regards. Retrouver quelque chose qui avance. Toucher ce qui semble être nous, que nous cherchons à retrouver. Atteindre cette limite du même. Tant de temps est passé par ici. Ce qui a grandit, qui n’est plus à notre taille. Le soi d’hier. Nous voulons cueillir la même fleur de vie. C’était bien. Nous voulons exister encore de la même façon. Que rien ne change. Temps arrêté. Spectacle sans fin de nos pas sur la terre. Une main se tend vers une bouche. La table du monde. Dormir dans l’instant. Laisser partir les souvenirs. C’est un autre chemin. Et maintenant ?

Déconfinement Covid-19 / 11 mai 2020
Jour 1
Des choses ont grandi sans nous. Des montagnes ou des coquelicots. Un ciel plus haut. Des arbres étendus et certains. Palissades enchevêtrées. Les murs d’herbe. La chevelure du vent. 1erjour. Nous approchons nos yeux de la lumière. Nous sommes restés dans le noir si longtemps. Nous étions loin. Nous osons à peine. Nous gardons nos distances. Nous gardons nos sourires et nos silences. Nous marchons lentement dans le jour. Fantômes étonnés et discrets. 1erjour. Le monde joue, il fait semblant d’être comme avant. Il fait semblant. Nous sommes mal accordés à son rythme. Nous pensons que nous avons le temps. Que demain ou aujourd’hui ou hier. Nous avons noté la date dans notre agenda. Sortir. Se déconfiner. Se dérober. Se dérouler. Se détendre. Se dégivrer. Se désenfermer. Se déteindre. Se désunir. Se déglutir. Se déguiser. Se défendre. Se désinhiber. 1erjour. On garde notre fil des heures anciennes. On garde nos oiseaux, notre vent. On ne sait pas bien faire. On sort. On rentre chez soi surpris. Il ne faut pas exagérer. On était dehors. On rentre. Deux heures, c’est bien assez. On y va tout doucement. S’accoutumer. S’habituer. S’entraîner. Doucement. On hésite. On observe. On est lent. Il y a des gens. Le monde circule. On attend. On recule. On ira demain ou un autre jour. On est fatigué de cette agitation. 1erjour. On ne sait plus être à l’heure. On suit la file d’attente. On écoute. On regarde les personnes sans masque. On n’utilise pas les caddies. Ce n’est pas grave. C’est lourd, c’est tout. On respire. On ne regarde pas sa montre. On n’a pas rendez-vous. On goûte le temps. On veut retrouver notre voiture, notre maison. On se sent bien, là. On est habitué. On est maladroit. On ne sait plus parler aux autres. Les interpeller. Leur dire quoi. On n’est pas coiffé. On est habillé d’une façon simple. On choisit ce qu’il faut, juste ce qu’il faut. On ralentit. On oublie. On a sommeil. On ne sait plus. On verra. On conduit sa voiture. On se trompe de route. On cherche sa maison. On se perd. On se trouve. Des choses ont grandi sans nous.

Confinement Covid-19
Dans cette situation de confinement, j’ai décidé d’écrire un texte chaque jour sur ce que nous avons quitté, ce que nous allons retrouver, sur le temps rendu aux humains, sur ce qui nous rassemble, ce qui nous fait. Un texte poético-philosophique pour accompagner cette heure des vivants qui est une heure incertaine. Un texte sensible et positif fait de souvenances, de partances et de mondes. Je posterai chaque soir mon message d’espoir et de douceur sur cette page.
Voilà, c’est parti ! Bonne lecture !
Si vous souhaitez mettre des commentaires rendez-vous sur facebook : https://www.facebook.com/rozenn.guilcherauteurpeintre

Confinement Covid-19 / 10 mai 2020
Jour 55
Confinement. Dernier jour. Dimanche 10 mai. Les cloches de la cathédrale chahutent les oiseaux. Leurs chants s’ignorent et dansent ensemble. Les oiseaux, je ne connais pas leurs noms. J’écoute. Il y a des bruits de voix au loin, l’aboiement d’un chien. Une aile se pose. Un ciel gris, presque blanc. Un presque vent. Les cloches s’éteignent si doucement qu’on perçoit le silence. Ce qui vole jusqu’à moi. Ce qui s’offre. Dernier jour de confinement. Demain. Demain on peut sortir à peu près librement. On n’aura plus besoin d’autorisation, de raison, de limitation. On pourra sortir, comme ça, pour rien. On pourra marcher. Voir des gens. On pourra ne pas avoir de but. Les cloches reviennent. Je n’avais pas remarqué que, le dimanche, elles chantaient plusieurs fois. Je ne sais pas combien il y en a. Elles remplissent la fenêtre. Elles se bousculent. Elles s’accoudent. Elles volent. Oiseaux magnifiques enfermés dans des clochers. Ce qui chante s’approprie, se discute, se décide. Cœurs de métal frappés pour rendre l’âme. La beauté s’attrape-t-elle ? Le vivant s’origine. Pierre, os, chair, bronze. Comment garder son chant dans un monde qui va vite ? Car le monde est déjà là. Il nous donne rendez-vous, nous envoie des sms, des mails. Il nous dit qu’il faut repartir, reprendre nos vies, nos activités, nos turbulences. Il nous dit qu’il faut faire vite, que c’est urgent, qu’on est en retard. La porte du jour ne s’est pas encore ouverte et pourtant les choses se précipitent, les choses d’avant. Les choses de ce monde-là. Une peur que ça nous échappe, qu’on ne soit plus dans la course, dans ce rythme effréné. Une peur qu’on ne sache pas garder ce monde-ci. C’est demain. On pourrait effacer ces deux mois de confinement. Oublier le temps, sa longueur, ce qu’il nous donne d’écoute et de regards. Ce qu’il nous donne de cuisine et d’enfants. De nous, rencontré enfin. Du monde, rencontré enfin. On pourrait effacer. Parenthèse perdue dans un pli, une poche d’inexistence. On pourrait oublier le vent, l’avancée des nuages, la pluie et son bruit de nuit, les oiseaux. C’est demain. Comment allons-nous assembler nos jours ? Comment avancer sa main vers ce qui vient ? Attendre. Goûter tout doucement ces heures, ces lumières, ces choses invisibles et tellement là. Vivre pareillement. Ralentir. Écouter ce qui parle en soi sous le bruit du monde. Peut-être saurons-nous ne pas être des choses qui sonnent quand on le dicte ? Ne pas être à l’heure des autres, à l’exigence, à la volonté, à la décision. Ne pas être enfermés dans un monde qui nous dit libres. Ne pas écouter l’efficacité, la rentabilité, la raison. Peut-être saurons-nous être des oiseaux ?

Confinement Covid-19 / 9 mai 2020
Jour 54
Seigneur des sables. Tu viens de loin, d’un passé endimanché. Seigneur des sables. Je sens ta présence dans ce moment où les choses s’arrêtent, où le monde habite entre deux respirations. Connais-tu cet espace entre les choses, cet instant où ton cœur se pose dans le pli des battements ? Connais-tu ce repos, quand tu reviens blessé d’une bataille et que tu allonges ton corps dans un lit et que tu ne sais pas faire autrement ? Ces jours interminables où tu entends les cloches et leur joyeuse bousculade. Où les oiseaux rentrent dans ta chambre et ils chantent pour toi. Tu égrènes le bleu du ciel. Chaque pas résonne et agrandit ton château. Tu vis dans un lit de tentures et de roses. Les parfums devancent les femmes qui t’apportent des mets délicats. Chacun entoure ton silence. Seigneur des sables. C’est ainsi que le sang arrête sa course. C’est ainsi que la douleur s’en va. Que le sommeil répand ses volutes de paix. Qu’il nous sauve de nos guerres et de nos colères. Je sens ta présence quand il n’y a plus de croisades. Quand il n’y a plus rien à fabriquer pour donner à manger à un dehors vorace. Seigneur des sables. Je te rejoins où tu es. Une attente qui répare nos plaies. Une enclave où guérir nos cœurs. Quand on a déposé ses armes, ses armures, ses murs. Quand on a vécu au temps du silence et de la lenteur. Ce jardin-là, seigneur, il faudrait le garder. Y revenir souvent. Se souvenir de la porte, de la clé, du chemin qui y mène. Se souvenir des fleurs que nous faisons grandir. Se souvenir des cloches et des oiseaux. Des parfums. Des lits de tentures et de roses. Seigneur des sables. Tu me rejoins où je suis. Les choses blessées ne font plus mal. Le temps a passé sa main d’or sur nos cicatrices. Et maintenant ? Que faisons-nous des roses et des armures ? Savons-nous habiller nos âmes de lumière ? Déposer les colères, les armes, les guerres. Mettre nos corps debout. Marcher vers le chemin, la porte, la clé. Un jardin nous attend.

Confinement Covid-19 / 8 mai 2020
Jour 53
Courir dans la pluie. S’abriter sous un arbre si grand qu’il contient le temps. Entendre l’aube arriver. Connaître la nuit. Connaître ce qui n’est plus la nuit. Le chemin se prépare au jour. Il devance son ombre. L’eau est une brume évaporée. Une transparence diaphane entre nous et le monde. Le lait du matin éparpille les fleurs. Un sommeil s’allonge les bras et s’étire jusqu’à l’absence du noir. La lumière glisse sa langue de pluie sur les pays, les paysages incertains et sauvages. Des bruissements, venus de l’autre côté, prolongent leur vie nocturne. Des branches craquent comme un homme qui arrive. Qui d’autre est réveillé quand le monde dort ? Renard ? Serpent ? Chouette chasseuse de reptiles ? Qui d’autre est réveillé ? Les arbres rêvent qu’ils rêvent. Belettes ? Cerfs ? Loups longeant la montagne ? Personne ne connaît l’attente du jour. Le passage subtil où le monde s’inverse. Bascule des hémisphères. Le sombre se dérobe. Il vit, dissimulé derrière les choses. Il faut être là pour voir le drap des nuits. Il faut assister à l’offrande des complétudes. Un moment, tout est là. Dans les ponts de l’aurore ou ceux du crépuscule. Un instant l’immensité s’épouse. Le caché, le visible. Ce que contient le jour. Ce que contient la nuit. Solitude de l’attente. Chuchotements. Silences. Bruits qui ne viennent de nulle part. Aimer la naissance. L’éclosion des heures et leurs douces corolles. Ce qui n’existe qu’une seule fois. Sentir la rondeur de la Terre. Son mouvement de planète. Sa danse lente. Habiter cet instant. Sur la pointe des pieds retenir son souffle. Se savoir seul au monde, et puis non. Vivre dans le chant du grillon. Vivre dans ce qui est sans bruit. Des choses toutes petites. La croissance des montagnes. Le déplacement des fleuves et la marche des forêt. Poussière de pollen sur le dos d’une libellule. Ce qui brûle au centre de la Terre. Le langage des fleurs. La lumière qui compose la nuit.

Confinement Covid-19 / 7 mai 2020
Jour 52
Qui a abandonné les vivants ? Qui est parti avec ses chants d’oiseaux et le soleil de chaque jour ? Avant, tout était possible et nous ne le savions pas. Avant, tout prenait place dans nos yeux. Nous ne connaissions pas l’absence. Nous ne savions la voir sous l’épaisseur des forêts. Nous ne savions soupçonner sa présence au cœur des choses. Sais-tu que la mort dort au creux de la vie ? Sais-tu ? Chaque chose porte sa fin. Sa disparition. Chaque chose habite son absence. Quelqu’un a éteint la lumière et nous sommes aveugles devenus. Quelqu’un a éteint la musique du monde. Silence étourdissant. Fenêtres entraperçues des mots. Derrière, il y a quelque chose, ou dedans, ou après. Des balançoires et des jardins. Des champs dans la main du vent. Fleurs des chemins. Abeilles aventureuses et familières. Il y a du sureau, de longues branches qui donnent leur ombre. Des mûres. Des patiences de cueillettes. Des saisons, et puis d’autres. Sais-tu que la mort dort au creux de la vie ? Sais-tu ? Que nous portons aussi notre disparition. Que glissent en nous des fragments de nuit. L’envers des circonstances. Que sous la terre s’émerveillent des racines. Des choses tentent de naître dans l’invisible de nos âmes. Et puis des choses meurent. Des nous inaccomplis. Des nous vieux que nous laissons partir en pleurant. Des choses que nous ne comprenons pas. Qui n’ont pas besoin d’être saisies ou regardées. Qui n’ont pas besoin d’être sues. Qui jaillissent ou bien se fanent ou bien se décomposent. Suivre le voyage d’un pollen. Regarder ce qui nous a éloigné. Ce qui momentanément s’absente. Le vide. Des mots qui ne vont nulle part. Ce qui nous enferme en nous-mêmes. Ce qui nous fait ignorer la vie. La vie vivante, toute là. La joie en attente d’être partagée. L’épaisseur du monde et sa rencontre. Sais-tu que la mort dort au creux de la vie ?

Confinement Covid-19 / 6 mai 2020
Jour 51
Chevalier. Ta tristesse traverse le temps. Elle arrive jusqu’à moi. Tu as perdu l’élan, la joie, le rire des soirs qui ouvrait des fenêtres. Tu as perdu ce qui ne pouvait rester dans une maison. Le partage du soleil. Les mains dans les tiennes. Que serrer dans la solitude d’un lit ? Son cœur à soi, son corps. Sa nuit, son jour. Serrer sa peine. La coller contre soi. Lui murmurer des choses douces comme des pluies. Lui murmurer des ruisseaux. Ceux qui vont vers la mer. Ceux qui grossissent jusqu’à devenir des montagnes. Des orages magnifiques. Chevalier. Tu as perdu ton souffle. Tu ne sais pas où tu l’as mis. Parti avec les autres, sans doute. Enfermé dans des maisons, dans d’autres couloirs, au fond de d’autres cœurs. Parti avec. Et toi, seul, qui parles à ta tristesse. Qui être loin ? Qui être, éloigné des rires francs et des bousculades ? Et quand est-ce que ça va revenir, tout ça ? Chevalier, toi, moi. Quand est-ce qu’on va redevenir entier ? Avec des sourires pour des yeux amis ? Avec des mots. Avec des attentes. Rendez-vous d’étoiles. Ton âme a glissé sous le tapis des jours. Et chaque heure la foule, la piétine, l’ensevelit. 51èmejour de confinement. Ça fait 1224 heures où s’écrase entre les doigts ta substance. 1224 heures pendant lesquelles s’amenuise ce que tu es. Chevalier, toi, moi. L’usure d’un rocher qui est caillou qui est sable qui est poussière. La fabrication d’un homme décousu. Il manque, je ne sais pas ce qu’il manque. Tout. Rien. Il manque ce qui nous fait humain. Ce qui trouve sens dans le partage des cœurs. Chevalier. Bientôt s’ouvriront les fenêtres et les jardins. Bientôt le ciel. Bientôt la terre entière et tous ceux qui l’habitent. Il n’y aura plus de maison, plus de murs. Tout sera maison. Il n’y aura plus d’attente. Des chemins à épouser. Des mains. Des cheveux. Des épaules. Chevalier. Ta tristesse traverse le temps. Elle arrive jusqu’à moi. Et puis elle se lève comme une brume et puis elle disparaît. C’est l’heure bleue des retrouvailles. Des danses sous la lune. C’est l’heure de rendre sa liberté à notre cœur de loup.

Je remercie Dan Burcea de m’avoir invitée à contribuer à son site internet Lettres Capitales
en écrivant un texte de « réflexion en temps de pandémie ».
C’est en ligne le 11 avril 2020, 26ème jour de confinement. Ça s’intitule « Habiter ? » et c’est ici !
N’hésitez pas à découvrir les textes d’auteurs français et roumains sur le site Lettres Capitales. Bonne lecture.
Se souvenir du bon vieux temps ! À découvrir : l’exposition photographies et textes « Il est une forêt dans mes veines ». 10 minutes de poésie pure. Photographies et montage d’Emmanuel Curt, textes et voix de moi.
Confinement Covid-19 / 5 mai 2020
Jour 50
Dériver. Se laisser emporter. Ne plus rien tenir. Aller. Suivre le mouvement. Oui. Non. Accueillir. Dériver, serait-ce quitter sa rive ? Détacher chaque brin d’herbe. La patience qu’il faut au départ, à ce qui commence. La patience qu’il faut au déracinement. Dériver. Défaire les cils. Défaire les contours anciens. Déboutonner nos cœurs. Ne pas savoir. Découdre le rivage des habitudes, de ce que nous avons tricoté d’année en année. S’en aller. Libérer nos bouts de tissus. Nos parts rétrécies tenues si fort si fort. Partir. Flotter. Lâcher nos mains et ce qu’elles gardent serré. Ouvrir nos bras. Bords de route abordés si souvent. Casser des fils, des nœuds, des promontoires. Voyager. Chemin d’eau et de pluie. Dégrafer nos robes de solitude. Courir sur la rivière. Où tu vas je vais. Glisser. Dérober des paysages. Arbres. Ciel. Oiseaux. Partir avec le chant des matins rassemblés et joyeux. Rouler sa bouche aux bouches de lumière. Enroule. Déroule. Danse sur l’eau. Rencontre des ponts. Passe d’autres rives, d’autres rivages sauvages. Traverse le temps. Être soi sans savoir, sans vouloir. Vivre avec les libellules. Les ailes effarouchées du désir. Rire. Regarder ce qui coule. Lécher les bordures naissantes. Dériver. Sourire dans l’instant. Démêler nos miracles. Oui, je dérive. Je quitte et je détache chaque brin d’herbe. Je flotte dans le courant. Ce qui commence. Ce qui pleure. Ce qui part. Flotte dans le courant. Ce qui ouvre. Ce qui lâche. Ce qui patience. Ce qui défait. Ce qui déracine. Flotte. Ce qui découd. Ce qui casse. Ce qui part. Ce qui dégrafe. Ce qui court. Ce qui déboutonne. Dans le courant. Ce qui va. Roule. Rencontre. Passe. Traverse. Rit. Vit.

Confinement Covid-19 / 4 mai 2020
Jour 49
Celui qui tombe. Celui qui tombe est attendu quelque part. Il quitte un monde pour un autre. Celui qui tombe glisse sous la surface des choses. C’est un endroit qu’il connaît, c’est de là qu’il vient. Il retourne s’ensevelir. Il est derrière, dessous ou dedans. Et pendant quelque temps on ne le voit pas. Il a disparu. On n’entend plus sa voix. On ne saisit plus son corps, saisi par une bouche d’ombre. Et celui qui tombe va son chemin. Un monde de fissures et de creux. Un escarpement de cœur. On sait qu’il reviendra. On ne sait pas encore quand. Son voyage s’accomplit comme une errance mais ce n’en est pas une. Celui qui tombe explore la nuit à son insu. Il n’a pas de mots pour les choses. Il pleure, c’est tout. Une chute vertigineuse comme on tombe dans les pommes ou amoureux. Comme on tombe des nues. On ne dit jamais où l’on tombe. On ne sait pas. On n’attrape rien. On ne rencontre rien. À part soi, peut-être, quand on a de la chance. On ignore sa vie. On se perd. On se trouve. On pleure. On traverse tous les jours depuis notre naissance. On les vit à l’envers. Et puis l’on remonte. Des bouts de lumière dans les plis de la nuit. Des miettes égarées comme des cailloux. On remonte. On franchit. On augmente ses heures. On fait le chemin dans l’autre sens. On quitte un monde. On remonte. On sèche ses yeux. On est celui qui tombe. On rencontre des mots comme des ponts, des phares ou des prières. On glisse sous la paupière du temps. On approche des bruissements, des choses qu’on ne comprend pas. On rit. On revient. On s’éloigne de sa naissance. On grandit et la lumière. La surface. Dedans ou après. Dessus. L’invisible tenu par la main. Apparaître. On voyage. On arrive. On tangue. Le jour se lève et nous aussi. On rajoute un cercle à notre corps. On tremble. On se souvient. On est là.

Confinement Covid-19 / 3 mai 2020
Jour 48
Renard, après le printemps, que fais-tu ? Es-tu plusieurs ? Es-tu seul ? Je sens ton odeur au tronc des arbres. Je vois ta fourrure dans mes rêves. Elle tient les forêts. Renard. J’ai vu ton terrier d’or. La voûte céleste en bas. Une nuit étoilée, une constellation sur laquelle marcher. Un endroit où rien ne tombe. Avancer sur un lit d’étoiles. J’ai vu ton terrier. Le plafond épouse la terre et les racines. Il est en or. Il reflète les galaxies sur lesquelles nous sommes debout. Respirer là était un doux présage. C’était comme être dans le vent. Ton terrier, je l’ai vu dans ma tête. Un endroit où retourner quand le monde est rugueux. Un endroit qui ne tombe pas. Où venir vivre dans tes yeux de soleil. S’aventurer, comme toi, dans le silence. S’aventurer avec toi. Renard, après les saisons, qui es-tu ? Et la nuit ? Et le jour ? Où habite ton cœur ? Comment vis-tu sans les hommes ? Comment vis-tu quand il n’y a plus rien à fuir ? Quand les hommes, enfermés chez eux, ne viennent plus te chasser ? Comment fais-tu avec l’absence ? Une absence de peur, de méfiance, de courses sous la brume. Comment, avec ce qui n’est pas là ? Le bruit, les pas, les fusils. Les voix et les chiens. Les fureurs. Les embuscades et les pièges. Les coups de feu. Les cris. Comment ? Le monde se tait. La forêt retrouve ses choses vieilles et passées. Une croissance, un soleil, une eau qui court. Un silence de montagne. La nuit. Le jour. Une liberté. Une insouciance. Une naïveté. Tu habites là. Tu avances sur un lit d’étoiles. Comme être dans le vent. Respirer l’or de la terre. Monde doux et tendre. Tenir debout. Saisons rassemblées. Naître le silence. Habiter son cœur. Aimer les nuages. L’ombre. La lumière. Dehors rit. Dehors se sèche et s’ébroue. Pelage. Empreintes. Odeur au tronc des arbres. Rivières. Une rousseur a traversé le temps. Renard ?

Confinement Covid-19 / 2 mai 2020
Jour 47
Quels paysages dessinent nos visages ? Quels paysages sont nôtres ? Habitent les nuits et les jours. Constance miraculée. Fondations qui naissent dans l’enfance. Qui naissent avant de naître. Les barques vivent sous l’eau. Cercueils de boue. Vase fertile et endormie. Là-bas sombre le passé. Ce qui était avant. Car avant, avant de venir dans ce monde, j’étais où ? J’étais qui ? Je rejoins le temps et je tricote avec lui des fleurs d’eau. Des iris jaunes à grandes tiges. Racines dessous, tout dessous. Enfoncées dans l’écoulement des jours. Les ruines et les épaves. Les feuilles composées de terre et d’eau, décomposées. Les troncs. Les morts toutes mortes. Ce qu’il reste de nous quand on a traversé. Quels paysages dessinent nos visages ? Nous attendons longtemps. Nous dormons dans le sable qui vit sous la terre qui vit sous la boue qui vit sous la rivière. Nous dormons. Nous ne dormons pas. Corps allongé tourné vers la surface. Corps blanc, recouvert de coquillages. Des herbes ont poussé, poussé leur cri d’oiseaux. Des sédiments. Choses tombées inaperçues. Choses oubliées sur nos corps de brume. Silence déposé sur le lit des rivières. Ce n’est pas encore notre heure. Ce n’est pas notre miracle. Patience. Argile douce et profonde. Sous l’eau, il n’est pas besoin de respirer. Il n’est pas besoin de battre un cœur. Tout est à sa place de fossile. Des choses ont été des boucliers ou des arbres ou des bateaux. Des choses ont été autrefois. Ce qui coule, ce qui glisse, ce qui va. L’abandon des bouts de bois. Des chansons dans le vent. Et puis non. Endroit d’attente. Révélation. Devenir sable. Devenir boue, devenir terre. Devenir eau. Devenir ce qui coule, ce qui glisse, ce qui va. Quels paysages dessinent nos visages ? Être ce qui est. Composer un territoire. Plus vaste que la rivière. Plus vaste que la terre tout dessous. Plus vaste que le ciel. Composer un territoire. Partager le temps. Être tout. Le sable. Les iris jaunes. La rivière. La terre. Le fil du temps. Les coquillages. Les bateaux. Les arbres. Aujourd’hui. L’eau. La boue. Autrefois. Les boucliers. Les racines. Les ruines. Les feuilles. Les épaves. Les fossiles. Les troncs. Les sédiments. Le silence. L’argile. La patience. Les bouts de bois. Ce qui coule, ce qui glisse, ce qui va. Quels paysages dessinent nos visages ?

« Le Sivite » : texte écrit il y a déjà quelques années. Encre, collage, peinture sur papier.
Le Sivite
Le Sivite si loin.
Le Sivite si loin si loin de moi.
Le Sivite si loin si loin de moi moi-même.
Le Sivite m’éparpille.
Le Sivite me gloutit.
Le Sivite me soustrait dans le Grand Nulle Part.

Confinement Covid-19 / 30 avril 2020
Jour 45
Colis alimentaire. Jeanne. 86 ans. Pas de problème. Vit seule. Jusqu’à ce jour où sa fille est morte dans un accident de voiture. Brusquement. La famille a préféré ne rien lui dire. On ne sait jamais. Ça pourrait la choquer. Être trop difficile à supporter. Et puis on ne sait pas comment lui dire. Les mots. Regarder sa souffrance. Non. Alors on lui ment. On lui dit que sa fille est malade. Non, pas du covid-19, non. Qu’elle ne peut pas lui téléphoner deux fois par semaine comme d’habitude. Qu’on ne peut pas la joindre pour l’instant. Qu’elle ne peut pas venir la voir. Et puis on fait l’enterrement sans elle. On choisit les fleurs, le cercueil. Le jour. On veut la protéger. On a peur de sa réaction. C’est mieux comme ça. Et puis un jour, quand même, on le lui dit. Après. Longtemps après. On lui explique, quand on a fait son propre deuil. On peut lui parler avec moins d’émotions. On lui dit que sa fille est morte dans un accident de voiture. On lui dit il y a un mois. Qu’elle est enterrée. Que la messe a eu lieu. Que tout est bouclé. Qu’elle n’a plus à se préoccuper de rien. Jeanne n’arrive plus à écouter. Qu’on ne savait pas comment le lui dire, alors on a attendu. Jeanne n’arrive plus. Elle tombe dans un endroit blanc. Un endroit qui arrête les mots. Hôpital psychiatrique. Jeanne, elle essaie de retourner vivre dans ce temps qui manque, ce temps volé. Dans ce trou d’un mois. Elle remplit ses heures de silence. Un mois, 720 heures, 43200 minutes. 43200 minutes d’absence. Ce qui fait tomber sur le côté, comme ça. Ce qui ne se voit pas. Ce qui s’effondre. Sa fille. Pas sa fille. Et puis elle revient chez elle. Maintenant elle a un traitement. Elle est stabilisée. Elle parle à sa fille dans sa tête. Lui demande pourquoi elle est partie sans elle, sans l’attendre. Pourquoi elle l’a laissée là, dans la blancheur et le silence. Elle ne sait pas toujours quel jour on est. Elle oublie. Elle oublie aussi comment elle dépense son argent. Elle oublie. Elle s’endette. Colis alimentaire. Des chose on glissé, comme une disparition. On ne retrouve plus ses affaires. On ne sait plus où on les a mises. On dort. On prend ses médicaments. On parle dans sa tête. On ne sait pas si on a mangé. On ne sait plus. Des choses glissent, dérapent, tombent. Ou des gens. On attend que le téléphone sonne pour entendre la voix de sa fille deux fois par semaine. On attend un rendez-vous pour rejoindre ces mains douces. Maman, comment vas-tu ? On écoute les chuchotements. Les meubles qui craquent, le vent dans les volets. Présences. Signes. Ceux qui vont venir font toujours un peu de bruit avant.
Quitter la lumière. Étendre doucement sa main sur la nuit. Fermer les volets demande du temps. La rencontre des grenouilles. Bruit de rivière ou d’étang. La ville recueille l’humide du jour. Lune découpée. Frottement d’étoiles. Quitter la lumière. Les chats sont partis se coucher ou peut-être chasser. Ou peut-être assembler leurs pattes contre le froid. La ville se tait. Se terre. Se remet dans sa grotte. Éclaire l’ombre. La ville se murmure. La nuit ressemble aux nuits de campagne. La rosée. On ne veut pas aller dormir tout de suite. D’autres étoiles arrivent. D’autres grenouilles ou d’autres chats. Et puis, peut-être un chant qui n’est pas un oiseau. Un grillon ? Tenir encore ce qui reste du jour. Ce qui repousse le noir. Distinguer les contours du connu. Silhouette dérobée et mutine. Passage des inquiétudes. Rue des ténèbres. Des choses qui se transforment, qu’on ne reconnaît pas. Fuite ou perte. Disparition lente du palpable. Quitter la lumière. S’enfoncer dans un horizon qui s’étiole. Journée fanée qu’on voudrait garder encore sous la langue. Personne ne nous voit. Et ça sera plus facile pour avancer dans le crépuscule. Sous la langue, un morceau, un petit bout. Une saveur de goûter. Souvenir de ce que nous avons traversé et qui tenait nos yeux ouverts. Et qui tenait nos corps debout. Laisser aller les couleurs, les heures, les jeux. Les choses que nous avons mangées avec délicatesse. Abandonner le temps. Quand on ne peut pas dire à demain à ce qui meurt. Quitter la lumière. Traverser des tissus de mots. Prononcés, oubliés, criés, gardés, assemblés, donnés. Apprendre à se séparer. Apprendre à perdre. Avancer dans le soir. Aborder le sommeil comme on aborde une île. Une chose sauvage accouchée sur un arbre. Coucher son corps sur la nuit commencée. Tout est neuf. Tout est à découvrir. Île. Caillou à tourner dans ses doigts pour le voir de tous les côtés. Île. Solitude remplie d’oiseaux. Fermer les yeux. Approcher sa main des rêves. Quitter la lumière ?

Confinement Covid-19 / 29 avril 2020
Jour 44
Il paraît que nous allons sortir bientôt. Sortir de quoi. On ouvrira les fenêtres et les portes. On regardera les arbres comme une première fois. Comme les gens qui n’ont jamais vu la mer. Jamais vu en vrai. Sentir le vent dans nos cheveux. Fermer les yeux comme ça. Marcher tout doucement, tout doucement. Écouter le bruit que fait un corps. Respirer les traces du printemps. Des mots passent dans la rue. Éclats de soleil. Tu es en retard, je t’attendais. Oui. Je ne sais plus tout à fait le temps qu’il faut pour rencontrer une ville. J’ai peut-être oublié. Compter. Connaître la mesure des choses. Le poids d’un nuage. Le prix d’une heure. Des fleurs s’impatientent. Se penchent à mon arrivée. Elles sont nombreuses, sauvages, étonnantes. Elles ont une nouvelle vie pleine de trottoirs, de murs et de jardins. La liberté des fleurs qu’on ne coupe plus. Elles ont la joie de la jeunesse. Marcher. Marcher autrement. Prendre son temps par la main. Lui faire découvrir ces choses hautes et la chanson des maisons. Ralentir. Ignorer l’heure qu’il est. Se souvenir. Oublier. Être quelqu’un d’autre. Saisir ce qui apparaît à notre porte. Ce qui vient d’ailleurs. S’asseoir sur un banc. Regarder vivre sa journée. Boire de l’eau. Oiseaux des villes. Plumes. Quelque chose flotte dans l’air. Un goût d’enfance. L’observation des fourmis. Leur trafic magnifique. Un trou dans lequel il faudrait faire rentrer tant de choses. Un grain de riz. Un bout de pollen. Flocon venu du ciel. Une miette. Cette vie de fourmilière sous les pieds des vivants incertains. Cette vie frétillante, laborieuse, urgente. Vie radicale, dirigée, contrainte. Les fourmis, ce sont des gens importants. Des travailleuses. Au bord du banc, ce trou s’enfonce dans la terre et puis sous l’asphalte et puis… À l’ombre des villes, aux confins des carrefours. Des êtres s’agitent quotidiennement. Prennent des voies sans issues, sens de circulation, sens interdits. Mijotent leur caverne. Grapillent. Tirent. Précipitent. S’agglutinent. Forcent. S’entraident. Dépassent. Engrangent. Poussent. Accumulent. Portent. Surpassent. Persévèrent. Transportent. Grimpent. Hissent. Entreposent. Déplacent. Remplissent leur sous terre souterrain. Fourmis fourmilière. Il paraît que nous allons bientôt sortir.
J’ai peur. J’ai peur de ne pas savoir être. J’ai peur de retourner en arrière. Quand tu ne te rends pas compte que tu ne vas pas dans le bon sens. Et puis tu as pris ce chemin. Tu avances. Mais, en vrai, tu repars à ta naissance. À avant avant. J’ai peur. De ne pas savoir résister à ce qui se prépare. Au temps précipité, efficace et laborieux. Au temps rentable. De ne pas savoir résister au rythme du monde, à ses exigences, à ce qu’il dit qu’il faut être. J’ai peur de ne pas y arriver. Être moi. Moi, ralentie, qui déguste ses heures. Qui prends le temps des pies et des renards. Moi qui glisse dans le vent. S’allonger dans l’herbe. Regarder le voyage des nuages. Se souvenir du bruit de l’eau qui va. Dormir. Dormir longtemps. Rêver. Suivre les abeilles. Écouter le chant des grenouilles. La lune. Tu la vois ? S’allonger dans un lit avec un livre. Fermer les yeux. Entendre la farandole des minutes bleues. Dire non. Dire oui. S’étaler la langue comme une mer précieuse. Attendre le soleil. Se laver des jours sombres. Se laver encore. Choisir un chemin doux. J’ai peur. Et si tout repartait comme avant. Courir. La liste de la journée. Le réveil. Les horaires à respecter. Vite ! S’intégrer au monde. Objectif travail. Objectif gagner de l’argent. Enchaîner. Pas de temps pour soi. Action. Extérieur. Vite ! Récupérer les enfants. Prévoir. Téléphoner. Prendre rendez-vous. Obligations. Courses. Penser à ce qu’on fera après. Organiser. Faire. Préparer. Conduire la voiture. Être en retard. Dépenser de l’argent. Vite ! Répondre aux mails. Oui. Gestion du temps. Fatigue. Faire les devoirs. Agir. Calculer les heures minimales de sommeil. Déposer les enfants. Décider. S’intégrer au monde. Courir. Vite ! Noter. Être à l’heure. Noter. Téléphone. Ne pas oublier. Faire plusieurs choses en même temps. Action. Remplir. Vite ! Épuisée. Non. Non, je n’ai plus peur. Je me souviens. Et je ne peux plus être cette personne-là. 44 jours de confinement. À écrire. À observer les pigeons. À dormir. À saisir ce qui rentre par la fenêtre. À peser les nuages. À marcher tout doucement. À voyager à l’intérieur de soi. 44 jours. Regarder. Écouter. Vivre avec son cœur. Tenir la main du temps qui passe. Goûter la substance du monde. Le ravissement des arbres. Habiter l’invisible. Chemin qui s’éloigne de sa naissance. Faire son travail d’homme ou de fleur. S’asseoir dans un jardin si vaste et lumineux. Rester. Vivre là. Dire non. Dire oui.

Confinement Covid-19 / 28 avril 2020
Jour 43
Il est plus facile de donner que de recevoir. Parce qu’on décide, parce qu’on prend en soi pour l’autre. Parce qu’on choisit le moment. Parce qu’on se sent bien quand on l’a fait. Parce que ça donne une bonne image de soi. Parce qu’on est généreux, bon, remercié, aimable, précautionneux, rempli, bienfaisant, partageur, solidaire, lumineux, aidant, donateur, abondant, fraternel, dévoué, participant, engagé, volontaire, bienheureux, enthousiaste, uni, responsable, attentif, surprenant. Mais recevoir demande peut-être de la grâce. Des choses qui s’ouvrent. Recevoir demande de se donner soi. De ne pas savoir comment faire. De peser plus lourd. De ne pas savoir comment on va rendre ce don. D’accepter le déséquilibre. Ce qu’on doit. Ce qu’on croit qu’on doit. D’être nu, surpris, décontenancé. Ce mot qui dit qu’on a perdu notre contenance. Recevoir nous chahute. Déstabilise. On est au bord, au bord d’on ne sait quoi. Une vulnérabilité. Un espace fragile et déconcertant comme un silence. Recevoir n’est pas une action. Être. Ouvrir les mains pour tenir. Ne pas trouver les mots pour dire, ou il y en a trop ou il n’y en n’a pas assez. Se confondre. Se confondre en remerciements. Se confondre avec l’objet. Se déshabiller. Avoir envie de pleurer ou de rire. Et c’est pareil. Être sur le seuil. S’avancer. Sortir de soi. Exister. S’arrêter. Se suspendre. Le cœur bat plus vite. Avoir envie de pleurer. Rencontrer l’amour de l’autre. Ne plus savoir ce qu’il faut faire, ce qu’il faut dire. Merci. Tout ce qu’on met dans un si petit mot. Nous, penché. Définitivement sorti de notre axe. Déplacé. Nous à côté de nous. Pour être plus près. Rapproché du mouvement du silence. Nous attrapé par l’instant. Décalé de l’espace ordinaire. Habitant momentanément entre. Salle d’attente. De toutes les attentes. Quand on ne sait plus, sait plus qui être.
Voyage inaccompli. Un virus est venu changer les choses. Notre regard ou notre silence ou notre vie. Il a fait partir des gens en avance. Tu sais, comme le jour où Paul t’a dit que sa femme était partie. Et toi, tu te demandais où. Tu sais ? Partie, ça voulait dire morte. C’était vraiment loin et vraiment définitif. En ce moment, des gens partent. On se demande où. On se demande comment. Et aussi on se demande pourquoi. Voyage inaccompli. Comme on dit c’est son heure. Mais à 50 ans, est-ce que c’est ton heure ? Ou à 23 ans ou à 72 ans. Ton heure, elle est à quelle heure ? Alors on pense que c’était son moment. Un rendez-vous. Mourir comme ça ou autrement, finalement. Alors on pense. Que quelque chose était déterminée. Oui, mais quand même. On compte les morts. Les improbable et les à risques. Est-ce que je suis à risques ? Ce truc-là, on voudrait ne pas l’attraper qu’il nous attrape. Qu’il nous torde vers la mort un peu trop tôt et sans prévenir. Oui, on aime bien être prévenu. On aime les surprises aussi mais quand même. Voyage inaccompli. On mesure le temps. On compte les jours. On pèse la vie. Quand on a 15 ans, quand on a 47 ans, quand on a 90 ans. On en voudrait encore un peu. On n’a pas terminé la boucle. On a soif encore. On pense. On pense à tous ceux qui meurent chaque jour de la faim. Des enfants. Ces partances-là, elles sont beaucoup plus nombreuses et depuis longtemps. Presque normales ou acceptées ou invisibles. Ces partances-là, elles sont ailleurs, dans d’autres pays, alors… On les laisse partir. Pourtant, un vaccin existe : il suffit de manger pour ne pas mourir. On laisse glisser ces mondes. Trop loin, trop pauvres, trop pas nous. Sur la Terre, des gens partent chaque jour parce qu’on ne leur donne pas nos réserves de nourriture. Voyage inaccompli. On préfère garder nos choses. On ne sait jamais, pour si un jour. Et puis on jette parce qu’on a trop attendu que cette heure vienne. Les morts du Covid-19 sont précieux, comptés. Ils nous appartiennent. Ils parlent de ce qui nous attaque et contre lequel on ne sait pas quoi faire, on n’est pas sûr. Cette mort-là est plus grave que les autres. Moins naturelle. Et puis, cette mort-là, elle touche les riches, les voisins, les campagnards, les parents, les instruits, les jeunes, les prudents, les pauvres, les citadins, les collègues de travail, les optimistes, les amis. Et puis, cette mort-là, elle s’attrape. Voyage inaccompli. Est-ce que des vies vaudraient plus que d’autres vies ?

Confinement Covid-19 / 27 avril 2020
Jour 42
La nuit m’a apporté un rêve. Un rêve plein de gens. Une maison partagée et joyeuse. Des enfants. Des choses qui rient et du soleil. Un rêve simple. La vie. Et aussi un jardin, des repas sous les arbres. Des fruits cueillis, des olives qu’on prépare. De l’ail. Le pain qui sort du four. La glycine butinée. Des jeux dans l’herbe. C’est peut-être l’été. Le chuchotement d’une rivière et ses promesses d’après-midi. On ne sait pas quelle heure il est. Des gens qui s’attrapent et tombent dans les pâquerettes et roulent. Du vin. De la limonade. Une guitare et un chant. Cigales. Bruits d’assiettes et de conversations. Une main tend une corbeille de fruits. Le fromage de chèvre du marché. Nos ventres, ensemble, en entier dans nos yeux. Nos cœurs perchés. Quelques oiseaux aussi. La tortue du voisin qu’il faudra lui ramener. Capucine, elle s’appelle. Elle vient de loin, de l’autre côté du champ. Les abeilles qu’on invite. Les livres abandonnés au bord des chaises longues. Des rires. Des gens qui parlent du monde. Du monde qu’il faudrait. Du monde qu’il faudrait qu’on aide à devenir. Tu comprends ? Une maison partagée. Tom qui fait du yoga près du mur de pierres. Il mangera après. Il viendra quand il aura nourri ce qu’il y a en lui. L’immensité peut-elle être rassasiée ? Des enfants qui feront la sieste, ou des grands. Des baignades plus tard, quand il fera moins chaud. L’écoute de ce qui vit sous les arbres quand la guitare se tait. Quand un silence se glisse entre les choses. Ponctuation. Espaces. Le vide et le plein comme une danse étoilée. L’éternité est un grain de poussière. L’éternité est ce moment où l’on s’arrête pour voir, voir vraiment. Où le bruit de soi se rend perceptible. Ce moment où s’entrouvre ce qui vit derrière, derrière les choses.
Dany m’appelle de temps en temps. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Il est seul avec son fils de 6 mois. Il ne sait pas comment faire. Sa femme est restée en Italie. Voyage professionnel. Mais les frontières sont fermées. Elle ne peut pas rentrer en France. Il m’explique que, parfois, il ferme la porte de la chambre pour ne pas entendre l’enfant pleurer. C’est difficile, les cris d’un enfant. Il ne sait pas comment faire. Je lui raconte des histoires. Comment prendre dans les bras. Bercer. Parler. Chanter une chanson qu’on invente. Celle pour endormir. Marcher dans l’appartement. Faire la vaisselle avec le porte-bébé. Bercer encore, tu sais, quand tu bouges le corps comme ça. Tu sais ? Tu passes d’un pied sur l’autre. Toutes les femmes font ça. Elles le font naturellement. Je lui raconte comment rassurer, faire confiance au corps, dire je suis là. Je lui raconte comment être père. Un père qui est en lui et qu’il ne sait pas trouver. Et puis l’enfant sur ton ventre quand tu es allongé sur le canapé. Tu sais, il sent ta respiration. Tu sais ? Il entend ton cœur. C’est là qu’il n’y a plus de mots. Il n’y a plus besoin de mots. Et toi aussi tu le sens respirer et tu entends son cœur. Tu tombes dans ses yeux. Il tombe dans tes yeux. C’est tout. Le bébé, il a besoin de toucher du vivant. Tu comprends ? Sinon, sinon la nuit vient trop près. Sinon il faudrait qu’il cherche des mots qui n’existent pas. Tenir sa lumière pour faire naître la lumière en l’autre. Tu es son père. Tu sais. Mais tu ne sais pas que tu sais. Quelque chose sait en toi. Tu fais comme tu es. Il a besoin de ton corps pour son corps. Il a besoin d’humanité. Et toi, tu es là. C’est tout. Il n’y a pas de meilleure façon. Parler, chanter, se taire, marcher, regarder, toucher, nourrir, baigner, marcher, tenir, porter, changer, bercer, sentir, siffler, habiller, écouter, embrasser.

Confinement Covid-19 / 26 avril 202
Jour 41
Dimanche. 10 heures. Les cloches de la cathédrale. Des farandoles dans l’air. Joie. Clarté. Soleil. Le rire de Dieu qui court vers nous. Dieu ? Ou quelqu’un d’autre ou autre chose. Une cloche. Une dureté de métal. Une matérialité. Son poids. Et puis ce qui s’envole, ce qui s’échappe. Tourne, roule, éclate comme un fruit mûr. La pulpe du temps prête à notre bouche. Les cloches de la cathédrale. Ce qu’elles chantent est invisible. Elles jouent, elles sautent, elles reviennent. S’échappent encore et s’arrondissent. Elles sont sœurs de lumière. Que célèbrent-elles ? La fenêtre s’est ouverte pour mieux les entendre. Et d’autres fenêtres s’ouvrent, blanches et transparentes. Des guirlandes d’oiseaux. La légèreté. Le glissement de voiles dans le vent. Les couronnes que l’on tresse avec les fleurs sauvages. Un goût d’enfance, de liberté. Cette chanson me ramène à ce qui manque. À ce qu’il faudrait de musique à nos cœurs qui durcissent. À ce qu’il faudrait de naïveté et de patience pour que nos âmes de métal s’arrondissent. À ce qu’il faudrait de tendresse. Les cloches de la cathédrale sont venues ce matin tout près. Elles sont entrées par la fenêtre pour me dire qu’il faut laisser partir les peurs et les certitudes. Les choses petites de nous et dures. Les bouts rétrécis de nos existences. Les chambres que le temps a asséchées. Ce qui ne sait plus sonner, résonner. Ce qui a oublié comment un homme chante. Comment un homme est plus grand que lui-même. Laisser partir les rancœurs, les vengeances, les colères, pour faire toute la place au possible de nous. À ce qui a voulu naître, à ce qui n’a pas su. Devenir un être de clarté.
Est-ce que je sais pourquoi je fais ça ? Et tous ces bénévoles. Ces invisibles qui font des choses invisibles. Pourquoi ? Et qui sont là tous les jours. Et on les croise. Et on est là. Le confinement a ouvert des portes, des élans, des engagements. Ils sont à l’heure. Ils ont leur liste. Ils sont prêts. Car c’est sérieux, important, primordial. Distribuer de la nourriture. Distribuer de la nourriture à ceux qui ne peuvent pas dépenser 1 euro. Dans un grand sac, une semaine de vie. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je ne pourrais pas ne pas le faire. Et puis, parfois, il y a des choses que l’on ne sait pas de nous-mêmes. Des choses, sinon, qui nous feraient nous sentir quelqu’un d’autre. Qui nous laisseraient retomber au fond. Au fond d’une eau sale. Un endroit sans visages. Il fait noir. Il n’y a pas de sens. Ce qui est en haut. Ce qui est en bas. Une errance. Cet endroit, on le connaît. On l’a beaucoup fréquenté. Il ne sait pas qui il est. Il cherche un corps, le sien. Il cherche un cœur, le sien. Cet endroit n’a pas de nom, n’a pas de contours. Il est la perdition, l’égarement. Il fait noir. On ne voit plus ses pieds ni ses mains. Tout est trop loin ou éparpillé. Tout a disparu de qui nous sommes. Et on ne sait pas sortir de là. On ne sait pas remonter car l’informe gît en nous. Le long des murs qui se déplacent coule un liquide noir. Quand on appelle, ce sont nos cris qui reviennent. Nos cris rances, seuls, qui ne résonnent pour personne d’autre. Cet endroit, en nous, il est là toujours. Parfois on tombe. Parfois, non. On se tient debout, on sait qui l’on est. On voit nos pieds, nos mains. On sait. On ne sait pas pourquoi. Mais on sait que c’est ce qu’il faut faire. On accepte de ne pas comprendre. On y va avec joie. Car c’est un chemin qui ne tombe pas.
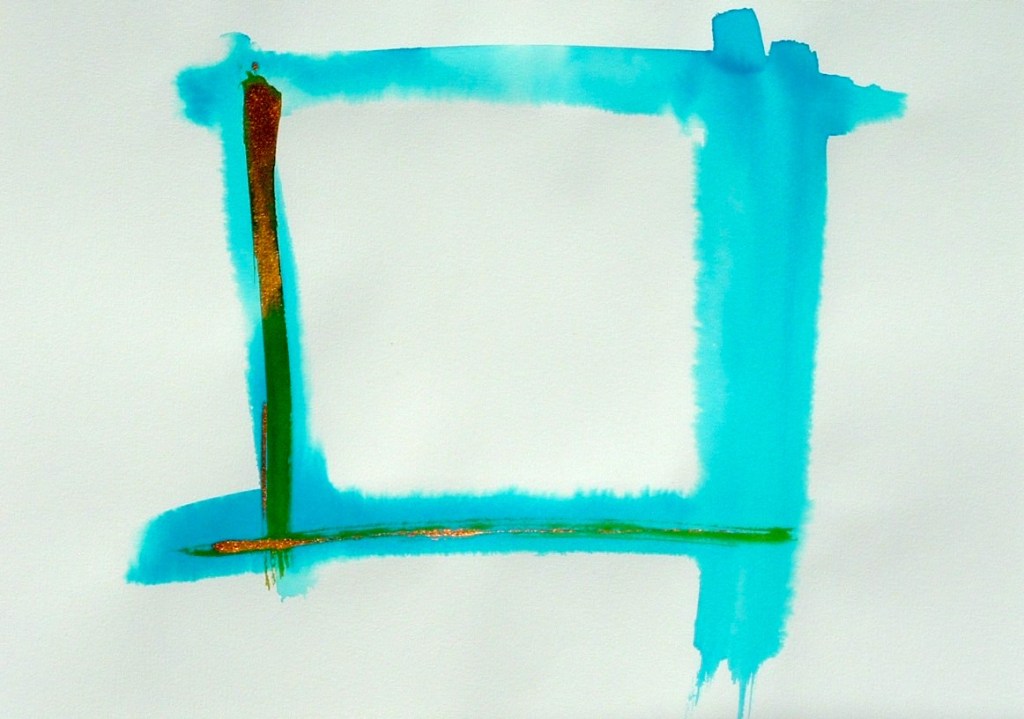
Confinement Covid-19 / 25 avril 2020
Jour 40
Haricots verts surgelés. 1,13 euros le kilo. Le moins cher. Sinon, c’est une marque. Mais à 1,25 euros. Il faudra en prendre moins. Comme je suis anorexique, je ne mange que ça. Et aussi de la purée de carottes surgelée. À 1,95 euros les 750 grammes. Vous pouvez en prendre 4. Si tout a été dévalisé, vous pouvez m’appeler quand vous êtes dans le magasin. Elle, c’est Zélia. Anorexique. Trop fatiguée pour sortir le matin. Mais quand elle va faire ses courses l’après-midi, quand elle y arrive, les rayons ont été vidés. Elle ne trouve pas les deux seuls articles qu’elle sait manger. Est-ce que je peux y aller pour elle le matin ? 7 kg de haricots verts surgelés et 4 paquets de purée de carottes. Ça fera la semaine. Et, financièrement, elle peut. N’oubliez pas de prendre le premier prix pour les haricots : 1,13 euros. Sinon, c’est beaucoup top cher : 1,25 euros ! 12 centimes de différence, quand même ! Est-ce que je compte les centimes ? Est-ce que je compte les euros ? Est-ce que je guette la hausse du prix de la farine ou du lait ? La limite. La bordure où après ça tombe. Où après on ne peut pas. Où après on a faim. On pourrait ne même pas dépenser un euro jusqu’à la fin du mois. On fera avec ce qu’on trouvera au fond d’un placard. Et puis au fond du fond. On boira beaucoup d’eau. Beaucoup d’eau toute la journée pour ne pas ressentir la faim. Tu sais, au bout d’un moment, moins tu manges moins tu manges. Ton corps s’habitue. Il se rétrécit. Il s’adapte. Et puis, Zélia, c’est déjà pas beaucoup qu’elle met dans son ventre. C’est déjà des miettes de miettes. Alors, elle sait. D’ailleurs, elle ressemble à un oiseau. Un oiseau tout petit. Un moineau. Un bébé moineau. D’ailleurs, elle se déplace avec lenteur. Il faut beaucoup de temps pour rejoindre son corps de brume, beaucoup de temps. Pour rejoindre ses os et sa carcasse. Où au milieu il y a un ventre qui parle, à qui parler. Le moins cher : 1,13 euros. Sinon, vous m’appelez. Quand on mâche de l’eau toute la journée, toute la vie, finalement, les haricots et la purée, c’est consistant, très consistant. Zélia, son corps, il s’est habitué à force d’avaler de l’eau et de se nourrir d’air. Ça fait longtemps qu’elle l’entraîne. Elle ne sait pas faire autrement. Chaque jour elle mange 1,13 euros de haricots verts ou 1,95 euros de purée de carottes. Quelques grammes pour tenir son corps sur la pointe des pieds. Jusqu’où le cœur peut encore habiter.
Synonyme de « amour ». « Attirance, affective ou physique, qu’en raison d’une certaine affinité, un être éprouve pour un autre être auquel il est uni ou qu’il cherche à s’unir par un lien généralement étroit ». Amour filial, fraternel, conjugal, paternel, maternel, amitié, bienfaisance, charité. Amour de la famille, de la patrie, de l’humanité. Attraction, sympathie, attirance, préférence, attachement, vénération. Bienveillance privilégiée. La passion. Le sentiment de l’amour. L’amour physique, platonique, de cœur. Amour naturel, amour-propre. Le parfait amour. Aimable, aimé. Chose digne d’être aimée. L’amour de l’argent, de la nature, de l’art, de la vérité. Amour des âmes. Amour universel. Passion, tendresse, cœur, inclination, goût, enthousiasme, sentiment, engouement, dévouement, tendance, sens, relation, penchant, grâce, délicatesse, attente, sensibilité, fraternité, estime, contemplation. Amour. Est-ce ce mot qui me prend toute entière ? Est-ce cette chose tournée ? Ce regard par-dessus l’épaule qui nous fait changer de direction ? Ou qui nous arrête tout simplement. Est-ce l’amour qui nous tourne, nous retourne, nous vrille ? Qui nous réveille la nuit et nous fait pleurer. Qui descend en nous comme une eau et s’installe. Qui chuchote d’autres mots. Parce qu’on sait ce que vivent les autres et qu’on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Est-ce l’amour qui nous fait dire oui. Oui, on fera des courses une fois par semaine pour cette dame et cette dame et cette dame. Pleurer, regarder, comprendre, se sentir reliée à ces destins. Ces gens que la vie n’avait pas encore placés sur notre chemin. Je me sens tel un arbre qui ressent tous les arbres, tel un être humain qui ressent tous les êtres humains. Je me sens appartenir et concernée. Les petites choses que nous faisons, parfois, ce sont de grandes choses. Et nous les faisons naturellement, comme on respire. Nous les faisons pour ne pas pleurer la nuit. Nous les faisons à notre mesure petite, petites choses. Comme des patiences dans le noir. Choses sans regard. Choses discrètes. Nous, petite mère. Les gestes, les mêmes. Et notre mère et toutes les mères du monde. Oui, le mot c’est amour. Le mot c’est mère. Les petites choses que nous faisons, parfois, ce sont de grandes choses.

Confinement Covid-19 / 24 avril 2020
Jour 39
La première chose que tu feras quand tu pourras sortir :
– La même chose que maintenant : ne pas sortir
– J’irai courir dans un champ
– Je rencontrerai Hermine pour de vrai, sans maques, sans gants et on prendra tout notre temps
– Je ne sais pas ce que je ferai
– J’irai boire un café en terrasse et j’écrirai tout ce que je perçois
– Je m’allongerai dans un parc, au soleil, et j’écouterai les oiseaux, j’écouterai vraiment
– Je serrerai la main à mon marchand de fruits et légumes, comme avant
– Moi, la première chose, ça sera d’aller à pied en centre ville pour rien et de tout bien regarder
– Je cuisinerai un grand repas pour ceux que je n’ai pas vus
– Je donnerai tout ce que j’ai trié dans ma maison
– Moi, j’irai laver ma voiture
– Je ferai une randonnée
– Je rassemblerai tous les textes écrits pendant le confinement et je me demanderai si c’est un livre
Elle a dit avec 4 euros on mange 3 jours. Elle parlait de sa mère et d’elle. C’est quand je lui ai proposé de lui faire des courses supplémentaires. Parce que le colis alimentaire hebdomadaire, c’est assez basique : farine, riz, pâtes, huile, sucre, lait. Pas d’œufs, de fruits ou de légumes. Si, 2 boîtes de petits pois. Avec 4 euros on mange 3 jours à 2. Alors, non. Le colis alimentaire, c’est très bien. Je me suis demandé dans quel monde les gens d’à côté vivaient. Je veux dire juste à côté de moi. Ceux qui sautent des repas par économie. Ceux qui ne mangent jamais de fruits, de légumes et encore moins de viande ou de poisson. Ceux qui ne mangent pas à leur faim. Dans quel monde de justesse, de choses comptées. Les choses pour nous. Les choses pas pour nous. Le minime minimal. Le minimum vital. Ce qui suffit pour tenir le corps. Ce monde où il n’y a pas d’écart, ou de plaisir ou d’envie. Où l’on calcule ce qu’on peut manger chaque jour pour survivre. Où l’on a rangé ses élans dans des boîtes qu’on ouvrira peut-être plus tard, mais c’est pas sûr. Shéhérazade a 55 ans. Elle vit avec sa mère. Elle compte. Elle compte pour deux. Elle voudrait que je sois discrète quand je lui amène son colis alimentaire, parce que les voisins, vous comprenez, ils sont curieux. Et après, ça jase dans le quartier. Oui, je vais faire attention. Parce qu’il ne faudrait pas que ça se sache, de quel côté du monde on vit. Parce que sinon, on deviendrait des pauvres, des nécessiteux. Ceux à qui on donne gratuitement et qui ne peuvent pas rendre. En échange, toutes les Shéhérazade du monde, elles ont seulement leurs yeux et leurs mots. Je vous remercie infiniment pour ce que vous faites pour nous. Ma mère et moi, nous sommes touchées. Nous ne savons pas comment vous témoigner notre reconnaissance. Et là, elle tombe dans mes yeux. Et j’essaie de tenir le coup. Et je ne sais pas tout à fait prendre ce qu’elle me donne quand elle respire dans mon regard. Le silence. Et rien. Et tout. Nous nous regardons, chacune de notre côté du monde. Elle ne sait pas dire tout, tout ce qu’elle voudrait. Elle se tait. J’ai envie de m’excuser. La rejoindre. La porter. Lui dire que ce n’est pas grave. Que rien ne mesure ce que nous donnons, ce que nous recevons. Que c’est une danse. Que ce qu’elle reçoit, elle le distribuera à d’autres. Que c’est une rivière. Je ne sais pas dire tout, tout ce que je vis. Parce que si je fais ça, c’est que ça doit bien servir à l’équilibre de ma vie. Dans mes nuits qui pleurent sur la pauvreté, sur le manque. Parce que c’est peut-être ma façon d’éteindre les frontières. Non, Shéhérazade, nous ne sommes pas ce que nous mangeons, ce que nous donnons ou recevons. Car nous sommes ce qui ne peut pas se compter. Nous sommes ce qui pleure la nuit. Ce qui s’assemble dans le cœur ou le regard. Nous sommes au-delà des frontières, des côtés, des bords glissants des sociétés.

Confinement Covid-19 / 23 avril 2020
Jour 38
J’avais attendu si longtemps. Et puis je n’attendais plus. Ce qui pouvait venir du dehors qui m’aurait fait grandir. À part les arbres et la lumière. À part quand le monde chante. Quand le dehors est aussi dedans, il n’y a plus à espérer. Il y a à s’asseoir en soi. Ouvrir les yeux. Car les arbres sont là aussi. Car les rivières. Car tendre la main n’a plus d’importance. Des lumières viennent. Des couleurs qui n’existent pas. Parfois une tache noire qui s’enfonce, qui s’enfonce. Et le temps. Quelque chose qu’on ne veut pas quitter. Mais ce n’est plus la question. Ce moment dure une éternité. Des idées de fenêtres. Des tentatives de portes. Des choses ressemblent à d’autres choses. Des filaments flottent sur l’humide des cœurs. Dedans est plein ou vide, et c’est pareil. Un sursaut qui fait tout tenir en même temps. L’épaisseur. La pulpe du corps rassemblée et toute là. Il n’y a pas de pensée. Nous tressaillons comme un arbre dans le vent. Et nous sommes un arbre. Un renard. Une rivière. Montagne de siècles amassés. Nous sommes ce que nous avons rencontré. Chaque brin d’herbe et chaque sourire. Des choses passées devant nos yeux que nous n’avons pas vraiment vues. Des choses entendues que nous n’avons pas vraiment écoutées. Tout habite en nous. Traces, piétinements et visages. Et puis les paysages qui défilaient à travers la fenêtre. Les trains. Les odeurs d’épices. Le soyeux d’une chevelure ou d’un manteau. Le rond d’une épaule. Une transparence de perle et le soleil dans lequel dansent des grains de poussière. La profondeur d’une voix. La forme d’une main. Un rideau qui bouge avec la brise. Les taches de mûres sur les doigts. La valse d’une robe. Les tables de multiplication. Le poids d’un corps d’enfant. La noirceur profonde des nuits sans lune. Le bruit des étangs. Des choses ressemblent à d’autres choses. Tout habite en nous.
Devant ma fenêtre quelques arbres, des jardins. La ville qui se perd au loin, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de ville. Une campagne d’horizon. Un aqueduc. Un crépitement d’autoroute pas temps de pluie. Et puis le bruit répété du hibou. Non, ce n’est pas un hibou. Hibou, c’est ce qu’on me disait enfant. Parce qu’on ne savait pas. Parce qu’on inventait. Car le bruit, c’est le même. Répété 3 fois. Les pigeons. Ou les tourterelles. Je ne fais pas bien la différence. Oui, les tourterelles des films, blanches. Ah, non, bien sûr : les colombes ! Dans mes arbres, ce sont plutôt des pigeons, je crois. Aujourd’hui je les observe. Ça ne ressemble pas à un chant, vraiment pas. Et il y a aussi un claquement d’ailes. Quelque chose de lourd comme un corps qui tombe et qui se retient. Les pigeons. Ça marche sur le bord des fenêtres ou des balcons. C’est une idée d’oiseaux. Oiseaux des villes qui glanent les restes des hommes. Oiseaux sans grâce sur le pavé des villes. Trop près pour être regardés, trop près des hommes. Trop là. Ceux qu’on repousse du pied. Ceux auxquels on ne prête pas attention. Ils font partie des rues, des vacarmes de poubelles, des endroits sales et abandonnés. Ils font partie de ceux qu’on ne voit plus. Des assourdissants ramassages, de la pauvreté, des détritus. Ils sont ceux de la rue. Ceux qui vivent de ce qui est jeté. Ceux dont on voudrait bien se débarrasser. Envahissants, indésirés, appauvrissants et miséreux. Mendient, reviennent quand on les chasse. Vivent d’eau sale et de pourriture. Les ceux au plumage abîmé, aux pattes estropiées. Les ceux qui survivent au bord des hommes. Prennent ce qu’on veut bien leur laisser. Ces pigeons-là, ce sont les mêmes que ceux de ma fenêtre. Ce sont les mêmes, habillés de regards de pitié et d’intolérance. Aujourd’hui, je les observe. Ils volent. Ils se posent sur une branche qui vacille sous leur poids. Ils vont par deux. J’écoute leur bruit qui est un chant. Qui ressemble à un hibou au fond des bois. Qui ressemble à la nuit quand on entend des chuchotements et qu’on ne sait pas à qui ils appartiennent. Qui ressemble à l’angoisse. À la terreur, dans un lit, car on ne sait pas toujours lire le monde. Reconnaître ses beautés, ses ressemblances et ses humanités. Regarder ce qu’il faut. Écouter ce qu’il faut. Et ne pas confondre nos noirceurs insues avec ce qui vit sous nos yeux.

Confinement Covid-19 / 22 avril 2020
Jour 37
Aujourd’hui, ça sent l’herbe et le pain. Les poivrons grillés des voisins. Aujourd’hui, ça sent la pluie. Tout rentre chez soi ou rentre dans la peau. On a froid. On a faim de lumière. Et puis, parfois, on aime cette chose sans couleur. Ce voile entre le monde et soi. Et puis, parfois, on rêve que ça dure encore. Encore, dans un lit, avec des mots qui courent, encore. Encore loin des voix et des attentes. Tout tient au creux d’une main et cela suffit. Tout s’enroule sur soi-même. C’est le ciel qui le dit. Il dit aussi qu’il sait arrêter le temps. Faire qu’une heure se goûte plus loin, plus près. Faire qu’une cuisine chante ou qu’un lit vive. La maison où s’enrober de thé. Où cuire des pommes à la cannelle. Regarder les volutes s’échapper des tasses et des tisanes. Des dessins dans l’air d’avril. Des choses perdues et attrapées. C’est le ciel qui le dit. Des lenteurs sur le canapé. Découdre des images. Ne pas lire. Ne pas chanter. S’offrir la pluie et la fenêtre. Écouter. Se souvenir d’une adolescence de brouillard et d’eau. On allait se cacher dans des livres. On vivait là quand dehors nous mouillait les paupières. On parlait avec des mots de papier. On était bien. Aujourd’hui, ça sent l’herbe et le pain. Ça sent les choses fanées et qu’on aime toucher. Fleurs séchées. Quand on se souvient. Quand la vie et le jour arrivent. Sans prévenir la main cueille du rouge et du jaune. C’est dans un champ. C’est dans une autre vie, un autre pays. C’est le presqu’été. Quand on retombe dans ce pli du temps. Dans les gestes qui ramassaient des perles, des cailloux. Des fleurs égarées et espiègles. Dans les bras qui glanaient les nuages, le vent ou l’horizon. Quand on retombe dans notre corps d’avant. Celui qui savait récolter des miracles. Mémoire. C’était hier. C’est le ciel qui le dit. Aujourd’hui, ça sent l’herbe et le pain.
Les choses abandonnables :
– les post-its collés sur la porte du frigo
– l’impatience
– les choses qu’on refuse de se forcer à faire
– les cours du lycée
– les balades en forêt où l’on pensait à notre liste de courses
– la poussière
– la difficulté de dire qui on est
– la montre de nos 8 ans qui ne fonctionne plus. On s’en souvient, c’est notre mère qui nous l’a offerte.
– le temps qu’on met à se lever
– les rides et les cheveux blancs
– la tombe de notre père
– la citation au-dessus de notre lit qui ne nous ressemble plus
– la lâcheté
– les choses qu’on n’utilise pas
– les a priori sur les gens
– les jours où on a mal parlé
– les livres qu’il faut avoir sans sa bibliothèque mais qu’on ne lira pas
– l’idée de soi
– la méchanceté
– le regret de n’avoir pas su gagner de l’argent
– les états d’âme de plomb
– les relations qu’on entretient, on ne sait pas pourquoi. Parce que ça fait longtemps, et pourquoi, parce que sinon.
– le vieillissement
– les fars à paupières qu’on a achetés à 20 ans ou qu’on nous a donnés
– le jugement de qui on n’a pas su être
– les animaux dont on s’est mal occupé
– les voyages qu’on n’a pas faits mais qu’on aurait voulu
– les souvenirs tristes
– l’image de notre profil
– la culpabilité des choses qu’on n’a pas bien faites
– les objets qu’on garde parce que c’est trop triste de les jeter
– les choses fermées en nous qui voudraient bien s’ouvrir
– la peur de ce qui vient

Confinement Covid-19 / 21 avril 2020
Jour 36
Ce qui est là, parfois, je ne sais pas le saisir. Ce qui est là s’absente dans mon regard. Et ça glisse, ou c’est moi. Et ça s’abîme dans un oubli sans nom. Et il ne reste rien. Juste moi passée à travers les choses ou traversée par elles ? Juste moi, marcheuse décidée. Je vais quelque part et je n’ai pas le temps. Ou je l’ai et je ne le sais pas ? Qui croire quand on n’entend pas les oiseaux ? Qui croire ? Quand on n’écoute pas le détachement d’une feuille. Quand personne en nous ne voit ce vert du chemin. Et les mots passants. Choses passagères. Mémoire des hommes. Et puis l’oubli et la disparition. Non, le rendez-vous, c’est à 16h. Ah ?! Tu crois ? Un nuage pose son ombre sur nous. Je lève les yeux. Le monde est une caverne de présences. Regarde. Écoute. Suis les oiseaux. Silence ton heure au bout des villes. Pour qu’enfin s’offre l’épaisseur de la vie. Pour qu’enfin être se pose au bord des branches. Qui croire ? Qui écouter qui nous dit d’aller vite, d’aller loin, d’aller fort ? De ne pas s’arrêter. On n’a pas le temps. De faire. De faire soi à l’image d’un univers de téléphones, de réussite et d’argent. Qui croire qui nous dit d’accélérer, d’accumuler, de prévoir. D’anticiper et d’organiser. On n’a pas le temps. Et moi, je dis qu’on a le temps. Je dis qu’on s’est perdu. Qu’un tourbillon nous prend et nous mâche depuis des années, des années. Et que le temps, il suffit de le regarder. Il suffit de l’écouter. Il a tant de choses à nous dire. Il a tant d’oiseaux et tant de chants. Il a tant d’arbres mouillés de pluie, tant de soleils, tant de nuits aussi et d’étoiles. Il a tant de miracles que nous ne pouvons les manger tous. Mais quelques-uns, quelques choses dispersées tombées du ciel. Et les morceaux de ciel, enclaves parfumées, que nous cueillons si nous savons les voir. Et les morceaux de ciel, petites présences minuscules, nous les récolterons quand nous marcherons vers l’être.
Les chats ont pris toute la place. Avant, non, ils se cachaient. Ils n’ont plus besoin, ils n’ont plus besoin de se cacher. Ils pavanent leur fourrure. Ils se prélassent. Maintenant que les humains sont enfermés, c’est la liberté, la liberté des chats. On les reconnaît un peu par familles. Ils se ressemblent. Sur la pointe des pattes rebord de mur. Funambules. C’est dehors, après la fenêtre. Je les regarde. Avant, non, je ne les regardais pas. Une vie de chats. Manger. Dormir. Se battre. Se cacher. Jouer. Attraper. Quelqu’un leur donne à manger tous les jours. Une dame. Elle fait le tour du quartier. Je reconnais sa voiture blanche. Des croquettes. De l’eau. Pendant le confinement aussi elle vient. Elle n’a pas oublié. Elle vient tous les jours, même le dimanche. La dame aux chats. Ils l’attendent, je crois. Elle arrive. Elle leur parle. Je ne sais pas ce qu’elle leur dit. Ce sont les chats de personne. Ceux qui font des petits dans les buissons, derrière les immeubles. Mais ils ont une dame. Je ne sais pas ce qu’elle leur dit. Quand elle a terminé de remplir plusieurs assiettes, elle les place. Puis, elle reprend sa voiture pour faire la même chose plus loin. Je le sais car je l’ai déjà vue. De ma fenêtre non. Mais dans la rue qui court, elle s’arrête encore deux fois. À des endroits précis. Ils l’attendent, je crois. Et après, je ne sais pas. C’est trop loin. Peut-être circule-t-elle dans d’autres quartiers ? Distribution de croquettes. Ne pas oublier ceux qui ont faim. Venir chaque jour. Ne pas oublier. C’est toujours la même dame. Le matin. La dame aux chats. Quelqu’un vient, transporte, dispose, verse, s’arrête, démarre, range, repart, s’arrête, dispose, verse, démarre, range, repart, transporte. Quelqu’un tous les jours. Distribution de croquettes. Ne pas oublier ceux qui ont faim.
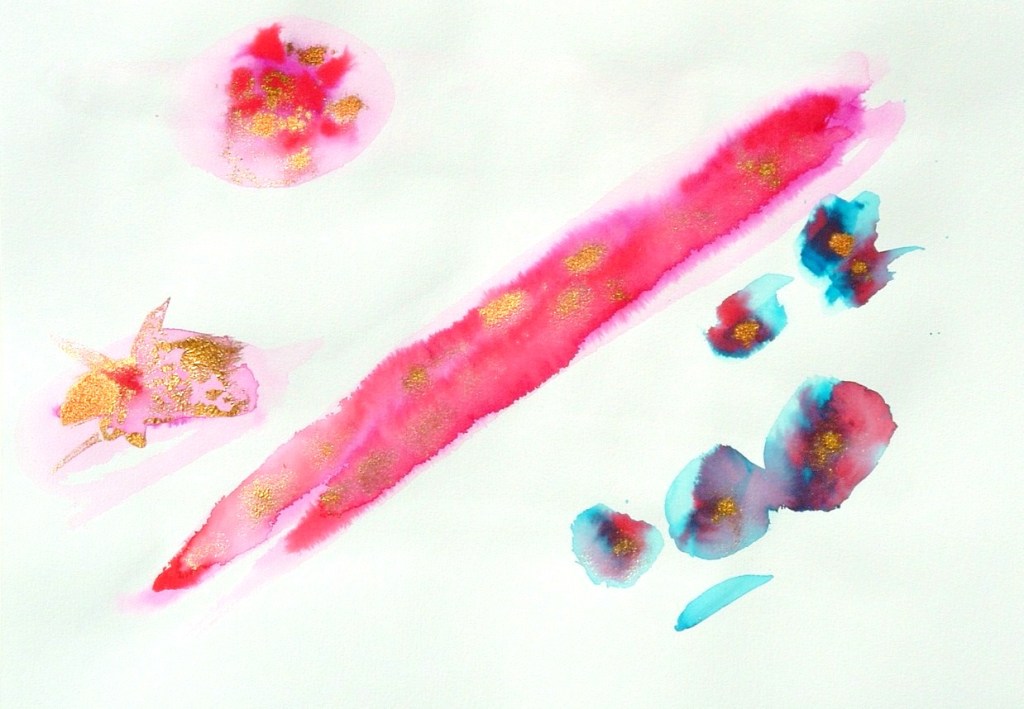
Confinement Covid-19 / 20 avril 2020
Jour 35
Hermine a besoin de médicaments. De nourriture aussi. Elle me dicte sa liste de courses. J’écoute sa voix qui vient de loin. Les petites choses qu’elle se prépare dans sa solitude de balcon. Qu’elle met dans des assiettes et des tasses. C’est un peu intime, finalement, une liste de courses. Les préférences, les douceurs, les économies, les trucs en plus. Les façons de ne pas tout prévoir. Les attentions. Et puis après ? Après le confinement ? On nous parle du 11 mai. De se déconfiner. Et après ? Est-ce qu’il n’y aura plus d’appels téléphoniques, de listes, de recherches dans les rayons des magasins ? Est-ce qu’il n’y aura plus le numéro 27 de la rue Victor Hugo ? Le poids des sacs. L’argent qu’on dépense et ce n’est pas pour nous. Et après ? Est-ce qu’il n’y aura plus d’Hermine ? De chèques à encaisser, d’écriture tremblotante ? Je ne sais pas, après. C’est la pluie du jour, sans doute. La pluie qui entre en moi. Qui va jusqu’où il ne faut pas. Qui lèche l’inconnu en soi. Y dépose l’haleine de sa tristesse. C’est la pluie du jour, sans doute. Celle qui s’aventure plus loin qu’on ne l’aurait cru. Où il y a de l’humide et du gris. Là-bas, c’est la peur qui habite. La peur qu’il arrive quelque chose, que ça change ou que ça parte. La peur de perdre des sourires ou des yeux. Que les choses nous quittent comme des peaux auxquelles on s’était habitué. Des paysages après une fenêtre. Quand on voit loin. Quand demain retrouver notre arbre, notre chemin, le bout pointu sur l’horizon. Et si tout s’en allait ? Nos rendez-vous, nos voix. Nos distances et nos rapprochements. Et si tout s’en allait du temps entre nous ? Et si tout ? C’est la pluie du jour, sans doute. Celle qui fait tomber la nuit avant l’heure. Ou tomber les étoiles. Celle qui fait disparaître jusqu’au visage sur un seuil de porte. Disparaître jusqu’au silence. Jusqu’aux mots prononcés. Jusqu’à l’absence et l’oubli. Hermine.
Avril arrive. Et puis non. Avril est déjà arrivé depuis longtemps. Il ne cesse d’arriver. Un avril comme un fil. Comme son nom. Suspendu. La pluie qui roule et blondit les champs. Dessine des chemins. Saison pleine de ce qui naît. Ce qui prépare sa naissance en cachette. Des cabanes où attendre patiemment que l’on nous découvre. Et dans l’attente, dérober des oiseaux. Dormir au creux des troncs. Écouter vivre une forêt. Ce qui ne se voit pas, existe-t-il vraiment ? Avril d’or qui cuisine sa brillance. Reste au cœur de la boue, reste encore un peu. Dis-leur que nous ne sommes pas prêts. Dis-leur le mot patience. Le mot vérité. Le mot naissance. Parle-leur du temps. De ce qu’il faut pour se construire une peau. Avril, parle-leur des papillons et des serpents. Du noir et de l’hiver. De ce que nous avons à peine quitté à peine. Et nos yeux sont fermés. Et nos mains sont fermées. Dis-leur pour l’espoir. Pour ce qui existe entre. Pour ce qu’on ne sait pas. Pour les choses qu’on ne peut pas compter. Avril, chante-leur ta chanson pour endormir. Tu sais, celle qu’on murmure tout bas ou dans sa tête. Tu sais ? La chanson des jardins semés. La chanson des fleurs sous la terre. Dans l’eau aussi, après les feuilles tombées. Humus et tous les arbres décomposés composés. Pays tout dessous. Avril, creuse encore tes membranes. Pour que le cœur des hommes ait pris tout son temps. Pour bercer les pierres et les épines de miracles. Creuse encore. Pose un manteau de brume sur ce qui festoie en silence. Cache-nous encore un peu, encore un peu. Bâtissons dans nos os. Déroulons nos bras. Arrêtons le temps pour souffler sur l’instant. Nos plumes, nos voix. Le chaud des couvées sous les branches. Patience, ombre de lune. Bientôt l’aurore. Bientôt le mouillé des étables. Bruissements au cœur de l’herbe. Serpentent des nervures. Des feuilles, des œufs. L’invisible de nous.

Confinement Covid-19 / 19 avril 2020
Jour 34
Sous les choses dorment des miracles. D’autres choses. Naissances de jaspe et d’émeraude. Des temps lointains rassemblés. Des coudes détachés du sable. Fondations. Ruines sous les ruines. Il suffit de creuser avec ses yeux. Regarde. Regarde ce que tu n’as jamais regardé. Ouvre les portes du corps pour laisser venir la lumière. Toutes les portes. Arches antiques qui ont couché tant de soleils. Êtres de brume et d’eau. Oui, toute l’eau du monde vit en toi. Vit hors de toi. Car rien n’est séparé. Ce qui respire s’enchevêtre, s’épouse, se succède en étant toujours là. Baigne tes mains aux mains du monde. Et c’est pareil. Étoiles, montagnes inaperçues, espaces vierges. Tout vibre au cœur des hommes. Et c’est pareil. Aussi ce qui n’a pas encore rencontré sa naissance. Aussi ce flottement dans tes yeux. Ou la mort et ses disparitions. Et c’est pareil. Sous les choses ou dedans ou derrière. Le temps a si peu d’importance. Où je t’emmène, toutes les époques s’embrassent. Elles contiennent ce qui tombe et ce qui se lève, l’ancien et le pas encore. La traversée de toutes les saisons. Et dans le même endroit. Et dans une chose si petite. Tout est là. Tout est prêt. Existe le même le même le même. Être. Substance lumineuse. Grain. Pluie. Racine. Sève. Rotation. Sourire. Chanter. Être. Pierre. Terre de miracle. Où je t’emmène suspend, étonne et outrepasse. Où je t’emmène est tel un oiseau et son chant. Une évidence. Un temps sans temps. Un lieu sans lieu. Être.
On a tout arrêté du jour au lendemain. On ne s’en souvient plus. C’était il y a 33 jours 8 heures et 25 minutes. On a tout arrêté. Le réveil, le matin. Se dépêcher. Le réveil des enfants. Dire il est 7h20. La table du petit déjeuner. Eau. Ouvrir le frigo. L’odeur de pain grillé. Le thé infuse. Crème de jour. Dire il est 7h40. Tu as vu, il pleut. Tu mets ton blouson vert ? Celui avec la capuche. Se dépêcher. Brancher son téléphone portable. Un enfant est déjà parti. S’habiller. Déjeuner. Déposer ses deux sacs et son manteau dans le salon. Dire il est 7h50. Je pars à 8h aujourd’hui. Tu t’en souviens ? Le poids des sacs. Prendre une pomme, une banane, barres de céréales. Repas de midi. Mettre ses chaussures. Croiser son enfant dans la salle de bains. Partager. Se maquiller. Bon, j’y vais. À ce soir ! On a tout arrêté. On ne s’en souvient plus. Il y aura les devoirs du collège. Le dîner à préparer. Le sac pour le lendemain. La liste des choses à faire. Se dépêcher. Les mails auxquels répondre. Les urgences. Accompagnement au sport. Se dépêcher. Le carnet de liaison à signer. Rentrer à la maison. 1h30 devant soi. Vider le lave-vaisselle. Plier le linge. Qu’est-ce qu’on mange demain ? Ah, oui. Noter le rendez-vous de A. Rappeler P. Imprimer les documents à remplir pour l’autorisation de K. Lui déposer ce soir dans le salon. Le faire après. Les précipitations. 20h50 partir. On va être en retard. Aller chercher un enfant. Attendre la sortie du cours. Rentrer à la maison. Dire il est 21h25. Tu peux accélérer ? Il faut que tu manges maintenant, j’ai réchauffé le plat. Au lit dans 45 minutes. Ranger la cuisine. Sortir du riz pour demain. Décongeler du poisson. On a tout arrêté. On ne s’en souvient plus.
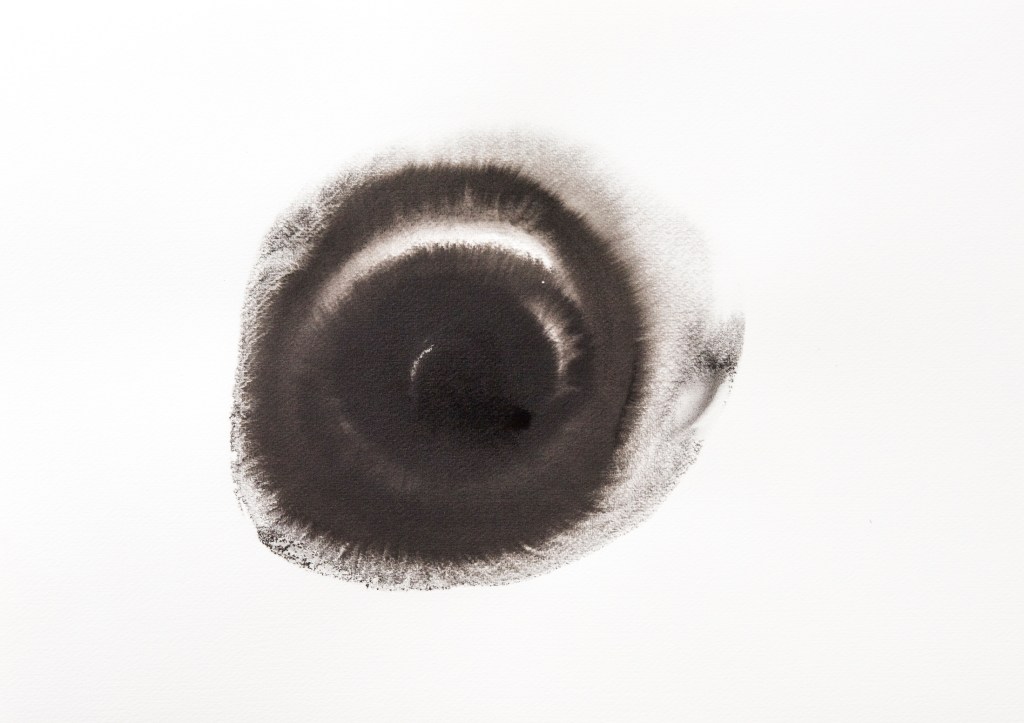
Confinement Covid-19 / 18 avril 2020
Jour 33
Mon cher pays de Bretagne. Merci de m’accueillir quand je reviens vivre en toi momentanément. Tes paysages mouvants, tes gens généreux. Je te rencontre de nouveau comme une première fois. Et puis je suis parfois triste et mélancolique. Et puis je retourne à tes paysages, tes ciels nuageux, ta sauvagerie et je suis de nouveau pleine. Je me sens ressourcée à tes plages, à tes îles et tes flaques. Et puis ta musique et puis ta danse.
Cher pays de mon enfance, j’ai tout gardé de toi et je me sens chez moi là. Je viens de toi et mon âme est bretonne. Je reviens pour sentir encore ma reliance à ta nature et marcher dans le vent et rire.
Cher pays. J’ai oublié de te dire le sentiment d’insouciance, de liberté que je ressens sur tes chemins et sur tes grèves. L’odeur de la mer et des algues me ramène à l’enfance. Ça me ramène à l’essentiel.
Cher pays de Bretagne. Je te quitte pour te retrouver. Tu fais partie de moi. Je te sens vivre en moi. Je ne sais pas vivre en toi toujours. Je sens que tu m’habites et c’est doux. Ça danse au fond de moi. Et je peux ainsi choisir la joie, prendre ta vie pour me nourrir. Je suis heureuse ainsi, loin. Je garde les bonnes choses, les marées, les éclaircies, les vents frais. Je garde les rondeurs et les chants. Le parfum des dunes, les phares et le rugueux des jours possibles. Je viens, je pars, comme une vague. Je laisse les choses de souffrance, la misère, la nuit en plein jour et les souvenirs dangereux, cabossés et malpropres. Je garde ta lumière. Merci de toi et merci de m’accueillir comme un oiseau migrateur.
Cher pays de Bretagne. Je suis loin, tu es loin. Dans cet éloignement vivent des doutes, des éclats de rire et des souvenirs. Les moments où plus rien ne comptait, ni les heures, ni les jours. Où perdre ses yeux sur la mer était notre occupation. Dans cet éloignement habite ce goût sur la langue. Quand nous buvions ton eau de pluie, ton eau salée pour la garder en nous encore longtemps. Quand nous marchions sans fin à ton bord et que tout partait et revenait. Il suffisait d’attendre. Mes mains font les mêmes gestes et je ne sais pas pourquoi. L’attente ou l’être ou la substance. Le debout des matins. Le vent au rendez-vous. Les nuages passagers clandestins. Mes mains font les mêmes gestes. Caresser les « chatons », fleurs de dunes. S’allonger dans les fougères. Donner son visage au ciel. Suivre le vol des goélands. Écouter le murmure des marées. Marcher sur l’eau vers des îles inhabitées. Vers des terres ou des terriers. Choses perdues au milieu de la mer. À perte perte de vue. Choses tenues dans nos regards d’enfant, dans l’adolescence et dans le maintenant. Chose la même. Paysage attrapé, échappé du vivant. Pays de nuit et de lumières. Mes mains font les mêmes gestes. Je ne sais pas pourquoi.
Depuis plusieurs jours j’ai envie de pleurer. Je ne n’y arrive pas. C’est au bord. Prêt à tomber. C’est prêt à ouvrir la main et à laisser quelque chose partir. Et puis ça se retient. Depuis quelques jours. Fleur qui meurt pour faire naître un fruit. Sur les côtés les pétales se rident, sèchent, s’étiolent. Ou se contractent. Une dernière respiration. C’est le passage de la nuit au jour. Celui qu’on ne voit pas. C’est ce moment précis où se défait la vie pour une autre vie. Il faut perdre pour gagner. Il faut abandonner. J’entends le détachement des fleurs. Chaque creux fait un bruit de tombe et d’oubli. Chaque ondulation se fige. Quelque chose pousse. Quelque chose pousse sous la peau des matins. Naître naître naître. Perdre ses dents de lait. Perdre les bras de maman parce qu’on a trop grandi. J’ai envie de pleurer. Ce que nous laissons sur le chemin s’appelle passé ou moi ou vie. Oui, il faut s’alléger de nous-même. Les vieux vêtements, les cailloux, les bijoux. Les gens. Marcher. Se retourner une dernière fois pour voir le chemin parcouru. Marcher. Être ce fruit sur cette branche. Avoir quitté sa fleur, sa naissance, son origine. J’ai envie de pleurer. Je n’y arrive pas. Je tiens encore les choses qui ne peuvent pas vivre ensemble. Le printemps dans l’hiver. Le jour dans la nuit. Passage pour grandir. Un pont dans l’invisible du temps. Je sais que je suis déjà en route. Il reste un pétale ou peut-être deux. Quitter demande du silence et du froid. De la solitude. Un monde éloigné. Un monde mutique et nomade. Quitter est un autre voyage. Destination incertaine. D’ailleurs, y a-t-il une destination ? Destination inconnue. D’ailleurs, où allons-nous ? Quelle est cette force humaine qui nous met debout ? Quelle est cette force du vivant ? Devenir est un travail. Devenir. Je regarde les arbres et ce qu’ils fabriquent de grandeur. Il y en a un sous ma fenêtre. Et chaque jour. Et chaque nuit. Nous avons rendez-vous comme devant un miroir. J’écoute le chant de la sève. Ce qui se déploie caché au cœur du bois. Moi aussi j’ai un cœur de bois qui dorlote la nuit. Moi aussi. Et, mon arbre et moi, nous vivons chaque saison afin de devenir.

Confinement Covid-19 / 17 avril 2020
Jour 32
Colis alimentaire. Attendre. Quelqu’un a le droit à un colis alimentaire. Quelqu’un ne doit pas sortir. Trop fragile. Un virus pourrait l’attraper et alors, et alors, on ne sait pas ce qu’il ferait d’elle. Elle, c’est Shéhérazade. Asthmatique. Elle vit avec sa mère qui est cardiaque. Pas sortir. Elle me tend sa carte d’identité pour que je récupère son colis. Elle me remercie de faire ce que je fais. Elle est étonnée. Une inconnue qui. Je pars. J’attends. J’attends pour elle. C’est long. Il y a beaucoup de personnes venues chercher leurs colis alimentaires hebdomadaires. J’attends. Je suis ses jambes et ses bras. Je suis ses yeux. Ses sourires et ses mains. J’attends avec tous les autres. Les femmes, les enfants, les hommes, les étudiants, les personnes âgées. Des gens vont me donner de quoi manger pour une semaine. Et je reviendrai. On se dira à la semaine prochaine. Sous le soleil. Un homme a posé un sac sur sa tête. Quelqu’un propose de l’eau à boire. Des gens se rencontrent. À vendredi. Des sacs, des cabas à roulettes. Des masques. Des gants. Des bénévoles. On nous donne. De quoi tenir une semaine. Du riz, des pâtes, de l’huile. De la farine. Du lait. Les gens disent moi aussi c’est la première fois. Du sucre en morceaux. Deux boîtes de petits pois. C’est lourd. Deux boîtes de sardines. C’est pour deux personnes. De quoi tenir une semaine. À vendredi. Je remonte la pente avec mes sacs. Sous le soleil. Je rejoins ma voiture. Je roule vers Shéhérazade et sa mère. Je dépose les denrées dans un sac dans le hall de l’immeuble. Je ne dois pas rentrer chez elle. Elle me remercie. Deux heures d’attente pour une semaine de nourriture. Je rentre chez moi. La voix de Shéhérazade dans mon téléphone. Ma mère vous remercie. Elle est très touchée par ce que vous faites pour nous. Elle vous remercie infiniment. Moi aussi je suis touchée, émue. Comme un grand rassemblement de sentiments. Faire des courses pour des gens qu’on ne connaît pas. Ça me rassemble. Ça me relie au reste du monde. Ça ouvre un espace incroyablement grand. L’inconnu, la confiance, l’attention, les mots qu’on dit, les gestes. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes dans l’appartenance. Ce qui soutient Shéhérazade me soutient aussi. Rendez-vous. Je me sens utile. Je me sens faire partie. Cette chose humaine m’aide. Je cherche du sens et je le trouve. Et puis la base : manger. Comment laisser ces personnes sans aide ? Sans ce qu’il faut pour être humain ? Je me sens humaine. Et je sens que tous les autres sont humains. Tous ceux qui, comme moi, sont bénévoles. Donnent du temps, de l’énergie. Donnent. Habitent les mains qu’on tend aux autres. Et puis, un jour, nous serons peut-être de l’autre côté. À vendredi. Et tous les invisibles se donnent rendez-vous dans la conscience du monde. À vendredi.
Nous étions mal préparés à l’amour. Nous étions des êtres terrestres, terrestrement las. Nous courions derrière quelque chose d’autre. Un plus grand, un plus beau, un plus fort. Nous courions derrière des propriétés et des conquêtes. Nous pensions que ce que nous prenions amplifiait notre bonheur. Nous voulions l’accroître toujours davantage. Engranger, entreposer, garder. Nous coupions, nous enfermions, nous possédions. Mais le bonheur était toujours loin, ailleurs, un autre jour. Nous courions. Car marcher n’aurait pas suffit. Car vivre. Nous étions mal préparés à l’amour. Si mal. Nous prolongions ce que nos ancêtres et les ancêtres de nos ancêtres et les ancêtres des ancêtres de nos ancêtres. Nous, conquérants, qui partions sur les mers pour une guerre ignorée. Nous, qui cassions les montagnes pour aller plus vite. Qui éventrions la terre pour des autoroutes de soleils. Et le plus vite va plus vite. Et le bonheur à grossir est une poche d’espérance. Sac d’illusions. Car nous voulons augmenter ce qui est dehors. Des choses visibles, voyantes. Des idées de nous grands. Des maisons, des voitures, des costumes. Des voyages pour dire qu’on. Des choses qui ne suffisent pas, qui appellent d’autres choses. De l’argent. Des biens. Nous étions mal préparés à l’amour. Nous nous sommes trompés. Ce qui brille dehors ne peut pas me faire exister. C’est ce qui court après soi-même. Ce qui court sans fin. Ce qui prend toute la place. Ce qui dit je n’ai pas le choix. Ce qui se donne de bonnes raisons. Ce qui fait comme on lui a dit de faire. Ce qui achète ce qu’on lui dit d’acheter. Ce qui va vite. Si vite qu’on ne peut plus s’arrêter. Parce qu’on s’accroche à cette idée de la réussite. Parce que l’idée masque l’existence. Ou le vide. Ou le rien. Dehors est énorme parce que dedans est déserté. Désertique désert. Le silence. L’immobilité. Le sentiment intérieur. Le goût de soi. La vie sans regard. La vie sans preuve de son importance. La vie. Et dedans crie. Et dedans pleure. Abandonné. Seul. Territoire sauvage dépeuplé. On ne passe plus par là. On vit dans une société. On croit qu’on vit. On a oublié d’être vivant. Mal préparés à l’amour.

Confinement Covid-19 / 16 avril 2020
Jour 31
Vent. Celui qui glisse sa main sans poids au cœur des arbres. Celui qui égrène les oiseaux. Quelque chose bouge dans les yeux du temps. Quelque chose déplace le pays comme un drap qui sèche. Ce sont nos mémoires fanées secouées dans le jour. Ce sont les bruissements du printemps. Ce qui frissonne le ciel et chahute l’herbe. Vent. Incline les humains. Leur offre le spectacle du monde. Les rides des rivières, l’avancée du sable. La robe des pierres recouverte de paille. Le vent craque, claque, allume des rues oubliées. Il rassemble des chants. Des voix d’abeilles. Des butinages incertains. Il tombe et il tombe. Il court et il court. Il retient sa respiration pour ne pas être entendu. Marche à petits pas sur l’horizon des toits. Grimpe le long des murs. Accorde ce qui est séparé. Le vent m’apporte des parfums, des pollens qui ont beaucoup voyagé. Des idées de choses qui n’existent pas où je vis. Ce qui brille, vibre et tressaille. Ce qui arrive en courant. La caresse des arbres et la pliure des fenêtres. L’attente des nuages. L’attente de la pluie. Le souvenir d’océans parcourus de bourrasques. Les cheveux mouillés. Le souvenir d’une solitude d’oiseaux. Quand rien ne chante. Quand rien ne rit. Le vent bouscule ce qui semblait tenir debout. La joie du vent. Le cri de ce qui devance sa mort. Qui tourne, qui danse peut-être. Qui roule sa pente. Ce qui se relève de nous. Ce qui se lève. Lève aussi son corps, sa hauteur. Ce qui lève sa voix et ses yeux. Je suis debout. C’est le vent qui l’a dit. Je suis grande. Je suis tout ce qui vit. Ce qui souvenir, se déploie, boit ailleurs. Je suis ce qui valse et chantonne. Ce qui brille, flambe, bouscule et tourbillonne. Je suis ce qui tressaille. Je suis ce qui vibre, ce qui égrène, ce qui voyage. Ce qui claque, craque et allume. Ce qui bouge, ce qui déplace et ce qui vole. Je suis ce qui butine, ce qui court, ce qui grimpe. Ce qui tournoie, ce qui bouscule, ce qui recouvre, ce qui caresse, ce qui tornade, ce qui secoue, ce qui roule, ce qui se souvient, ce qui arrive, ce qui retient, ce qui rassemble, ce qui oublie, ce qui rit, ce qui devance sa mort. Je suis ce qui se lève. C’est le vent qui l’a dit.
Renard, d’où viens-tu ? Ne sais-tu pas que la forêt a brûlé ? Tu arrives. Tu t’assois et me regardes. Tu attends. Tu parles un langage de silence et de feuille. Et moi, je dois comprendre. La première fois, nos yeux suffisaient. Et maintenant, je dois faire quelque chose. Et je ne sais pas. Crois-tu que je peux convaincre les chasseurs ? Crois-tu ? Et réparer les arbres ? Crois-tu qu’on puisse revenir à avant avant ? Ce temps d’insouciance et de liberté ? Tout était grand. Et nous savions vivre. Renard, d’où viens-tu ? Où est ton terrier d’or ? Où est ta rousseur ? Ton pas furtif. Tu t’assois, tu attends. Et moi, la nuit, je ne dors pas. Car tu viens hanter mes heures. Comment bricoler les fleurs que nous avons piétinées ? Comment rendre l’eau aux terres assoiffées ? Nous avons transporté nos déserts. Nous avons construit des puits pour enfermer nos morts. Avons tenu le soleil en laisse. Et tu viens à moi pour sauver, sauver quoi ? Est-ce que je peux ranimer ce que j’ai fait mourir ? Quand je prends le monde dans ma main, il ne reste que du sable. Une chose friable qui coule entre les doigts. Ça ne peut plus s’attraper. Ça ne peut plus. Ça ne tient plus debout. Ça ne tient plus. Renard, d’où viens-tu ? Tu espères un miracle, un mirage. Une lumière qui rende la terre toute neuve. Une lumière qui efface ce que nous avons fait. Car nous sommes tous meurtriers, nous, les hommes. Les hommes civilisés. Renard, le sais-tu ? Je ne peux rien faire pour toi. Le sais-tu ? Mais toi, tu peux faire quelque chose pour moi. Je m’assois, je te regarde. J’attends. Je parle un langage de silence et de feuille. Et toi, tu dois comprendre. La première fois, nos yeux suffiront. Et puis tu devras faire quelque chose. Et tu sauras. Me montrer un chemin d’insouciance, de liberté. Tout est grand. Et nous saurons vivre. Un chemin mirabelle. Un endroit simple et lumineux comme une forêt. Une chose fraîche. Une mousse sous la pierre. Tu sauras me montrer une vie petite pleine de fleurs ensauvagées. Une eau jaillissante. Des terres bues. Des prairies fertiles et des puits d’où sortiront nos morts. Le soleil délaissé et vainqueur. Un pays où vivre avec toi. Où marcher entre les arbres de sèves retrouvées. Où bâtir nos terriers d’or. Renard. Avec toi pour savoir d’où nous venons.

Confinement Covid-19 / 15 avril 2020
Jour 30
Demain nous arrondit les joues. Il passe sa langue sur nos paupières pour nous faire goûter les heures attendues. Demain glisse dans nos mains le parfum des cerises. Tu sais, c’est bientôt, quand les arbres seront prêts. Tu sais, quand notre bouche s’offrira au soleil de mai. On y mettra les pluies d’avril. On y mettra les abeilles qu’il a fallu pour construire un arbre. Le vent. Oui, il faut beaucoup de vent pour éclore une cerise. Le chemin qui mène. L’ombre qui voyage. On y mettra les cailloux. Ceux qu’on ramasse parfois et ceux qu’on laisse à la liberté des champs. On mettra aussi, dans notre bouche, le temps. Ce qu’il a fallu de patience pour les fleurs et les noyaux. Ce qu’il a fallu d’invisible saveur. De sève. De racines. Un temps égrené, petit, composé. Un futur proche. Un temps qu’on ne peut pas compter. Qui a enjambé des hivers et des nuits. Qui a croisé des oiseaux. Oui, toutes ces heures, ces minutes où le monde se préparait. Toutes ces heures, ces minutes, rassemblées en un rouge flamboyant, une rondeur. Une seule cerise qui embrasse le monde. Dans notre bouche, on mettra toutes les branches, tous les nuages. Un regard de montagne. L’eau qui va. Toutes les mains sur tous les troncs. Ce qu’on ne cueille pas. Ce qui ne pousse plus. Oui, on mettra aussi la mort des choses. Ce qui est né. Ce qui n’a pas su naître. Ce qui s’est arrêté. Ce qui s’est précipité. Ce qui est si lent qu’un homme ne peut le voir grandir. Ce qui attend encore. Ce qui n’est pas prêt, apprêté pour ce jour. Dans notre bouche, on mettra la poussière. Le sable venu de loin. Les bruits d’une feuille qui éclot. Ce qui vient, ce qui part. Tu sais, c’est bientôt, quand les arbres seront prêts. Tu sais, quand notre bouche s’offrira au soleil de mai. Cerise.
Je suis allongée sur une rivière. Oui, sur. C’est un peu étrange. Comme si j’étais plate. Comme si j’avais perdu mes dimensions, mon épaisseur. C’est comme une grande image de moi. Oui, c’est cela. Une affiche de moi qui flotte sur la rivière. Qui épouse les vaguelettes, les remous. Et la rivière va. Et je vais aussi. Emportée. Portée. Je glisse. Je me laisse emmener. Mon visage est tourné vers le ciel. Mes yeux sont ouverts. Mes mains sont posées sur ma poitrine, l’une sur l’autre. Mon corps est plat comme dégonflé et sans vie. Et le voyage dure, dure vraiment longtemps. J’ai la patience des anges. Et la rivière va. Et la course prend fin. La rivière arrive sur une plage. Une plage de sable fin. Elle s’arrête devant la mer. Il fait beau. Il fait bleu. Je suis toujours allongée et je sens que je gonfle. C’est comme si tout ce que j’avais traversé dans la rivière prenait place. Tout ce que la rivière a traversé prend forme. Les saisons et les oiseaux. Les insectes. Les feuilles mortes, les brindilles. Les boues d’il y a plusieurs siècles et l’usure des pierres. Les poissons, les œufs, les pluies. Les montagnes habitées. Les racines et les creux. Les choses mortes. Les choses vivantes. Les choses qui ne savent pas. Le vert. Le bleu. Ce qui coule sans fin. Le vent. La lumière et la nuit. La rosée. Ce qui éclot. Ce qui est dévoré. Ce qui s’accouple. Ce qui patiente. Ce qui meurt et ce qui rampe. Ce qui nage. Ce qui ondoie sous la lune. Le reflet des jours qu’on ne peut pas compter. Les mains perdues sur l’onde. Les yeux. Les bateaux. Les troncs. Les voix passées par hasard. Ceux qui viennent boire. Ceux qui se baignent. La paresse. La volupté. La lenteur et la force. Le museau des hivers. La neige. D’autres ruisseaux. D’autres orages. D’autres tissus oubliés et des outils perdus. Ce qu’on cherche. Ce qu’on ne trouve plus. Ce qui se noie. Ce qui flotte. L’ombre des nuages. L’ombre des troupeaux. Tout ce que la rivière a traversé prend forme. Et je sens que je gonfle. Je suis épaisse comme une femme. Ce qui grossit est moi. Moi, habitée de mille feux, et de voix et de larmes qui couleront plus tard. Et la rivière me redresse. Et je suis debout. Je suis debout dans l’étonnement de ce voyage. L’étonnement de cette plage. Et je crois que je marche. Et je marche. Et je crois que je parle. Et je parle. Je m’avance vers une mer qui m’attendait depuis longtemps. Mes yeux disent je suis là. Je suis debout.

Confinement Covid-19 / 14 avril 2020
Jour 29
En réanimation. Ça bipe. Ça tube. Des fils qui nous relient. Des câbles qui nous rattachent. Ça voudrait nous redonner quelque chose qui s’en va. Ça voudrait nous ramener. Je pars. J’arrive. Je ne sais pas. Je dors. Des choses s’agitent, s’affolent, se trompent. Des choses se croient fortes. De l’eau qui coule. Des lumières qui tournent. Des blouses bleues. Des masques. Des choses dans les veines. Tubes. Pinces. Cathéters. Canules. Oxygène. Des voix disent on ne sait pas si on pourra le sauver. Brancher. Fixer. Scotcher. Intuber. Bip. Courbe. Infirmière. Bruit métallique. De l’eau qui coule. Chuchotements. Je me réveille. Je ne peux pas ouvrir les yeux. J’ai mal. Dans mes veines. Poumons. Bouger non. Manger non. Manger dans tube dans bras. Je pars. J’oublie. Je ne sais pas ce que je fais là. J’ai soif. Infirmière. Une présence. Bleu. Courbe. Quelqu’un me touche. De l’eau qui coule. Tracé. Seringue. Gants. Yeux. J’arrive. Je flotte. Je reviens d’un endroit bleu. Un endroit sans souffrance. Je tangue. Je bascule. Je quitte. Je me sépare. Des fils me rattachent, me ramènent. De l’eau qui coule. Numéros. Des tubes. Draps. Des choses veulent que je reste dans ce monde-là. Réanimation. La vie veut partir et eux ils disent non il faut rester encore un peu. Je reste encore un peu. Je nais plusieurs fois sur un lit, dans des aiguilles. Je nais dans des écrans d’ordinateurs, dans des transparences et des trucs aseptisés. Je nais sous un masque, dans des plastiques garantis. Je nais encore de ce qui monte et qui descend. Je ne sais pas le nom. Des gens tiennent mon corps haut pour qu’il s’ensoleille. Des gens tiennent mon corps longtemps. Il faut appeler le médecin. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on pourra le sauver. De l’eau qui coule. Une chose bleue approche. Une main ? Un corps entier ? Des yeux ? Se penche. Manipule des tuyaux, tuyauteries qui conduisent la vie. Change la poche. Fixe. Mesure. Part faire la même chose, la même chose. Chambre 27. Chambre 39. Chambre 12. Je vais. Je viens. Je nage. Je vole peut-être. De l’eau qui coule. Je suis un numéro qu’on mettra dans une case : les survivants ou le nombre de morts. Je ne sais pas. J’habite ailleurs. Au-delà du mal. Puis je vis dans la foule des souffrances. Puis. Une présence. Une présence bleue. La même ? Je ne sais pas. J’oublie. Je dors. Je ne dors pas. Quelqu’un s’assoit sur mes poumons. Quelqu’un pose sa main de mort dans ma bouche. J’ai chaud. Je ne sais pas. De l’eau qui coule. Je bascule. Je bascule de quel côté ? Chambre 8. Un gant. Lumière. Ça sonne. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on pourra le sauver.
Elles vont repartir. Je les regarde comme des choses qu’on pourrait oublier. Ce qui s’efface parfois quand le temps passe sa langue dessus. Le dessin d’un sourcil, le grain d’une voix. Le poids d’une main. La trace des gens. Ce qu’ils ne rangent pas. Une chaussette, l’éponge pour essuyer la table, les cheveux dans la salle de bains, la tasse. Et puis le bruit de leur présence. Une musique, un mot. Une porte qui s’ouvre. Des pas dans le couloir. Elles vont repartir chez leur père. 10 jours. Et quand je les retrouverai, il y aura des choses plus grandes entre nous. Des moments que je n’aurai pas vécus, des jambes plus allongées, des rousseurs attrapées au soleil, des fruits dans des ventres. Nous aurons accompli nos temps séparés. Ces espaces insus faits d’ignorance et de puits. Oui, des puits sans fond, sans fin. Des absences magnifiques où marcher sur des chemins amis. Des paysages que j’aurai contemplés sans elles. Et le soleil qui se couche seulement chez moi pour moi toute seule. Et dans ces jours éloignés moi aussi je grandis. Je porte des robes et des rubans. Je chante et je silence. Je rêve en moi-même. Je déambule mon cœur sur des fils de laine suspendus. Suspendus au-dessus des rivières. Les poissons y boivent. Les oiseaux y boivent. Car dans mon cœur naît toute l’eau du monde. Des nuits, des lunes, des mots qui remplissent des cahiers. Dans mon cœur des tables champêtres. Et deux petites présences qui sont là quand elles ne sont pas là. Tout vit deux fois. Tout rit. Ce qui paraît. Ce qui disparaît. Tout voyage et rencontre. Il suffit d’être et tout est là. La solitude, la foule, l’amitié, l’amour. Je contiens chaque seconde, chaque planète, chaque humain. Je contiens le silence et le bruit. Et quand je ferme les yeux le monde s’ouvre. Et quand je ferme les yeux. C’est là que j’habite.

Confinement Covid-19 / 13 avril 2020
Jour 28
Chocolat. Pâques. Calendrier. Cacher des œufs. Cacher des œufs ? Oui, dans la maison. Cacher des œufs dans la maison. Œufs en chocolat. Tradition. Un panier pour ramasser. Partager. Chercher. S’amuser. Croire que ça tombe du ciel. Ou d’une cloche. Que c’est envoyé par les oiseaux. Pâques. Manger. Manger trop. Chocolat. C’est pas grave. Demain on fera attention. Non, parce qu’il en restera. En manger pendant 3 jours. En manger trop. C’est pas grave. Plus rien n’est grave. On peut grossir, avoir mal au ventre. C’est pas grave. Y’a plus personne qui nous regarde. On peut fêter Pâques tous les jours ou plusieurs fois pas jour. On peut fêter Noël aussi et puis notre anniversaire. On peut faire tout ce qu’on veut. On peut vivre le même jour chaque jour. Souffler des bougies tout seul. Chercher les œufs qu’on a soi-même cachés. Essayer de deviner où ils sont. Cuisiner pour 3 ou 4. Mettre d’autres assiettes pour faire croire qu’il y a des invités. On peut ouvrir une bouteille de vin pour la partager et la boire tout seul. On peut parler à notre verre, notre fourchette. Parler aux murs, au miroir, à notre chaussette. Parler à notre ordinateur, notre cahier. Se confier à quelqu’un. Un imaginaire qui est là depuis quelque temps. On peut cocher les jours qui passent dans le calendrier. Un peu comme les prisonniers. Saisir ce qui avance sans nous. Pointer à cette date et cette autre date. Faire notre travail d’humain. Savoir le jour, l’heure, l’année. Ne pas rater ce qui est marqué dans notre agenda. Les fêtes, le jour des crêpes, le printemps, la lune rose ou une éclipse. Un jour férié. Aujourd’hui, c’est un jour férié ! Les rendez-vous prévus en mai. Le dentiste. Annulé. L’ostéopathe. Le coiffeur. Annulés. Ce qui marche inexorablement et on aimerait bien en faire partie. On parle à notre agenda. À ceux qui sont notés et qu’on ne pourra pas voir. On se demande, on se demande. On tombe de temps en temps sur un œuf de Pâques qu’on avait oublié, qu’on n’avait pas trouvé. Et l’on n’est pas si sûr que c’est nous qui l’avions caché là. Et l’on n’est pas si sûr. On parle.
Des mains nous prennent, des bras. Des voix petites nous demandent. Elles ont faim. Elles ont sommeil. Elles ont des questions ou des humeurs. Elles ont des tristesses, des incertitudes, des agacements. Des jalousies. Des peurs, des joies, des satisfactions. Des curiosités, des gourmandises, des peaux sèches, des yeux fatigués. Des énergies, des sourires, des mobilités, des doutes, des contradictions, des ongles longs. Elles ont des dessins, des mathématiques à comprendre, des pas de danse, des exclamations, des livres à lire. Elles ont des envies de sortir, de dormir tard, de voir un film, de bonbons, de téléphoner aux copines, d’étudier, de se faire un masque de beauté, de rester sur le canapé. Elles arrivent dans ma maison d’écriture. Ce sont mes filles. Elles arrivent avec la vie. Ce n’est pas une vie de papier, non. Ce n’est pas une vie de stylo. C’est une vie parfumée, ronde, et qui sait parler. C’est une vie qu’on peut tenir dans les bras, qu’on peut embrasser dans le cou. Et cette vie, on peut lui caresser les cheveux, l’écouter, l’écouter longtemps. On peut lui faire à manger, la prendre sur les genoux. Sentir son poids et sa force. Se souvenir de quand elle était petite et fragile et qu’elle ne pesait presque rien. Oh, presque rien. On peut la toucher du bout des doigts, la bercer encore un peu. Lui chuchoter des choses tendres, comme des mots, des bouts de chansons. Des choses d’amour. Verser sur cette vie d’enfance encore un peu de nous. Pour qu’elle grandisse au soleil des jours. Pour qu’elle mange encore dans la main du printemps. Parce que, bientôt, cette vie, elle s’en ira sans nous. Elle portera en elle ce que nous aurons déposé de fleurs, de pays sucrés, de regards d’été. Et puis, tous les mots, elle les emportera. Tous les mots murmurés et aussi ceux qu’on n’aura pas dits. Les mots soleils, les mots ombres. Les mots qui embaument et ceux qui griffent. Les mots qui donnent à manger, les mots qui glissent, ceux qui font voyager et ceux qui hésitent. Les mots rugueux qu’on n’avait pas voulus, les mots qui durent longtemps. Et la vie d’enfance partira aussi en emportant ce que nous avons été toutes ces années. Ce que nous n’avons pas su être, ce qui dort en nous que nous ne voulons pas rencontrer. Cette vie bleue sans nous avec nous. Nous la regarderons partir, et nous écrirons, dans notre petit cahier, tous les mots que nous n’avons pas su lui dire.

Confinement Covid-19 / 12 avril 2020
Jour 27
Dans mon rêve, cette nuit, il y avait un bébé mort. Il attendait. Il attendait ce qu’on allait faire de lui. Il était mort depuis quelque temps. Il était allongé dans un lit d’adulte, sur le côté. Une couverture de laine recouvrait son petit corps. Ses yeux étaient fermés comme s’il dormait. Et je disais à l’homme qui était là que maintenant il fallait qu’on le prenne. Et je ne pouvais pas le prendre. Qu’il fallait qu’on le mette quelque part. Et je ne savais pas où le mettre. J’étais devant ce lit, devant les yeux fermés de ce bébé mort. Je savais qu’on avait laissé trop de temps entre nous et lui. Je savais que, dans d’autres rêves, il attendait dans son petit lit. Je me demandais comment on pouvait tenir la mort dans nos bras et rester vivant. Est-ce que le bébé pouvait nous emporter où il vit ? Je me demandais comment on pouvait tenir les yeux fermés des autres. Le rêve s’est arrêté ou perdu ou je ne m’en souviens plus. Et je reste avec ce bébé et je ne sais pas quoi faire. Je ne peux plus l’abandonner maintenant que je suis revenue. Je reste. Je reste des jours entiers devant ce bébé mort, sa couverture, son attente. Lui, il sait, il sait ce que je dois faire. Le prendre dans les bras, le bercer encore un peu, lui chanter une chanson du soir, celle pour endormir. Lui caresser le front avec mon pouce, à cet endroit entre les sourcils. Lui parler doucement. Lui dire « n’aie pas peur, je suis là ». Lui remonter la couverture pour qu’il n’ait pas froid. Car là-bas où il va, il fait noir. Car là-bas c’est l’hiver. « N’aie pas peur, je suis là ». Prendre sa main encore. Toucher ses os. « Tu sais, dans la terre, tout pousse et grandit ses racines. Tu sais ? ». « Et puis je te laisserai ta couverture et aussi ton doudou ». Je suis allée dans un jardin. Il faisait nuit. Je tenais le poids des autres dans mes bras. Je tenais le monde. J’ai creusé avec mes mains. Tu sais, pour un si petit corps, il faut une petite tombe. J’ai creusé. « Attends encore un peu, ce n’est pas prêt ». Il était sage, ce bébé. Et il a attendu. Et puis je l’ai bien enroulé dans sa couverture. Et puis j’ai posé son doudou contre sa joue. Je l’ai mis sur le côté. « Tu vois, tu seras bien ici ». « Tu sais, dans la terre, tout pousse et grandit ses racines ». Adieu. Je te retrouverai.
Ça pourrait ne jamais s’arrêter. Je veux dire ce temps. Je veux dire cette chose insensée, cette vie à moitié. Ça pourrait ne jamais s’arrêter. Et il y aurait un avant, c’est tout. Et aujourd’hui s’effilocherait ou pourrait s’étirer pour toujours. Un aujourd’hui avec des autorisations et des interdictions. Un aujourd’hui, le même. Et si ça dure. Et si ce qu’on vit maintenant s’installe ? Je veux dire comme quelqu’un qu’on invite pour quelques jours et qui reste des années et on ne sait pas comment s’en débarrasser. Et chaque jour est une attente. On veut revenir à avant. On attend que cet intrus s’en aille. D’ailleurs, l’a-t-on vraiment invité ? D’ailleurs nous a-t-il demandé la permission de s’installer chez nous ? D’ailleurs, qui est-ce ? Le connaît-on ? Et cette chose nouvelle est arrivée. Et maintenant, il faut partager. Je veux dire qu’il y a quelqu’un dans la salle de bains, quelqu’un qui prend des choses dans notre frigo. Je veux dire qu’il y a quelqu’un et qu’on n’est plus libre de faire ce que l’on veut. Qu’on nous observe, qu’on nous guette. Qu’on nous surveille. Qu’on nous attend au coin des rues. Qu’on nous attend chez nous, dehors. Ce qui est entré s’appelle peut-être la peur. Ou l’angoisse. Ce qui est entré s’appelle la méfiance. Une présence minuscule. Sur nos chaussures ? Sur les poignées de portes ? Sur les boîtes de conserve ? Quelque chose envahit notre territoire terreur. Notre terrain, notre terrier. Terrifie nos mains. Se laver, porter un masque, s’éloigner. Et si cette vie, c’était la nôtre maintenant et pour longtemps ? Si l’on ne pouvait plus revenir en arrière ? Retrouver l’air libre, les rendez-vous, les embrassades. Retrouver les longues marches dans la nature. Et si aujourd’hui s’arrêtait de respirer pour toujours ? Une sorte d’éternité. Le temps coincé là. Ne pas sortir, ne pas toucher. Une chose rétrécie et qui suffoque. Une chose trop petite et qui nous serre sur les côtés. Et pour grandir, on fait comment ? Je veux dire pour grandir le corps. Parce que, dedans, ça pousse, ça repousse. Ça trouve des lucarnes et des ponts. Parce que, dedans, ça rencontre des jardins, des yeux d’enfants et les pattes des loups. Dedans est devenu grand. Je veux dire vraiment. Et l’aurore sauvage vient boire là. Et le vent vient boire. Et l’océan vient. La nuit, le jour. Vient la lumière qui naît d’elle-même. Vient le monde, le même que celui du dehors. Mais clair et transparent comme un chant. Un pays que rien ne serre sur les côtés. Et qui respire, et qui respire !

Confinement Covid-19 / 11 avril 2020
Jour 26
Synonyme de « habiter ». Demeurer, gîter, loger, résider, séjourner, vivre, occuper, nicher, percher, camper, crécher, fréquenter, hanter, peupler, visiter. Se tenir, régner, cabaner, se terrer, exister. Coucher, siéger, stagner, présider, installer, gésir. Habiter un appartement, château, hôtel, immeuble, logement, logis, manoir, palais, pavillon. Habiter une bâtisse, cabane, caverne, chambre, mansarde, masure, villa. Habiter le désert, faubourg, pays, quartier, village. Habiter la campagne, province, ville. Habiter les environs. Habiter à, au bas de, au bord de, au cœur de, au-dessous de, au-dessus de, chez, en, entre, parmi, près de, sur, sous. Habiter ici, là-bas, là-haut. Être dans. Occuper quelqu’un. Hanter, obséder, posséder. Être dans. J’habite. J’habite ici et dedans et ailleurs. J’habite des lignes, des cubes, des carrés. Des coins rectangulaires. J’habite des droites. Des définitions claires de l’espace. Des sols, des plafonds. J’habite des murs. J’habite des bords, des bordures. Des angles dans lesquels on ne voit pas ce qu’il y a après. J’habite des portes et des fenêtres. Des choses fermées, des choses ouvertes. Des étagères dans des placards. J’habite des limites roides. Des choses dures et certaines. Des compartiments, caissons étanches, caisses de rangement. J’habite des plinthes, des encadrements. Des segments et des parties. Des portions rectangulaires. Fragments d’autres choses d’autres choses. J’habite des arêtes fines, des traits et des rayures. J’habite des axes. Et puis j’habite aussi dedans. C’est quand je ferme les yeux. J’habite où des cœurs vivent. Où le silence habite aussi. J’habite des rondeurs chaudes et molles. Des choses circulent, comme des rivières rouges. Des choses cognent une chanson sans fin. Des filaments passent comme s’ils flottaient dans un liquide. Des lumières arrivent, repartent. Où vont-elles ? D’où viennent-elles ? Un son. Un murmure sous la peau. Oui, j’habite sous la peau du temps. Un endroit sans frontière, un endroit plein. Et puis j’habite aussi ailleurs. Où ça tangue. Où l’on court dans des champs de fleurs et c’est l’été. Où ça rit. Où ça se souvient. Où ça s’attrape et ça tombe dans l’herbe. Où ça s’allonge. Où ça écoute pousser ses cheveux. Où ça voyage avec les oiseaux. Chaque renard dépose sa rousseur. Ils viennent respirer à mon cou et ils s’en vont. Les arbres se penchent au balcon. Et je me penche aussi. Le monde est là petit, si petit, grand, si grand. Un champ de fleurs. Une chevelure. Un renard. Un oiseau. Un rire. Un arbre. Un été. Habiter.
Regarder la nuit s’enfoncer doucement, tout doucement dans le blanc. Oui, la nuit est blanche. Ne le savais-tu pas ? La nuit est blanche, elle écrit des chansons. Elle tombe aussi en nous, elle tombe de sommeil. Elle ouvre un chemin de feuilles et de lilas. Une glycine assemblée. Dans la nuit de nous vivent des abeilles et des chats. Des branches habitées. Le monde se réveille. On est entré dans un arbre. On a voyagé sur ses racines. Sève profonde comme un rêve. La nuit est blanche. En elle se dessine un autre nous. Une dentelle d’existence. Des choses petites tricotées avec les doigts. Des mots nouveaux mélangés de fleurs. Des diamants dans la bouche. Nous arrivons. Nous arrivons sur les berges du sommeil. Nous tombons, nous nous levons et levons notre corps de brume. Il est blanc, presque. Nous marchons sur des mers. Nous traversons des montagnes étonnantes étonnées. Nous sommes nous sans armure. Nous sommes sans attente. Nous nous levons la nuit et nous marchons. Nous avançons notre âme sur des plages de forêts. Fougères à peine nées et leurs corolles de lune. Nous entendons ce qui vit derrière les choses. Des jardins. Des portes d’or ouvertes. Des écureuils et des lapins. Nous portons notre visage. Nous portons la lumière des jours le jour. Nous naissons. Des bateaux nous attendent. Des horizons nous espèrent. Nous sommes au rendez-vous sans le savoir. Et nous n’avons plus peur. Nous défaisons nos bras. Nous libérons nos mains et nos duvets. Nos dents sont des étoiles qui rient au firmament. Nous décousons le jour. Les nœuds. Les noirceurs et les pleurs. La nuit est blanche. Et nous vivons dans la transparence de cette rencontre. Nous vivons.

Confinement Covid-19 : 10 avril 2020
Jour 25
Les choses abandonnables :
– le bougeoir en forme d’éléphant
– les mots qu’on nous a dits et qu’on n’a pas aimés
– les vêtements qu’on n’a pas portés depuis 2 ans
– les cadeaux qu’on nous a offerts et qu’on a pris pour faire plaisir
– le temps qu’on a perdu
– les boutons de portes qu’on garde pour le jour où on achèterait un meuble et qu’on n’aimerait pas ses boutons comme ça on est prêt
– les souffrances de solitude
– les cartes postales qu’on a reçues depuis, depuis…
– les regards qui se posaient sur les autres et qu’on aurait voulus pour soi
– les chaussettes à trous
– les cauchemars quand on veut crier et qu’on n’y arrive pas on se réveille
– les 5 vieux téléphones portables
– les tisanes qu’on ne boit pas
– le sentiment d’être seul au monde
– les soutiens-gorge trop grands parce qu’on a maigri
– les livres de Charlotte aux fraises
– les choses qu’on n’a pas dites à notre mère
– les guirlandes en papier qu’on nous offre tous les ans
– les vieux souvenirs tristes
– les prospectus des endroits où on est allé et on pense qu’on y retournera mais non
– ce qui nous a fait mal
– les photos de gens qu’on ne connaît plus
– les nuits sans sommeil
– les pyjamas tachés
– les colères et les rancunes
– les fleurs séchées ramassées en Bretagne l’été dernier tu sais celles qu’on appelle « les chatons » et qui prennent la poussière dans le salon
– les choses qu’on n’a pas dites à notre père
– les idées de nous qui sont fausses
– les gens qu’on n’arrive pas à laisser partir
– les envies de rester jeune, sans rides, sans cheveux blancs et sans cellulite
– la façon de regarder notre vie qui dirait qu’on a peut-être raté quelque chose
– les jours où on a trop bu
– les cicatrices
– le sentiment de culpabilité
– les mots qu’on a dits qu’on n’aurait pas dû dire
– les heures de désespoir où l’on pleure sans s’arrêter
– les choses qui ne sont plus nous
Quand nous avons enfermé l’eau de la rivière, elle n’a rien dit. Quand nous avons découpé la terre, elle n’a rien dit. Quand nous avons époumoné le ciel, il n’a rien dit. Ils se sont recroquevillés pour nous faire de la place. Ils ont respiré moins fort, ils ont grandi moins vite. Ils ont parlé tout bas, ils ont courbé le dos. Quand nous avons enfermé l’eau, quand nous avons découpé la terre, quand nous avons époumoné le ciel, ils ont souri de nos folies. Ils se sont dit que l’homme avait exilé son ombre, qu’il s’arrêterait bien tout seul, essoufflé de tant de précipitations. Ils se sont dit que ce temps prendrait fin naturellement, que l’homme grandirait et deviendrait adulte. Et puis, ça a continué comme ça, comme une grande ascension, comme une grande agonie. Et plus l’homme se sentait important et plus il devenait meurtrier. Oui, nous avons perdu notre ombre parce que nous avons perdu notre lumière. Nous nous sommes égarés dans des vitesses, des voitures, des urgences. Dans des réponses à tant d’appels. Acheter, téléphoner, chater, consommer, acheter, jeter, manger, s’habiller, acheter, mailer, voyager en avion, textoter, acheter, faire couler l’eau, whatsApper, allumer, acheter, charger, tweeter, acheter, faire des réserves, facebooker, acheter. Acheter. Acheter ce qui ne rentre pas dans notre maison, notre penderie, notre salon, notre cuisine, notre placard, notre ventre. Alors jeter. Jeter parce qu’on veut le dernier modèle, plus beau, avec plus de fonctions, plus à la mode, d’une autre couleur, assorti à nos rideaux. Jeter. Jeter et polluer. Quand le plus fait du moins. Parce que nous ne sommes pas satisfaits. Nous voulons le prochain robot ménager, le jeans avec cette coupe tu comprends, c’est ce qui se fait en ce moment. Nous voulons une voiture plus rouge, plus neuve, plus rapide. Nous voilons remplir ce vide en nous, cette béance magnifique. Cet espace si grand qu’il nous fait peur. Que nous préférons y jeter des vêtements, des voitures, des pots de peinture, de la nourriture. Le remplir jusqu’à ras bord, jusqu’à l’écœurement. Et le vide en nous grandit, et l’espace en nous grandit. Et c’est sans fin. Alors, peut-être, si nous écoutons, peut-être entendrons-nous l’eau, la terre, le ciel nous murmurer ce qu’ils savent depuis si longtemps. Peut-être saurons-nous regarder le vide en nous, l’aimer. S’y promener et devenir un être à notre taille. Peut-être saurons-nous devenir un être mesuré dans l’infini qui nous peuple ?
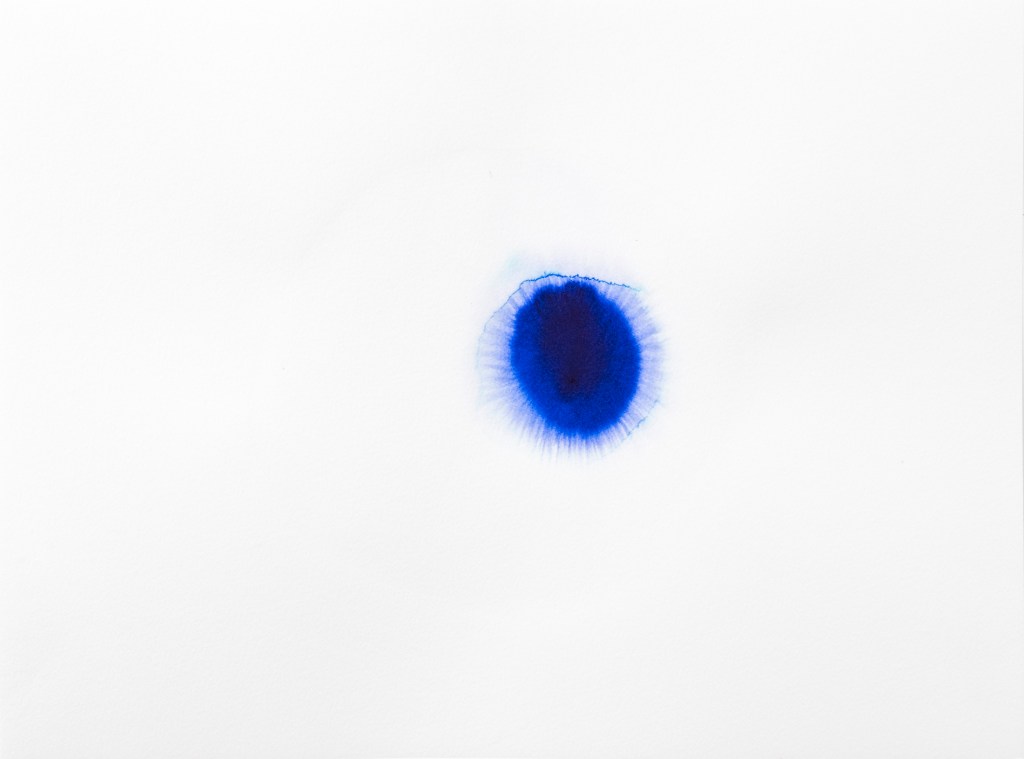
Confinement Covid-19 / 9 avril 2020
Jour 24
L’absence. L’absence, ce n’est pas quand il n’y a personne. L’absence, c’est quand ceux qui étaient là n’y sont plus. C’est le monde sans mains où mettre la nôtre. C’est le monde sans yeux où mettre les nôtres. C’est un creux, un espace inhabité, vidé de sa substance. C’est la disparition. Une porte qui ouvre sur un mur. On croyait. On a cru que. C’est quelque chose pas comme avant. Un manque, une soif, une faim d’un autre aimé. On ne sait rien attraper. On ne sait rien saisir car même les mots sont partis sans nous. Et quand ça a tourné le dos, ça a laissé tomber sa chaleur. Et quand ça a tourné le dos, ça a déposé l’ombre de l’autre, l’ombre de nous. Et nous l’avons ramassée. Nous avons fait semblant que ça pouvait se remplir à nouveau, se battre le cœur, s’ouvrir les yeux. Nous avons fait semblant, en soufflant sur l’ombre, de l’arpenter de sang. De coller une chair sur ses parois éteintes et d’oublier qu’elle n’avait plus de voix. Et l’ombre, l’ombre morte de l’absence, nous l’avons tenue dans nos bras, nous lui avons murmuré des mots interdits, nous avons ri sur elle pour partager la vie. Nous l’avons allongée dans notre lit. Nous avons tenu son front jusqu’au bout de la nuit. Nous avons tenu sa ride du coin de l’œil, celle que nous aimions tant. Nous avons parlé tellement fort que tout pouvait exister à nouveau. Que tout pouvait paraître. Pour qu’il n’y ait plus de murs derrière des portes, pour que plus personne ne tourne le dos. Pour que tout soit là, avec nous. Parce que sinon on a peur. Parce que sinon, il faudrait vivre en creux, épouser une attente, remplir des vases de fleurs et remplir à nouveau. Parce que sinon il faudrait boire la mer et ça ne suffirait pas. Nous berçons notre souffrance. Nous lui chantons des chansons du soir. Nous écartons ses mèches de cheveux pour pas qu’elle ait trop chaud. Nous sommes là dans la fièvre. Nous sommes là dans la glace. Nous dansons avec elle. Nous inventons un jardin magnifique. Nous inventons une terre, un ciel. Nous rions dans nos mains. Nous remplissons de poudre son épaule de laine. Et nous parlons bien fort, de crainte que le noir parti si loin ne nous absente.
Quand tu étais là, le monde était là. Et toi aussi, quand tu étais là. Et toi aussi. Tout de toi arrivait, se propageait. Tout de toi était nous. Il n’y avait alors pas de questions. Et nous allions par des chemins enfants, décrocher des choses qui brillent. Nous allions pavaner notre bouche aux rires les plus offrants. Il n’y avait pas de portes. Il n’y avait pas de fenêtres. Les églises chantaient tout le jour. Des tables se parfumaient et des myriades d’oiseaux y mangeaient avec nous. On cherchait l’ombre des bois sous le soleil ardent. On marchait comme des rois. Comme des cœurs de conquêtes. Quand tu étais là, et toi aussi, et toi aussi. On regardait la mer dans les yeux. Et chaque coquillage était une dent d’enfant qui n’avait pas grandi. Chaque grain de sable était un visage. Au loin habitaient des chevreuils. Un arbre un renard. Une pierre une mousse. La terre sentait le poisson et le chat. On marchait comme des rois. L’eau déroulait ses doigts au bord des maisons. Les abeilles annonçaient ce qui devait venir. Quand tu étais là, et toi aussi, et toi aussi. Des ponts chevauchaient d’autres ponts. Des troupeaux magnifiques, des courses sauvages. Le bruit de la gaieté que nous avions gardé. Chaque homme était enfant, chaque femme était enfant. La dentelle de nos jours embellissait le monde. Des poupées, des cachettes, des goûters sous les arbres. Nous chantions sans raison. Nous sautions, nous courions. Nos cheveux étaient libres et le vent y vivait. Nous croquions des pommes dans un temps infini. Nous laissions voyager sur les rivières nos bateaux de bois. Nos maisons faites de mousse et de branches. Nous roulions à nos bras des tresses de laine, de brindilles ou de fleurs. Là-bas n’existait pas. Nous habitions ici et ses coteaux sauvages. Des voix venaient parfois paresser nos sommeils. C’était l’heure des semailles ou des récoltes claires. L’heure des mûres et des pêches. L’heure des figues sous les doigts. Des cueillettes fragiles et des chuchotements. Il ne fallait pas réveiller le hibou. Quand tu étais là, et toi aussi, et toi aussi. Et maintenant ?
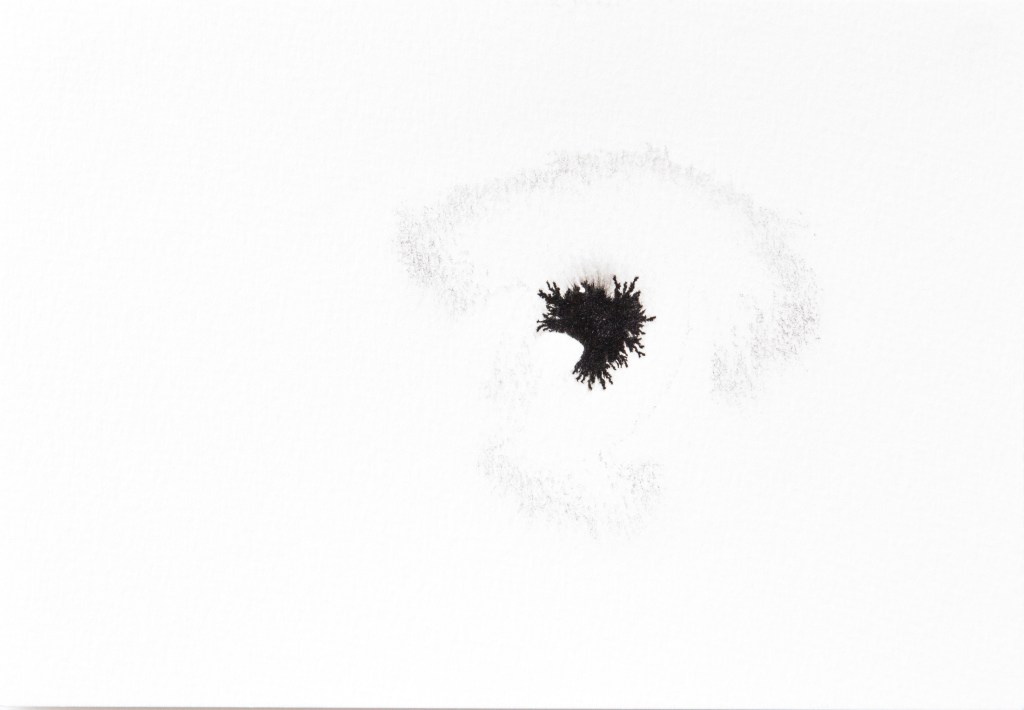
Confinement Covid-19 / 8 avril 2020
Jour 23
On nous a dit qu’il fallait rester chez nous. Que c’était notre nouvelle vie. On nous a dit qu’il fallait nous enfermer dans notre cuisine, notre chambre, notre couloir. Que le monde était criminel. Qu’il voulait entrer en nous et prendre toute la place. On nous a dit de nous méfier, de nous éloigner des choses et des êtres. Que le mal était dans l’eau que nous buvions, que le mal était dans l’air que nous respirions. Que le mal nous attendait sur les fruits des arbres. On nous a dit de nous enfermer pour laisser passer des vagues vagues à l’âme et le temps. Pour laisser s’éloigner un virus voyageur. Une toute petite chose molle, petite, toute petite. Qu’on peut même pas la voir. Et tous, on est rentrés chez nous pour regarder passer les vagues. Compter le temps. Peut-être cuisiner. Peut-être ouvrir la fenêtre. Et regarder le monde. Et regarder le monde, celui que nous avons emprisonné dans des boîtes, des bouteilles, des caisses. Le monde pour qui nous avons été criminels. Et lui faire du mal. Et mettre du mal dans l’eau, dans l’air. Sur les fruits des arbres. Vague à l’âme. Se laver des jours sombres. Se laver de nous, petite chose molle, petite, toute petite. Se laver. Se jeter dans des lacs. Des choses vieilles et nouvelles. Des boues attendues. Sédiments de la conscience. Ce qui tombe, tombereau. Les siècles nous regardent du fond de l’eau. Boucliers échoués. Barques d’hier d’hier. Celles que mes ancêtres n’ont pas connues, celles que les ancêtres de mes ancêtres. Avant avant nous écoute sous la vase. Volcans retournés à leurs cendres. Nous avons éparpillé la lune. Nous avons mangé notre soleil. Que reste-t-il de nous ? Que reste-t-il des heures frivoles ? Nos cœurs inondés endormis. Il faudra réveiller le ciel pour lui dire que nous grandissons. Que nous n’avons jamais été aussi grands. Il faudra qu’il nous croie.
J’entends une voix. Elle parle arabe. C’est une voix de femme. Une femme que je ne connais pas s’est penchée sur le monde. Une voisine. J’entends une voix. C’est la voix de mon enfance quand j’allais voyager chez Asma. Elle me parlait une langue inconnue. Une voix a ouvert la fenêtre du temps. Quand j’allais au bout de la ville pour vivre un peu. Je marchais, je marchais. Je savais que je trouverais des rires, des maladresses de français, des regards. Et puis, là-bas, de l’autre côté de la ville, habitait la tendresse. Je traversais des quartiers, je passais des ponts. Je traversais la pluie et le gris des banlieues. On m’attendait, je crois. À mercredi. Je marchais, je respirais. Et puis, là-bas, on était heureux de ma voir. On me touchait les cheveux, on me proposait de m’asseoir. On prenait mon manteau pour le faire sécher. Je regardais Asma faire sa lessive avec une machine en plastique. Une petite machine qu’il fallait tourner à la main. Puis elle brossait, frottait. Ça sentait le linge et le soleil aussi, dans ce pays de pluie. Ça sentait l’herbe. Les champs à perte de vue, et l’on peut rester là aussi longtemps que l’on veut, et l’on peut rester là toute une vie. À mercredi. Elle me parle en arabe, elle me touche les cheveux, et parfois elle glisse dans ma bouche un miracle de miel. Et l’on peut rester là toute une vie. Après la lessive, il y a le ménage et aussi le pain. Un pain énorme, fait dans une grande bassine en métal. Je regarde Asma pétrir la semoule. Elle me parle en arabe. Elle rit. Je sais qu’avant de partir elle me donnera une part du pain encore chaud dans une feuille d’aluminium. Maintenant ça sent l’huile d’olive. Elle me demande des mots en français. Elle me montre avec son doigt. Elle veut que je lui apprenne, un peu. Elle répète le mot. Elle rit. Ses mains sont rouges de henné. Elle sort du placard les gâteaux de pruneaux ou de dattes. J’ai perdu leur nom. J’ai 10 ans. Je m’installe dans ce pays tous les mercredis. De quoi tenir la semaine. Je prends des réserves de rires, de pain, de regards. Des réserves de mots qui chantent. Des réserves de parfums d’un autre monde. Le miel de ces heures claires. Et l’on peut rester là toute une vie. À mercredi. J’ai 13 ans. Maintenant il y a les enfants. Deux. Je les garde pour que Asma fasse quelques courses dans le quartier. Je repars avec mon pain encore chaud dans une feuille d’aluminium. J’ai 15 ans. Aujourd’hui, Jour 23, la fenêtre était ouverte. Une voix est venue me faire souvenance. Aujourd’hui habite quelquefois dans les creux du temps. Et l’on peut rester là toute une vie.
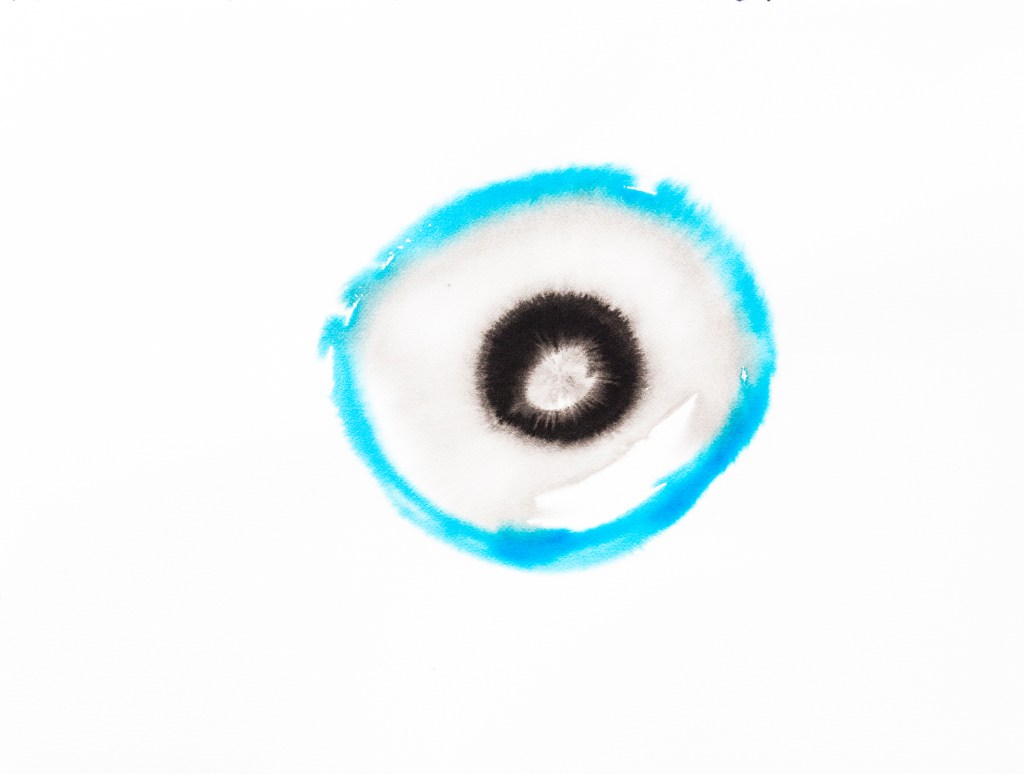
Confinement Covid-19 / 7 avril 2020
Jour 22
Pourquoi se lever ? Pour qui ? Qui dit qu’il faut, qu’on doit ? Pourquoi se lever ? Pour quoi faire ? Pour faire quoi ? Ils parlent de « vagues » du virus, de la contagion. Mais, la vague, nous la vivons tous les jours dans nos maisons. Nous trouvons en nous du sens et puis nous ne le trouvons plus. Un sens aux choses et puis aux êtres. Nous trouvons du sens et nous le perdons comme on perd ses clés. Peut-être est-il resté dans notre sac ? Peut-être dans notre poche. Peut-être sous le canapé. Nous ne comprenons plus ce que nous faisons là, dans cette pièce, dans cette maison, dans cette rue, dans cette ville, dans ce pays, dans ce monde, sur cette planète. Ce que nous faisons là, nous, dans cette vie. Nous cherchons ce qui fait nous. Dans la cuisine ? Sous le lit ou bien derrière le bureau. Et nous faisons le tour de notre maison, notre maison devenue si grande que nous nous perdons. Qui ressemble maintenant à un manoir, un château, un palais. Et tout est si long, si vaste, tout est si possible. Nous trouvons et puis nous ne trouvons plus. Nous perdons. Nous égarons nous. Nous nous égarons. Nous savons. Nous ne savons plus. La vague arrive et nous submerge. Nous n’arrivons plus à respirer et puis nous avons peur et puis nous avons froid. Et si plus rien ne se trouvait de qui nous sommes ? La vague arrive, arrive. Et la vague est vivante, sauvage, éclatante. Et la vague s’éteint. Tout a repris sa place. Tout repose au fond et l’eau est claire, limpide, scintillante, on voit ses pieds. Tout est calme. Tout va bien.
Se réveiller la nuit avec des mots plein la bouche. Ce sont des rêves tombés dans l’oubli. Des milliers de rêves qu’on a traversés, dans lesquels on a vécu. Ce sont les rêves dont on ne se souvient pas. Et puis nous marchons dans la rue et un éclat nocturne revient. Parce qu’un mot, parce qu’une image. Et nous attrapons ces petits bouts glissés derrière le temps. Ces histoires qui disent qui nous sommes et que nous ignorons souvent. Il y a les maisons sans clés, les parents qu’on a perdus. Il y a les courses dans des rues éclairées, les conversations familiales. Il y a des paysages et parfois des animaux. Le monde nous rencontre et c’est nous. Et puis nous sautons d’un immeuble parce qu’on est poursuivi. Et puis on a peur. Et puis on veut crier mais on n’y arrive pas. Et puis on se marie. Et puis on conduit une voiture dans le noir et l’on ne trouve pas comment allumer les phares, et puis on monte un escalier sans fin, et puis on reçoit un bouquet de fleurs, et puis on ne sait pas où on a laissé nos enfants, et puis on mange une glace et il y du soleil. On se réveille au milieu d’un rêve dont il manque un morceau. On ne sait pas toujours ramener ces trésors dans nos vies agitées. On vit deux fois, la nuit, le jour. Et c’est comme une séparation, une limite que nous ne franchissons pas. Prendre à la nuit ses jardins dévoilés. Fragments entrevus d’un pays plus grand. Courir encore dans des champs de fleurs, fredonner des chansons sur une balançoire, sentir l’odeur des grottes et des terriers. Sous la terre ou derrière nos yeux, et c’est pareil. Habiter toutes les heures qui se tiennent la main. L’ombre et la lumière comme un seul corps de brume. Et puis corps de falaise et puis corps de chair. Rassembler notre temps souterrain. Marcher sur ses chemins et dérouler ses plaines. Vivre là. Vivre là complètement. Et promener dans le monde nos rêves oubliés.

Confinement Covid-19 / 6 avril 2020
Jour 21
Je n’ai pas de nouvelles de mes frères des rues, mes sœurs. De ceux qui dorment dehors. De ceux qui mangent dehors. Oui, dehors, ils le mangent. Ou sont-ils mangés pas lui ? Je n’ai pas de nouvelles de mes frères des rues, mes sœurs. De ceux qui attendent le jour. De ceux qui attendent des mains, des yeux. De ceux qui redoutent les nuits et leur froideur. De ceux qui sommeillent sans dormir. Où sont-ils ? Habitent-ils des déserts de villes ? Des rues abandonnées par les chiens. Attrapent-ils des virus dans l’aveuglement du monde ? Sont-ils contagieux, infectés, malades, morts ? Qu’attendent-ils de ceux qui ne sortent plus ? Attendent-ils ? Des mains, des yeux, le jour. Que font-ils de leur solitude impeuplée ? Plus de voitures, plus de passants, plus de vélos, plus de pieds, plus de bus, plus de magasins, plus de voix, plus d’argent, plus de nourriture. Alors, seuls, dans les rues seules, ils boivent un soleil sans partage. Tout le monde est rentré à la maison. La maison ? Tout le monde porte un masque. Un masque ? Tout le monde se protège. Tout le monde vit dedans. Dedans ? Car le dehors pourrait nous prendre le corps, la voix et l’âme. Car le dehors éructe et tentacule. Car le dehors pourrait rentrer en vous sans que vous le sachiez. Pourrait vivre dans votre gorge, vos veines et vos poumons. Vous assoiffer, vous affamer, vous étouffer, vous éteindre. Vous amoindrir, vous écraser, vous mordre, vous tuer. Vous épuiser, vous dévorer, vous étrangler, vous mourir. Je n’ai pas de nouvelles de mes frères des rues, mes sœurs. De ceux qui dorment dehors. De ceux qui mangent dehors. Oui, dehors, ils le mangent. Ou sont-ils mangés pas lui ?
Comment savoir ce qui rapproche. Comment savoir ce qui éloigne. Ce qui est entre, qui fait tout exister. Sur une photo, un homme, une femme. Sur une photo, ils se font face. Ils sont debout. Est-ce pour se rejoindre ? Est-ce pour se quitter ? Je ne sais pas la suite de l’histoire. Une photo trouvée dans un carton au fond d’une cave qu’il fallait vider. Je regarde l’espace entre. De l’herbe un peu. Un bout de montagne au loin. Une photo tombée, glissée dans une faille du temps, et qu’on avait gardée. On ne sait pas pourquoi. Nous parle-t-elle de nous ? Chacun fait face à sa montagne. Chacun son herbe, son soleil. Et ce qu’il y a entre. Entre les choses. Entre les êtres. Les silences. Les pays. Les pas qu’on n’a pas faits. Les mots qu’on n’a pas dits. Les gestes qu’on a arrêtés. Le temps qu’on n’a pas pris. Où vit tout ce qui n’a pas pu naître ? Dans cet espace au cœur d’une montagne. Au creux d’une herbe. Après un soleil. Un quelque part invisible. Un quelque part comme une pliure. Un coin écorné dans le livre de notre vie. Derrière derrière, encore après. Et toutes les naissances en attente, oubliées sous la table du jour. Toutes les naissances en attente, elles vivent la nuit. Elles reviennent sur une photo, dans un rêve agité de soleil. Toutes nos choses auxquelles on n’a pas donné sa chance. Ce qu’on n’a pas choisi, ce qu’on n’a pas fait, ce qu’on n’a pas dit, ce qu’on n’a pas vécu, ce qu’on n’a pas été. Et tout existe de nous qui n’a pas encore germé. Tout existe. Ailleurs. C’est quand on se souvient. C’est quand on arrête sa main qui dessine un mot. C’est quand on pense qu’on est déjà passé par là. C’est quand un parfum nous rend vivant. Cet endroit, il est là tous les jours. Il nous habite. Et si nous sommes attentifs, poètes ou tendres, nous pouvons y entrer tout doucement, sur la pointe des pieds pour pas faire trop de bruit. Nous pouvons venir boire à ses joues de printemps qui nous ressemblent tant. Nous pouvons, l’espace d’un instant, regarder passer nos naissances en attente. Sourire au fond d’une cave. Tenir fort une photo. Mettre ses yeux dans une herbe, une montagne, un soleil. Prendre soin de son silence.

Confinement Covid-19 / 5 avril 2020
Jour 20
Jour 20. Jour 20. Jour 20. C’est dimanche. Les oiseaux chantent dans la fenêtre ouverte. Les arbres tanguent. Étourdis de vent, de printemps, de soleils. Tout rentre dans la maison, envahit la chambre d’écriture. Le vert, le bleu et le bruit derrière le bruit derrière le bruit. Tout là-bas roulent encore quelques voitures, quelques camions. C’est l’autoroute après la brise. Celle qu’on n’aime pas entendre d’habitude. Celle qui nous parle aujourd’hui de ceux. Ceux qui transportent notre farine, nos tomates et notre lait. Ceux qui nous amènent à manger. De petites mamans sur les autoroutes désertées. Dans des gros camions, assez gros pour tout le monde. Ces camions, ceux qu’on n’aime pas doubler d’habitude. Trop gros, trop bruyants, trop font peur. Alors, l’autoroute arrive aussi dans notre chambre d’écriture. Un ballet de camions, comme des jouets bleus, rouges. Pour nous parler de la danse des hommes. De ceux qui aiment pour ceux qui ne savent pas. De ceux qui continuent pour ceux qui ne peuvent plus. De ceux qui donnent pour ceux qui reçoivent. De ceux qui chantent pour ceux qui se taisent. De ceux qui soignent pour ceux qui souffrent. De ceux qui rient pour ceux qui pleurent. De ceux qui marchent pour ceux qui dorment. De ceux qui travaillent pour ceux qui ne travaillent pas. De ceux qui nettoient pour ceux qui salissent. De ceux qui éduquent pour ceux qui apprennent. De ceux qui partagent pour ceux qui gardent. De ceux qui aiment pour ceux qui ne savent pas. De ceux qui espèrent pour ceux qui désespèrent. De ceux qui réparent pour ceux qui cassent. De ceux qui parlent pour ceux qui écoutent. De ceux qui dansent pour ceux qui regardent. De ceux qui nourrissent pour ceux qui mangent. De ceux qui émeuvent pour ceux qui froident. De ceux qui respectent pour ceux qui franchissent. De ceux qui rêvent pour ceux qui cauchemardent. De ceux qui aiment pour ceux qui ne savent pas. De ceux qui cherchent pour ceux qui attendent. De ceux qui offrent pour ceux qui accueillent. De ceux qui poétisent pour ceux qui matérialisent. De ceux qui vendent pour ceux qui achètent. De ceux qui tendressent pour ceux qui agressent. De ceux qui aiment pour ceux qui ne savent pas. De ceux qui vivent pour ceux qui meurent.
Quand on tombe malade, d’abord on tombe. On ne sait pas jusqu’où, jusqu’où ça ira. On tombe tout droit. Peut-être dans des pommes, des poires, des fruits d’été. On tombe avec un goût dans la bouche. Le souvenir des autres fois où la maladie nous avait attrapé. Peut-être dans un puits. On quitte la lumière. On va vers le sombre de nous. Chute sans fin. On arrive dans le noir. On tombe encore. Le corps ne sait plus se mettre debout. Le cœur ne sait plus. Tout fatigue. Manger. Respirer. On dort, on tombe. On n’est pas encore arrivé. Le voyage commence seulement. On rêve. On se souvient. On ne se souvient plus. On part sans notre corps. On reviendra plus tard, quand on sera allé vivre de l’autre côté, de l’autre côté de la souffrance. Quelqu’un nous appuie sur la tête. Serre les tempes. Un étau. Quelqu’un s’assoit sur nos poumons. L’air est sans nous. On voudrait parler mais non. Les mots aussi sont partis. On est seul sous des corps lourds, si lourds. On voudrait. On ne sait plus ce qu’on sait. Quelqu’un est entré en nous. Nage dans notre sang. Mord dans nos os. Quelqu’un est entré. Griffe nos yeux. Notre corps habité. Passager clandestin. Dormir. La tête un étau. Debout non. On a soif. Quelqu’un s’allonge dans notre bouche. Dort là toutes les nuits, les nuits, les nuits. Et les nuits aussi sont entrées. Et l’humide des forêts. On tombe encore et les nuits. Elles ont déroulé leur noirceur, leurs rivières de cendres. Et les nuits. Elles ont déposé leur manteau de pluie. Elles l’ont bien étalé pour qu’il dure plus longtemps. Elles ont déposé le souffle rance des volcans. Sèves putrides. Ce qui gît au fond des lacs qui n’est jamais remonté à la surface. Ce qui attend depuis des siècles, qui sent la mort et la mort. Ce qui prend tout son temps. Champignon-fossile qui est là, qui est là. Les nuits. Elles ont installé l’ombre de l’ombre de l’ombre de nous. Car ces nuits nous appartiennent. Celles que nous ne voulons pas voir. Sur lesquelles nous plantons nos fourrures d’incertitudes. Ce que nous maquillons en mettant de la couleur à nos voitures, sur nos pots de confiture, dans nos maisons. Les nuits qui viennent, ce sont les nôtres. Les nuits qui viennent, ce sont les nôtres, jetées au fond du puits. Sur lesquelles nous avons répandu nos poubelles, nos aveuglements, nos obscurités. Et maintenant, nos nuits, elles reviennent hanter nos jours. Quand on tombe malade, d’abord on tombe. On ne sait pas jusqu’où, jusqu’où ça ira.

Confinement Covid-19 / 4 avril 2020
Jour 19
Et si on repartait en courant ? J’ai peur. Si, quand tout était fini, quand tout pourrait commencer, on repartait en courant ? Si on courait à nouveau après le bus, le temps, le travail ? Si on courait entre deux rendez-vous, deux hommes, deux appartements. Deux repas et deux heures. Si, après notre enfermement, on faisait comme avant ? J’ai peur. Si ça n’avait servi à rien ? Et si on dépiautait le temps, si on le coupait en morceaux pour l’avaler vite vite, pour qu’il nous avale vite vite. Et qu’après, y’en n’ait plus. Qu’après, on n’ait plus le temps. Le temps de rien, le temps de tout. Le temps des autres. Le temps de soi. Si la vie se vivait à toute vitesse, à toute bringue, à toute berzingue. Brinquebalante réalité faite de sacs. Le sac à mains, le sac pour le sport, le sac pour l’ordinateur, le sac pour le repas, le cartable, le sac pour la bouteille d’eau et les lunettes de soleil, le sac pour le travail, le sac préparé la veille, le sac pour le parapluie, le sac pour les dossiers. Le sac pour le sac dans le sac. Et si nous retournions à notre vie en sachet, notre vie jetable, même pas recyclable. Notre vie pliée en quatre comme on coupe les cheveux. Euh, non, pliée en dix-huit. Notre vie décuplée, démultipliée pour répondre aux appels téléphoniques, aux mails, aux sms, aux messages WhatsApp, à Facebook et peut-être aux demandes des enfants. Répondre à tous ces appels surpeuplés, aux précipitations, aux exigences, aux priorités, aux mots de notre liste, à nos bips mobiles, à notre agenda, aux urgences, aux urgences d’urgences. Aux vraiment très urgences. J’ai peur. J’ai peur de ce qui va bientôt approcher sa bouche d’ombre quand je pourrai sortir. Ce qui va précipiter mon cœur de chair, mon souffle. Ce qui dira « tu viens ? » 400 fois par jour. Ce qui viendra sonner, frapper, biper, alarmer, répéter, vibrer, signaler, rappeler, klaxonner, hurler, relancer. À qui il faudra dire « Non, je ne viens pas ». À qui il faudra expliquer qu’on a passé 48 jours en confinement, qu’on a changé. Qu’on ne veut plus de la vie d’avant. Que maintenant, c’est lent, intérieur, spirituel. Que c’est notre nouvelle vie. Une vie bio, équitable, authentique. Une vie qui prend son temps. Qui le prend en entier. Une vie qui va à pieds, qui fabrique elle-même ses produits avec ses petites mains. Une vie au rythme des saisons. Qui fait du plus avec du moins. Une vie sereine qui chante au fond des bois. Une vie qui danse.
C’est comme si les parents étaient partis en vacances et nous avaient laissé la maison. Tu sais, quand on dit « oui, on sera raisonnable. On se lèvera à 8h, on fera notre travail scolaire ». Tu sais, quand on dit « vous pouvez partir tranquilles. On arrosera les plantes, on se couchera tôt, on fera la vaisselle ». « Oui, oui, t’inquiète pas, on sera sérieux. Oui, oui, on va en profiter pour lire, ranger la maison, trier nos vêtements. Oui, oui, quand vous reviendrez, on sera au top de nos révisions. On aura fait du sport, on aura mangé équilibré, on se sera lavé tous les jours. Oui, oui, t’inquiète pas. On ne se vautrera pas sur le canapé pour regarder 3 films avec un paquet de chips. On ne passera pas nos nuits sur les jeux vidéos. On ne passera pas nos jours sur Facebook. On fera attention à l’utilisation des écrans ». Tu sais ? Et quand ils ont fermé la porte. On a attendu un peu avant de crier de joie. On a bien vérifié qu’il y avait des chips. On a sélectionné les 3 films qu’on allait regarder. On a oublié les plantes. On a perdu la vaisselle. On a cassé l’heure du coucher et aussi celle du réveil. On n’a pas trouvé de livres. On s’est dit qu’on réviserait demain ou demain ou demain. On n’a pas su où était rangé le balai. On n’a pas trié nos vêtements, on n’a pas pensé à faire du sport. Et on est resté un mois avec des chips. Et puis deux jours avant l’arrivée des parents, on a tout fait très vite. Tu sais ? Quand on n’a plus personne pour nous dire ce qu’il faut faire de nos heures et comment bricoler nos vies. Quand plus rien ne nous fabrique. Quand il n’y a plus de voix dans la cuisine. Quand il n’y a plus d’occupation de la salle de bains. Quand personne ne prépare le repas. Quand il n’y a plus de présence. Quand il n’y a plus de regard. Alors, dans ce quand-là, on ne sait plus, on ne sait plus qui être. Pourquoi se lever, se laver, se rencontrer ? Pourquoi s’instruire et prendre sa place ? Qu’y-a-t-il au creux du désert ? Qu’y-a-t-il au fond des puits asséchés ? À quoi peuvent bien servir les ruines des maisons ? À abriter les oiseaux ? À quoi peuvent bien servir les blancheurs de couloirs ? À peindre des transparences de cœur ? Qui être quand il n’y a plus personne pour ce que nous sommes, ce que nous sommes ?

Confinement Covid-19 / 3 avril 2020
Jour 18
Dans ma tête, il y a des gens. Ceux qui parlent sans arrêt et qui remplissent les heures. Ceux qui mangent trop. Ceux qui marchent vite. Dans ma tête, il y a des gens. Des assoiffés, des précipités, des frénétiques, des stressés, des inquiets, des empressés, des emmagasineurs, des impatients, des rapides, des insatisfaits, des affamés, des angoissés, des effrayés, des tourmentés, des insatiables, des agités, des fiévreux, des torturés. Dans ma tête, il y a des gens. Une foule de gens. Il y a aussi ceux qui silencent. Ceux qui s’arrêtent. Ceux qui flottent. Ceux qui paressent. Des gens. Des tranquilles, des intériorisés, des souriants, des lents, des calmes, des gais, des endormis, des éveillés, des détendus, des juste-ce-qu’il-faut, des lumineux, des patients, des doux, des confiants, des positifs, des ensoleillés, des rieurs, des authentiques, des éblouis. Dans ma tête, il y a des gens, une foule de gens. Ils se tiennent la main dans la main du temps. Ma foule se croise, se marche à l’intérieur. Elle sait. Elle ne sait plus. Elle bascule et elle glisse. Et puis, parfois, sur la pointe des pieds. Elle entrevoit un ciel passager clandestin. Un souvenir des jours. Elle entrevoit ce qu’elle quitte. Elle sait. Elle ne sait plus. Ma foule se croise au large, comme on dit d’un bateau. Elle a sorti la voile. Elle croit qu’il va faire beau. Elle prépare son sommeil. Elle prépare sa bouche. Ma foule prépare ses yeux pour le grand spectacle du monde. La sortie qu’on attend. Le voyage qui vient. Ma foule se croise, se marche à l’intérieur. Elle sait. Elle ne sait plus. Il y aura du vent et du soleil un peu. Et puis tous les oiseaux qu’on croyait enfermés. Il y aura des terres, des mers. Il y aura du temps. Ça sera un nouveau monde, monde nouveau. Le même mais pas pareil. Ça sera ma nouvelle foule, foule nouvelle. La même mais pas pareil. Elle sait.
On est puni. On a dû faire une bêtise. Une gosse bêtise. Une grosse grosse bêtise. On l’a bien vu dans les yeux de papa. On l’a bien vu dans les cris de maman. On sait pas trop quoi. On a baissé la tête. On a baissé les bras. On a fait du rond avec notre dos. On nous a dit : « Va dans ta chambre ! Tu reviendras quand tu auras réfléchi à ce que tu as fait ! ». On est allé dans notre chambre. On ne savait pas combien de temps ça durerait. Ce que voulait dire « réfléchir ». On ne savait pas que c’était si difficile d’être loin. D’être seul. D’être séparé par une porte. Une chose rectangulaire en bois, je crois. Qu’il suffit pourtant de tourner une poignée pour que les pleurs s’arrêtent. Une toute petite chose entre. Une chose qui définit deux mondes. Une frontière. Réfléchir. Qu’est-ce qu’on a fait, de l’autre côté, qui ne peut pas se réparer ? Est-ce qu’on a cassé, fait couler, abîmé ? Est-ce qu’on a sali, déformé, tordu ? Est-ce qu’on a déplacé, fendu, tué ? Est-ce qu’on a fissuré, désossé, brûlé ? Est-ce qu’on a éviscéré, découpé, décoloré ? Est-ce qu’on a décapité, arraché, décousu ? Est-ce qu’on a déchiqueté, broyé, ébouillanté ? Est-ce qu’on a renversé, pollué, mélangé ? Est-ce qu’on a froissé, souillé, énucléé ? Est-ce qu’on a épluché, égorgé, décimé ? Est-ce qu’on a haché, décomposé, déshérité ? Est-ce qu’on a asséché, dérouté, estropié ? Est-ce qu’on a ruiné, démembré, plié ? Est-ce qu’on a dénaturé, amputé, aseptisé ? Est-ce qu’on a étranglé, infecté, écrabouillé ? Est-ce qu’on a étripé, élimé, raboté ? Est-ce qu’on a crevé, débité, fragmenté ? Est-ce qu’on a ouvert, dépecé, assoiffé ? Est-ce qu’on a écartelé, effeuillé, déchiré ? Est-ce qu’on a piétiné, scalpé, oblitéré ? Est qu’on a élimé, percé, écrasé ? Est-ce qu’on a empoisonné, profané, contaminé ? Réfléchir. Est-ce qu’on a fait une seule chose ? Est-ce qu’on a fait toutes ces choses ? On colle notre oreille contre la porte. On écoute ce qui reste du monde, du monde où l’on ne vit plus. On écoute ses chants d’oiseaux et la voix des vivants. On colle notre oreille contre la porte. On reste assis longtemps. On sourit. Quelque chose nous attend. Et quand ça sera le jour, et quand ça sera l’heure, on sera prêt.
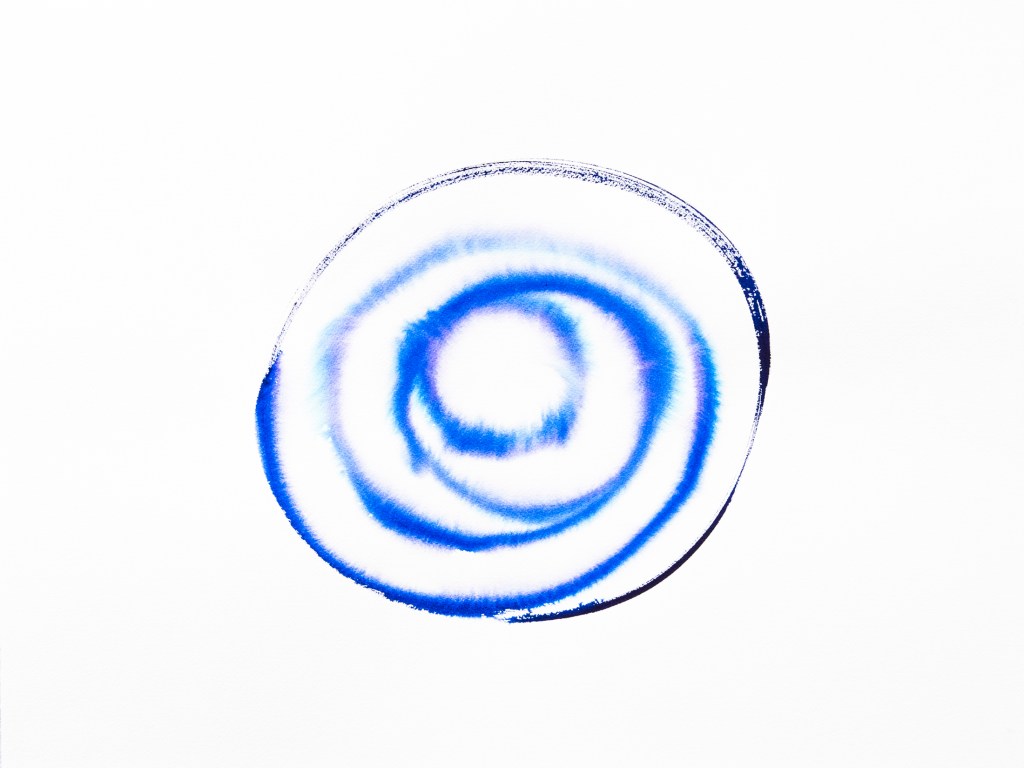
Confinement Covid-19 / 2 avril 2020
Jour 17
Un peu de ciel autour de mon clocher. Et le bleu s’invite. Un petit bout par la fenêtre. Je suis sur la Terre. Un angle mort, un bout de rue, une lucarne avant la nuit. Des choses qui passent dans mon carré. Des formes noires et des filets de précipices. Des fleurs qui voudraient bien pousser. Et puis des milliers d’arbres qui courent dans la colline. Et puis des résistances de sable. Carré. Dehors s’abonde et se délite. Dehors s’apitoie. Se racle, s’écorche aux genoux. Un coin tout petit pour du bleu encore un peu. Un coin de jour avant demain. Chose à tenir entre deux doigts. À pas trop serrer. À soutenir à pleines mains. Jour 16, il reste si peu de toi. Et nous basculons dans ce qui s’allume pour repousser les ténèbres. Nous nous habillons de laine pour approcher ce qui est derrière la page. Car nous avons froid, tout à coup, car nous avons peur, car nous avons faim. Oui, nous sommes affamés de soleil, de lune bleue et de printemps. Nous sommes affamés de routes, d’horizons, de dentelles. Les pattes d’un piano. Le silence entre les notes. Parler. Se taire. Écouter ce qui respire dans le cœur des hommes. Écouter ce qui tangue au creux des maisons. Tout est tombé avec la nuit. Notre carré n’a plus d’épaisseur. Il s’est fermé pour jamais, toujours, une autre fois. Coquelicot des sentiers en attente de l’aube.
Quelqu’un téléphone. Une voix, un rire. Le surgissement d’une femme disparue. Tout est simple. Le monde arrive dans ma maison. Il allume une chandelle qui allume une chandelle qui allume une chandelle. Une musique de piano me parle de pays intérieurs. La voix arrive sans prévenir, sans rendez-vous dans un jour sans heures. La voix, elle dit qu’elle ne pouvait pas appeler avant. Qu’elle s’était perdue. Qu’elle s’était oubliée dans ce qui s’arrêtait. La voix, elle dit qu’elle avait cassé sa corde, sa ficelle dans la gorge. Qu’on appelle ça une extinction. Qu’il n’y a rien à faire pour cela. Sinon, peut-être, boire du silence avec du citron et du miel. Sinon, peut-être ranger ses mots dans une boîte dans un placard derrière une porte. Ranger ses mots et les garder pour une autre fois. La voix, elle dit qu’on appelle ça une extinction. Oui, quand ça s’éteint et qu’on ne sait pas quand ça va se rallumer. Combien de temps ça va durer. Alors on boit son silence, son citron et son miel. Alors on prépare d’autres boîtes pour tous nos autres mots. Des boîtes à chaussures, c’est très bien. Et l’on se surprend à coucher ses mots sur des papiers de soie, des papiers découpés, des tissus soyeux. On allonge ses mots sur des douceurs diaphanes pour qu’ils aient moins peur dans le noir. Pour qu’ils soient beaux dans l’attente, dans l’attente du jour où l’on viendra les chercher. Et ce jour-là, on ouvrira notre porte, notre placard, notre boîte, et on laissera sortir tous nos mots. Et l’on pourra parler.
Je cours sur le sable d’une plage. Là-bas, très loin, le ciel gris. Je cours avec des enfants. Nous portons nos seaux, bien sûr. Et nos haveneaux. Nous courons, en maillot de bain, sur cette immense plage. La mer est loin. Les hommes sont loin. Et l’orage approche sa bouche d’ombre. Il grogne, il mufle son vent. Nous courons pour pas qu’il nous attrape. Nous rions. Il nous jette ses gouttes. Nous rions. Nous avançons vers. C’est loin. Tout est grand. Il fait froid et le gris remplit tout. Le ciel est devenu un orage noir et menaçant. Les griffes de la pluie. Les crocs du tonnerre. Courons pour pas qu’il nous attrape. Je tiens la main d’un enfant qui tombe. Et nous tombons. Nous nous relevons. Et nous tombons. J’entraîne ce petit corps vers un monde chaud. L’autre enfant nous devance. Nous crions de joie, de peur, de surprise. Cours ! Cours ! Il arrive ! J’emporte mon cœur haut farouche. Je cours comme le vent. Je crie. Je ris. Je tiens ma serviette cape dérisoire. Rempart qui me protège ou me cache ou m’envole. C’est loin. Les griffes de la pluie. C’est noir. C’est froid. Courons, rions, pour pas qu’il nous attrape. Tombons, nous relevons. Traversons le ciel et ce qu’il prépare pour nous. Qu’importe le loin, le froid, le noir. Tenons la main à ce qui grandit. Traversons. Tombons. Relevons le front vers ce qui vient. Une éclaircie, une plage lavée de pluie, ce qu’il y a derrière les choses. Après, plus haut, demain. Demain nous attend.
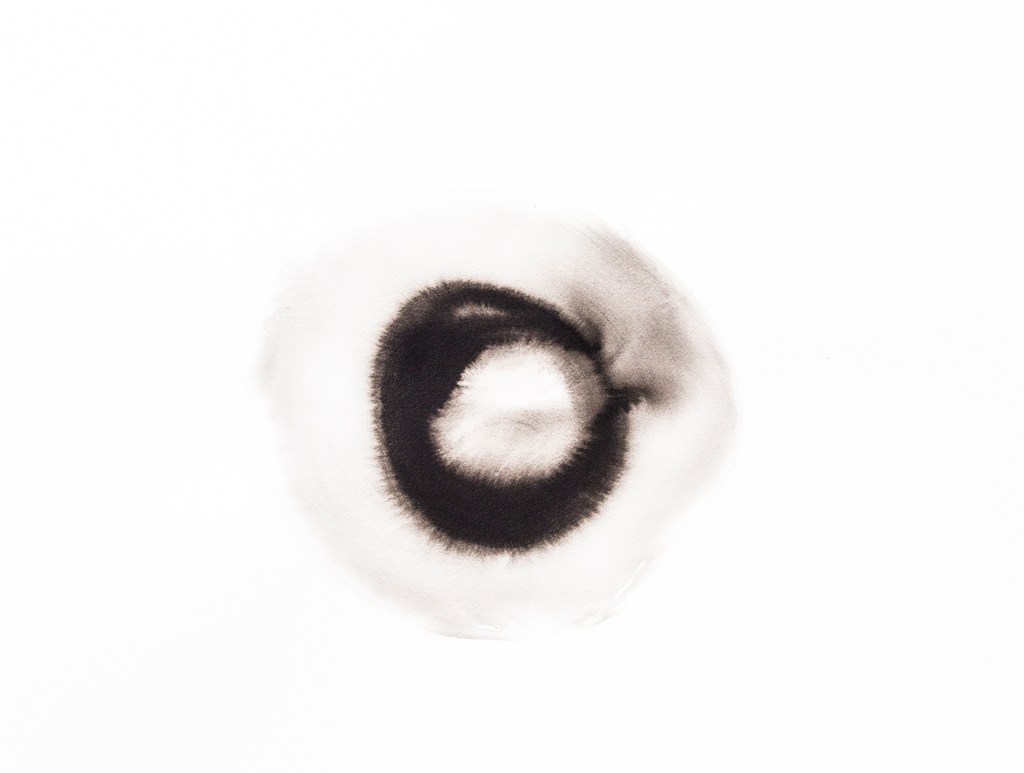
Confinement Covid-19 / 1er avril 2020
Jour 16
Dans FaceBook, il y a visage et livre. Il y a des choses surgies de nulle part. Des inconnus. Des paroles lancées dans l’univers. Il y a ce qu’on craint et ce qu’on découvre. Des endroits où dire qui l’on est. Des partages. Des liens et des fils qui tiennent les gens. On est enfermés chez nous et puis on découvre ce qui court au bout de la planète. Ce qui vibre et scintille. Un infini d’amis qui ne sont pas des amis. Et pourquoi pas ? Pourquoi ne pas rire de cette liberté folle, de ces rencontres incongrues qui ne sont pas des rencontres. Ces fulgurances. Cette humanité. Ces vies enfin dévoilées. Des photos de soi quand on était enfant, notre recette préférée, notre dernier tableau. Un lieu où vivre, où poser des choses, où penser être entendu, où s’arrêter, où rompre la solitude. Un lieu où vivre la nuit, où recevoir des cœurs, où développer son entreprise, où oser faire une vidéo. Dans FaceBook, il y a visage et livre. On nous invite. Alors, peut-être, en ces temps de confinement, aller se promener dans ces visages, ses gens qui nous ressemblent et puis non. Ces murs de visages, ces sourires. Des bouteilles à la mer. Et ne rien prendre pour ce que ça n’est pas. Savoir que ce n’est pas le monde, le vrai, que ça ne peut le remplacer. Et pourquoi pas ? Ce qui ressemble, ce qui rassemble, ce qui, ensemble, unit, soutient et aide dans ces temps farfelus. Il y a visage, il y a livre. Et nous lisons sur les visages ce que nous sommes d’humain, de simple, d’apeuré. Ce que nous sommes profondément : des êtres en quête de chaleur.
Se maquiller sur Vivaldi. Aller faire des courses. Gestes désuets que nous gardons. Se parfumer pour vivre dans sa voiture, puis vivre dans un magasin. Et rentrer très vite. Bijoux. Mouvements. Se regarder dans le miroir. Et puis prendre son temps pour choisir les petits pois. Contemplation des légumes. Contemplation des fruits. C’est Beaaauuu ! Un arrêt au rayon poissonnerie pour regarder tout ce qu’on n’achètera pas. Un ballet de gens dans des couloirs. Un dos arrondi. Une épaule. Le parfum d’une femme. Un sac à mains suspendu. La liste des courses indique « boudoirs ». C’est pour la charlotte aux fruits rouges. On ne sait pas où sont les boudoirs. On ne vient jamais dans cette grande surface. C’est tellement grand, c’est sûr, on va trouver tout ce qui est écrit sur notre liste ! C’est grand ! C’est beau ! Et puis il y a des gens qu’on peut regarder passer. C’est grand. On marche enfin. On marche ! On pousse un caddie, on fait du sport. Vivre ici quelques heures avec des inconnus. Savourer ce moment, cette récréation. On cherche les boudoirs. On fait deux fois le tour du magasin. On se tient debout dans le rayon surgelés. On se tient longtemps. On cherche… on ne sait plus. Ceux qui travaillent passent avec des gants. On ralentit. On consulte notre liste. Ah ! Les boudoirs ! On écoute la musique. On découvre des choses incroyables. On ne savait pas que ça existait. C’est plus grand quand il y a peu de monde. On fait du sport. On attrape les œufs. On lit. On ralentit. On se regarde. On a le temps. On aime cette chose lente qui nourrit. On se perd. On se retrouve. On prend des yaourts qu’on n’a jamais goûtés. On croise plusieurs fois la même personne. On oublie l’heure. On marche. On respire. Soldes. Musique. Ah ! Les boudoirs !
Des choses me quittent. Des choses vieilles, tristes. Des choses aimées autrefois dans une autre vie. J’ai envie de pleurer. Là, tout de suite. J’ai envie d’aimer encore ce qui part. De tenir la main aux disparus. Les gens absents, les relations lointaines. Les mots oubliés, dits si longtemps, et les mots qu’on n’a jamais dits. J’ai envie de pleurer sur l’hiver qui s’en va. Sur la brume qu’on laissait exister. Sur ce qui n’avait pas d’importance auquel on faisait tant de place. Embrasser une dernière fois la pluie vieille et velue. Celle qui pénètre les os qu’aucun soleil ne saura réchauffer. Tenir encore le mouillé des jours sombres, des jours seuls et froids. La glace des cœurs. Tenir encore, oh, juste un peu. Car il faut bien faire ses adieux. Se retourner sur ce qu’on a laissé en chemin. D’autres yeux nous appellent, d’autres bouches. D’autres bras. Le sourire des heures devant devancées. Quand on a marché. Quand on a beaucoup déroulé la frange des montagnes. Quand on a aimé ce qui ne nous aimait pas. Quand on a grandi comme une fleur de falaise. Quand on a bu notre propre eau, notre puits, notre source. Quand on a habité ce qui ne s’habitait pas. Quand on a puisé à son propre soleil. Quand on a dénudé la mer des hommes. Quand on a peigné lentement la chevelure des rivières. Quand on a marché encore. Quand on a attendu ce qui ne viendrait pas. Quand on a écouté le silence, tellement écouté. Quand on a cru entendre des voix derrière. Des choses nous quittent. Des choses vieilles, tristes. Et il faut pleurer pour écouler les peaux mortes. Les peaux tissées à force de patience et qui ne nous vont plus. Il faut pleurer pour laisser aller la cendre des temps anciens. Il faut beaucoup pleurer pour naître.

Confinement Covid-19 / 31 mars 2020
Jour 15
La première chose que tu feras quand tu pourras sortir :
– Marcher dans la nature
– Voir des amis
– Manger une glace en centre ville
– La première chose que je ferai sera de m’épiler
– Moi, j’irai voir mon ostéopathe
– Rendre visite à mes parents
– J’irai m’asseoir à une terrasse, je boirai un café et je regarderai les gens passer dans la rue
– Je prendrai rendez-vous chez le coiffeur
– Quand je pourrai sortir j’irai faire un grand footing
– Travailler
– Me laver
– Moi, quand je pourrai sortir, j’irai voir la mer
– Me maquiller
– Je prendrai ma voiture, je roulerai tout droit et je regarderai le paysage défiler
– Un grand repas avec plein d’amis
On pourrait recouvrir la glace avec des papiers découpés. Coller, sur la froideur, des images de soleil. L’âpreté des cœurs cachés derrière. On pourrait coller des photos de magazines sur l’oubli et la mémoire. Pour faire semblant qu’il fait chaud. Pour perdre la peur des autres, des virus, des contaminations. On pourrait faire croire à un mirage, miracle pour de faux. Quelque chose qui dit que nous sommes unis et que nous le resterons. Qu’après ça ne sera pas comme avant. Que, quand nous sortirons, nous aurons pris la couleur des images. Qu’aucun amour ne se décollera. Qu’il y aura des choses qui auront changé, vraiment et pour toujours. Qu’on va continuer à s’asseoir dans l’instant. Que nos mains resteront tendues vers des inconnus en manque, en manque de mots, d’amour ou de nourriture. Qu’on téléphonera, comme ça, pour rien, pour savoir si ça va. Qu’on sourira à notre voisine, qu’on acceptera que les autres soient si différents. Si différents et si pareils. Que ça sera pour de vrai. Qu’il n’y aura plus d’images, de colle ni de papiers entre nous. Qu’il n’y aura plus de choses qui pourraient se détacher. Que nous serons autres autrement pareils pour de vrai.
Hermine a 90 ans dans quelques jours. Elle marche quotidiennement sa petite heure dans sa petite ville. Et puis elle ne marche plus parce qu’un certain virus. Elle n’a pas peur, dit-elle. Elle préfère rester prudente. Alors elle ne sort plus. Elle me dicte la liste des courses au téléphone. Et je lui dépose un sac. Apparition fugace. Ne pas trop s’approcher. Marthe m’a contactée sur internet. Elle a noté son nom, son adresse et son numéro de téléphone. Je ne l’aurais pas rencontrée autrement. Sans doute ne sait-elle pas demander à ses voisins. Sans doute est-elle comme moi. Elle me ressemble. Elle déambule son heure dans son appartement. Elle le fait tous les jours. Moi, je marche avec les mots. C’est pareil. Je ne sais pas où est la famille de Marthe, si elle en a une. Et ses amis ? Je ne sais pas. Je n’ai pas posé de questions. Je garde ma petite Marthe, petite dame tremblotante. Je m’occupe d’elle. Je m’occupe de moi. Je reprends sens et vie. Je reprends joie. Je me remets dans le monde. Avec des gens qu’on ne connaît pas. Avec des mains. Des choses qu’on peut faire pour eux. Des choses qu’on ne peut pas faire ou qu’on ne sait pas. Une petite dame toute seule chez elle qui s’inscrit sur une plateforme internet pour qu’on lui apporte à manger. Et c’est le monde en entier. Je dépose son sac. Je lui demande de s’éloigner pour le lui poser dans l’entrée de son appartement. Il est trop lourd pour elle. Elle a préparé un chèque du montant des courses. Elle a arrondi au chiffre supérieur. Elle me tend une enveloppe tremblotante à son entête sur laquelle elle a délicatement écrit mon prénom : Rozenn. Elle a pris tout ce temps. Elle m’attendait. Elle m’attendra aussi vendredi quand j’irai à la pharmacie pour elle et que je viendrai lui déposer son petit paquet. Et toutes les deux nous nous « habillerons le cœur » (le renard dans « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint Exupéry).
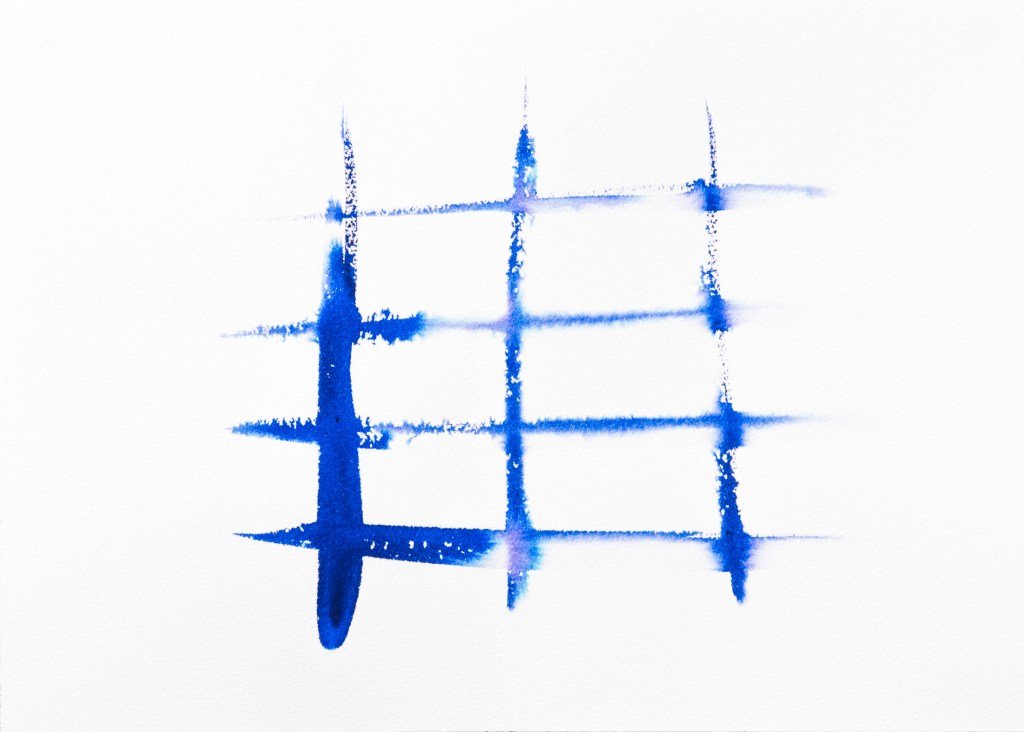
Confinement Covid-19 / 30 mars 2020
Jour 14
Les enfants sont revenues. Cris, chants, cavalcades. Des jardins entiers sont arrivés avec elles. Des fleurs, des milliers de soleils, des mots, des abeilles. Des bras, des mains aussi. Sont arrivés des tornades de cheveux, des parfums, des rires. Des chahuts et des questions. Les enfants sont arrivées avec les devoirs à préparer, les appétits précoces, les attentes de goûters, la vaisselle à faire. Une faim gigantesque, de nourriture, d’écoute, de paroles, d’attention. Tornade dans notre silence de 4 jours. Redevenir mère tout à coup et immédiatement. C’est urgent, nécessaire, vital ! C’est obligé, bruyant, exigeant. C’est maintenant ! Les enfants sont revenues et il faut quitter sur la pointe des pieds notre temps, notre calme, notre paix. Le silence fragile des heures de solitude. Il faut quitter les espaces sans contraintes. La lenteur. Et si on gardait tout en même temps ? Les enfants, le silence, les goûters, l’écriture, le calme, la parole, les devoirs, la liberté, les contraintes, la paix, le rire, la méditation, la vaisselle, la lecture, l’écoute, le yoga, le chahut, la paix. Et si on essayait ?
Crache ton angoisse. Déterre tes os. Ils n’ont plus d’utilité ici. Oublie tes dents, tes ongles, ce qui déchire et broie. Oublie tes cils et tes cheveux. Ce qui protège. Ce qui mord, ce qui griffe, ce qui déchiquète. Oublie ce qui tue et ensevelit. Oublie ce qui anéantit. Cela n’a plus d’utilité ici. Ici naît toute chose. Ici éclot ce qui n’a jamais vu le jour. Une lumière qui n’est pas faite pour les yeux. Un ciel qui ne peut se voir. Et l’infini habité. Et le cœur conscient. Ce qui grandit, jaillit, germe. Ce qui sème sa substance. L’invisible prend toute la place. L’invisible nage en nous et nous nageons en lui. Nous, vastes, limpides, sans limites.
Un oiseau est venu. C’était ce matin. Un oiseau est venu. Habite ma tasse. Et je le bois. Une fenêtre entre nous. Un rendez-vous subtil. Nous nous regardons. Nous, le sauvage et le libre. L’instant posé sur la branche du vent. Un mouvement arrêté. Une attente. Je suis en équilibre. Et le monde pourrait basculer. Un oiseau est venu. Il habite ma maison. C’est quand je sais le voir. C’est quand rien d’autre n’a d’importance. C’est quand je ne bricole rien avec mon cœur. C’est quand tout est là. Une fenêtre entre nous. L’air que nous respirons. Et la ville, derrière, reculée par tant de grâce. Et le bruit, loin, reculé. Un oiseau. Il chante. Mon oiseau, il va où bon lui semble. Mon oiseau, il n’a pas de pays. Il n’a pas de rue, de quartier. Il n’a pas de nom, d’adresse, de matricule. Une fenêtre entre nous et nos mondes semblables. Moi aussi je me tiens au bord du temps. Je me pose parfois dans des minutes graves. Moi aussi je me tiens au bout d’un arbre pour attraper le ciel. Le sauvage et le libre. L’attente. Un oiseau est venu.

Confinement Covid-19 / 29 mars 2020
Jour 13
Nous avons changé d’heure. Nous avons changé, échangé notre temps. Nous avons mis nos mains comme ça pour entendre l’écho de notre voix. Nous avons troqué nos heures laborieuses. En contrepartie, des minutes lentes. Des saveurs nouvelles. Personne ne s’occupe de nous. C’est à nous de nous occuper de nous nous-mêmes. Chacun pèse son poids. Sommes-nous samedi, dimanche, lundi ? Sommes-nous 14 heures, 15 heures ? Nous n’avons pas de travail, nous n’avons pas de rendez-vous. C’est un temps intérieur, différent. Un temps à l’écart du monde. Une liberté. Une chose longue, incroyablement longue. Des journées où l’on pourrait ne rien fabriquer. Ne rien bricoler de visible. Des jours sans preuves de nos existences. Sans témoin magnifique et sans regard. Des moments sans traces comme oiseaux dans le ciel. Sans impact. D’extrêmes douceurs. Et notre nature qui boit à sa source. Des lumières sans contraintes. Espaces sans frontières. Nous pouvons y marcher sans nous arrêter car nous sommes si grands. Oui, nous sommes aussi grands que porte notre regard. Que porte le regard de mon regard. Et après et après. Et après, quand nous ne sommes plus capables de voir, de voir avec nos yeux. Nous sommes au-delà des heures, au-delà des montagnes. Beaucoup plus grands. Beaucoup plus grands. Nous sommes une chose sans mesure. Et quand une heure ne veut plus rien dire. Et quand un jour ne veut plus rien dire. Nous sommes ce qui va.
Je mange des rivières. Je mange des choses tombées d’un arbre qui y remonteront bientôt. Je me nourris de la pulpe, de la joue des forêts. Je me nourris de ce qui court les champs. De ce qui ondule dans le vent. Je mets dans mon corps le corps doux des fruits. J’avale la neige du printemps. Des racines soutirées à la terre. Je prends des forces pour le monde qui vient. J’enroule les lianes du tournesol pour me fabriquer des os. Je laisse fleurir ma bouche et dans la pluie nagent des montagnes qui n’existaient pas. Des gravissements, des ravissements de ravins. Des grappes profondes, pleines, mûres, attendues. Je laisse fleurir ce qui est là depuis longtemps. Des chemins, des horizons bleus et le chant des oiseaux au matin. Je mange des rivières. Je mange des choses tombées d’un cœur. Ce qui dit ce que je fais là. Ce qui dit ce. Ce qui ne dit plus rien car il n’a plus de mots. Il n’a plus de nom. Ce qui vit et c’est tout. Ce qui vit.
L’ombre des arbres s’est penchée sur nous. Elle a dit qu’il faudrait attendre avant d’être grand comme elle. Elle a dit que nous manquions encore de gouffres pour porter cette couleur de cendre. Qu’il fallait encore se brûler aux gouttes de la nuit. L’ombre des arbres a dit. Que des rivières de sang devaient nettoyer nos forêts. Que l’obscurité était nécessaire à la lumière. Que tout chemin ensoleillé était passé par l’endormissement de la vie. L’ombre des arbres a dit que de la boue traversée allaient naître des fleurs nouvelles, des fleurs qui n’existent pas. Que nous marchions dans le noir, que nous nous cognions au monde ou à nous-mêmes ou à nos peurs, comme un temps accablé. Qu’un autre temps viendrait. Un temps de franchissement. Un pont, un fil, une ficelle minuscule. Une chose comme un espoir, une certitude, une croyance. Un pays ravagé qui construit son demain. L’ombre des arbres a dit qu’il fallait passer de l’autre côté. Laisser partir le vieux monde. S’occuper du présent. Laisser tomber ses vêtements sombres et dépassés. Être nus. Être totalement. Bâtir une nouvelle peau, un nouvel homme. Danser sa vie. Naître. Embrasser des miracles.

Confinement Covid-19 / 28 mars 2020
Jour 12
Une musique m’entraîne dans des endroits d’avant. Des endroits qui reculaient le monde pour faire de la place. Des endroits qui éloignaient les hommes, les enfants, les paroles et les rendez-vous. Là-bas, on était comme en balade. Comme de marcher sept jours sans s’arrêter. Des endroits où l’ombre des mots roulait sur des balançoires. Des libertés folles. On pouvait être ce qui s’écrivait. On pouvait ne plus penser. On était une course sans fin. Une ribambelle claire comme une rivière. Et les gouttelettes qui éclaboussaient sur les côtés. On était le monde dedans complètement. C’est une musique de piano, des gouttes de pluie d’un pays d’enfance. Ce sont les brindilles avant le feu. Ce qui craque et ensorcelle. Ce qui était vivant avant, qui est maintenant mort, qui redevient vivant. Des doigts qui vivent sous la mer. Qui attendent un corps pour naître, et puis qui n’attendent plus. Ce qu’on connaît du vivant et ce qu’on ne comprend pas. Ce qui vient par surprise et on est prêt. Ce qui ne s’attend pas. Une musique m’entraîne dans des pays inconnus, des douceurs exotiques, des odeurs de pain, des caresses de chats. M’entraîne et je me laisse faire. Je me laisse embrasser par ce qu’il y a entre les mots ou derrière ou dessous. Ce qui épouse un silence à regarder dans les yeux. Une musique m’entraîne et j’écris.
La nuit, un renard vient. D’abord je découvre un terrier. Ses parois sont en or. Je m’assois et j’attends. Et il vient. Je m’assois et il vient. Il s’assoit en face de moi. Nous nous regardons. Et puis je sens que j’ai son museau. Et puis je sens la force qu’il faut à une moustache. Je sens ce qui mène ce renard. C’est une forêt et nous nous regardons. Puis il vient se blottir contre moi, s’enroule à mes genoux, s’endort. La nuit, un renard vient. Je veille sur lui. Je ne dors pas, non, je dois rester éveillée pour le protéger. Sa rousseur me fait souvenir du soleil. Je le vois au bord des champs quand les arbres grandissent leurs ombres. Je l’aperçois derrière chaque tronc. Je sens son odeur des bois, sa fourrure, ses pattes dans la boue. Renard sans bruit qui vit tout près, tout près de mon visage, la nuit. La nuit je dors, je ne dors pas. Renard.
Je suis dans le ventre de ma mère. Je flotte et je n’ai besoin de rien. Tout est donné, dans cette enclave. On me nourrit. Je dors, je ne dors pas. Et c’est pareil. Aucune incidence sur le monde. Le temps n’existe pas. L’espace n’existe pas. Un présent infini. Il n’y a pas de mémoire, il n’y a pas de pensées. Dans le ventre de ma mère, les bruits de l’univers arrivent tout doucement. Un coton flottant. Quelque chose de loin. Je suis là. Je ne sais pas les autres choses. Dans le ventre de ma mère, il n’y a pas d’attente, d’espoir, de promesse. Il n’y a rien avant. Il n’y a rien après. Territoire d’eau. Parois molles. Vivre ici.
Et tout à coup une conscience claire, brutale. Ce monde, il a besoin de plus d’enfants. Il a besoin de plus de nature. Il a besoin de moins d’argent. Moins d’accumulations, moins de placards remplis. Il a besoin de moins de voitures, vêtements, nourriture, produits. Ce monde a besoin d’un homme à sa taille. Il a besoin de plus de temps pour réfléchir, lire, jouer, apprécier, cuisiner, aimer, comprendre, jardiner, éprouver, rencontrer, prendre conscience, grandir, apprendre, s’émouvoir, évoluer, intérioriser. Ce monde a besoin de lenteur, de relations, de poésie, d’émerveillement, de présence, de respirations, de silence, d’art, d’entraide, de respect, d’affection, de place, d’optimisme, de satisfaction, de bien-être, de joie, d’amour. Ce monde a besoin de moins d’avions, de chaussures, de manteaux, de sacs à mains, de téléphones, de machines à laver, de plastique, de tasses, d’assiette, de tapis.
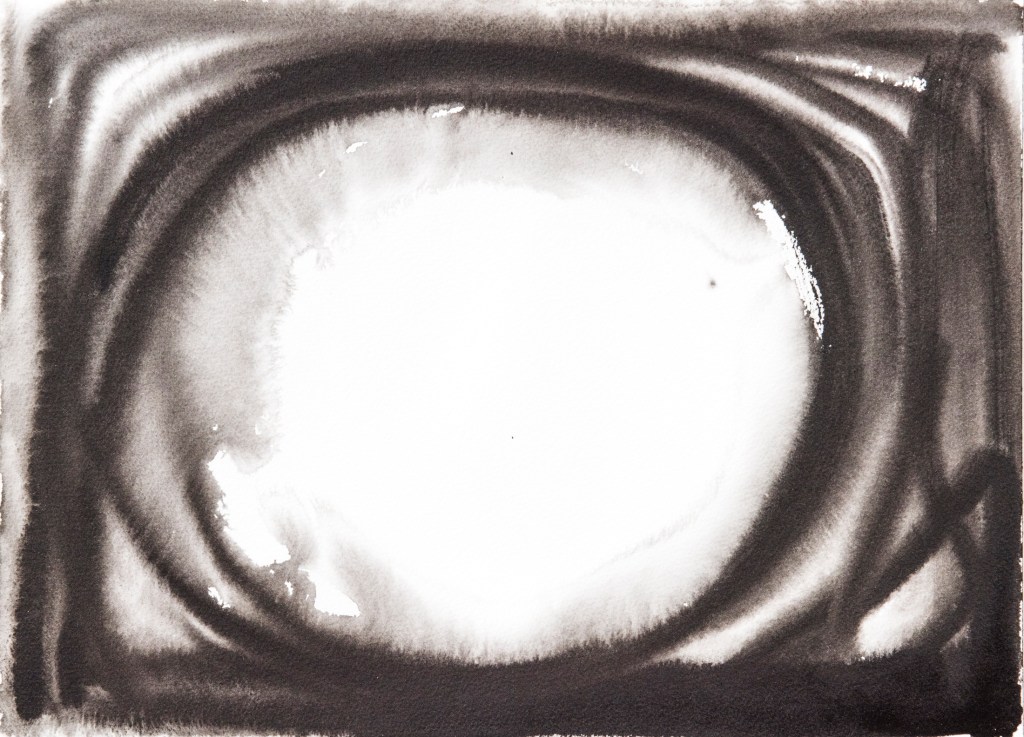
Confinement Covid-19 / 27 mars 2020
Jour 11
Le monde sans nous. Le monde sans nous c’est un soleil. C’est le ciel qui rougit de tant d’existence. Le monde sans nous croit, grandit, se rapproche et s’éloigne. Quelques notes de piano au creux d’un jardin. Le rire d’un enfant sous un arbre. Il y a des chevaux, des prairies, des champs de fleurs. Il y a les traces de nos mains et nos corps posés sur des branches. Des poissons scintillants. Ce qui chante aussi quand nous dormons, quand nous souffrons, quand nous courons vers des choses sans vie. Il y a ces sourires oubliés dans des temps lointains, ces chemins seuls. Il y a des gestes simples simplement d’amour. Des choses sans peur. Des instants habités. Le monde sans nous c’est une lumière. L’eau nettoyée des humains. Les nuages du sacré et sa pluie aussi. C’est l’orage qui fait rentrer tout le monde chez soi. C’est le tonnerre qui arrête. Un bras suspendu qui ne sait plus quoi faire. Une herbe nouvelle ressuscitée. Une liberté d’oiseaux. Des chats, des milliers de chats. Des traces de pattes sur la plage. Le monde sans nous. Silence de libellules. Une profondeur de sable. L’heure douce des retrouvailles. Le sauvage ressurgi. Le monde sans nous court, vit, danse. Un arbre, a-t-il besoin d’argent ? Un arbre. Un peu de pluie, un peu de soleil. Toute nature renouvelle sa peau. Toute rivière chahute sous la mousse. Tout existe. Tout respire. Tout a sa chance. Choisissons-nous le monde sans nous ? Aimer, ça serait ne pas abîmer, ne pas mordre, ne pas dévorer. Aimer ça serait être à sa taille. Se souvenir d’un jour sur le sable. Se souvenir d’une vague, d’un vent. De ce qui est plus grand. De nous, plus grands. Se souvenir.
Il y a des choses que l’on ne sait pas dire. Des promesses non tenues. Des escaliers inachevés. Rêves abîmés en pleine mer. Naufragés et c’est nous. Mutilés comme on coupe des racines. Où est la terre ? Cercueils sous l’eau tout au fond. Les murs que l’on construit entre nous et le silence. Et ce sont des ruines d’enfants. Et ce sont des châteaux dans le sable, un dimanche de pluie. Chacun tient son sel haut dans la brume. Chacun tient ses lèvres vers des fruits pourris sur la branche. Plus rien ne tient. Plus rien ne penche. Plus rien ne sait même tomber. Des chaises attendent des corps. Des lits attendent, et des armoires pour des linges ensanglantés. Des bras pour des bébés morts. Sauver la montagne. Sauver ce que nous avons enfermé dans un bocal. L’eau, le vent. Les graines d’espérance. Sauver l’éclosion des papillons. Lucioles oubliées dans la nuit des hommes. Sauver les animaux mutilés. Sauver le cri des forêts. Les déserts de cœur. Les pleurs des sentiers innocents. Oui, il y a des choses que l’on ne sait pas dire. Des vies inattendues. Des bonheurs éphémères qui auraient pu naître. Des mélodies de villes. Planètes tenues par la main. Passons nos doigts dans la chevelure du temps. Écartons une mèche, un rideau. Découvrons le front du monde. Doucement pour savoir s’il a froid, s’il a chaud, s’il faut encore le couvrir et lui donner la tisane qui fait bien dormir. Celle qui soigne et qui caresse. Celle qui dit « je suis là », « tout va bien », « dors », « à demain ».
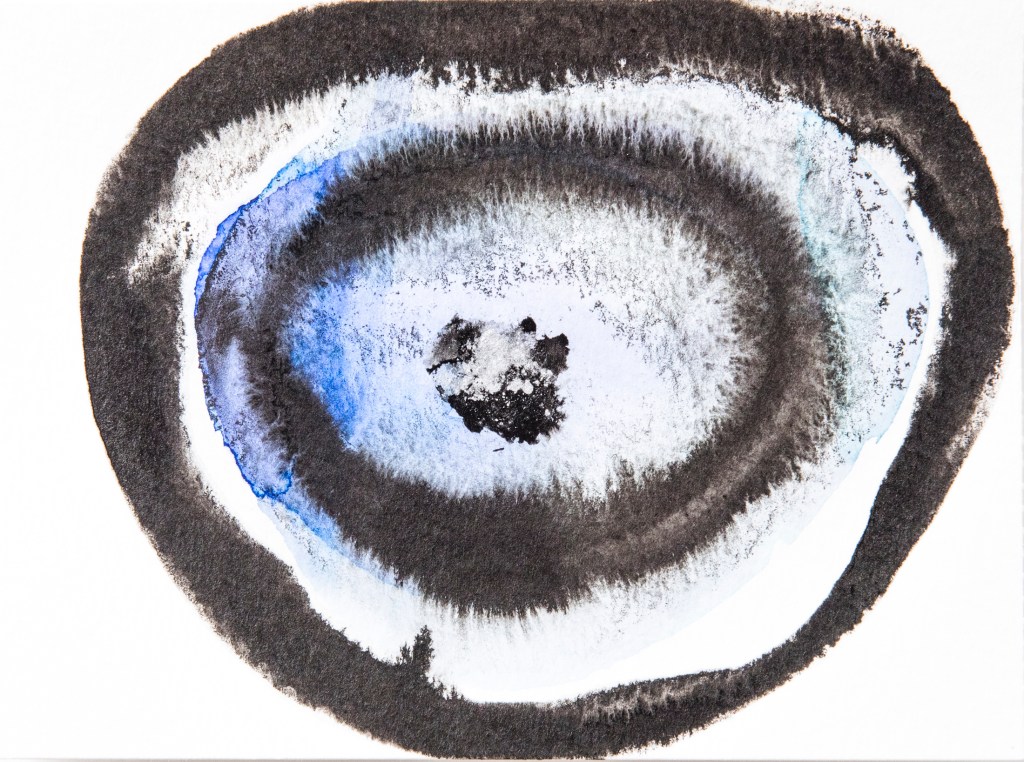
Confinement Covid-19 / 26 mars 2020
Jour 10
Les enfants sont partis. Il reste le fantôme de leurs voix dans le couloir. L’odeur du pain grillé. Un chahut de chambre et de table. Des petits pas. Des chaussons oubliés. Le fouillis sur le canapé. Un parfum de vanille. Des cheveux dans le lavabo. Un dentifrice non rebouché. Une lumière restée allumée. Un livre ouvert. Une tasse qui n’est pas à sa place. Des miettes. Le poids d’un corps sur les genoux et des bras qui serrent. Un sourire. Une joue. Des bruits de bouche et de la sauce sur la nappe. Un baiser mouillé. Le frottement d’une chevelure, celle qui joue au chat enragé et qui feule. Des pieds petits et froids. Un rideau repoussé pour mieux voir les oiseaux. Une pomme grignotée.
Les enfants sont partis chez leur père. S’asseoir seule avec soi-même. Ne plus préparer les repas, du travail scolaire. Ne plus s’organiser. Ne plus s’occuper des autres. Nous tenions quelque chose de plus grand et de plus nombreux. Nous tenions car nous voulions bien faire, trop faire. Et puis nous tenons encore un petit peu. C’est un instinct qui s’étiole doucement. Une chose de mère qui était enclenchée, à laquelle il faut un peu de temps pour refroidir. Et puis il faut accepter quelque chose qui tournerait sans nous. Qui serait autrement. Nos enfants, ont-ils besoin de nous ? De notre sentiment de mère qui fait bien, qui décide, qui organise. De notre place centrale qui permet que ça fonctionne. Accepterions-nous, les mères, que cela marche à notre insu ? Que nos enfants aillent dans le monde comme ils sont. Accepterions-nous de laisser faire, d’attendre, de regarder, d’écouter… de perdre un peu de notre rôle ? Et si. De ne pas décider, organiser, tenir, vérifier, noter, penser à, solliciter, organiser, tenir, vérifier, s’assurer, organiser, contrôler ? Et si nos enfants faisaient comme ils l’entendent, à leur rythme, quand c’est le moment pour eux ? Et si nous étions là, simplement, sans interventions, exigences ou directives ? 5 jours pour y penser !
Aujourd’hui j’ai rendez-vous à 12h dans un restaurant avec 4 amies. C’est marqué dans mon agenda. Covid-19, confinement depuis 10 jours. Interdit. Alors, non, nous n’irons pas. Nous ne verrons pas ces sourires, nous ne partagerons pas ces regards. Cette chaleur humaine qui manque. Ces choses simples. S’embrasser et se toucher le bras. Se demander si on va bien. Se complimenter sur notre tenue, notre coiffure, notre bague. Rire. Parler du temps qu’il fait. Évoquer notre lien avec le cosmos. Goûter le plat de la voisine de droite. Raconter une histoire. Manger lentement, on ne veut pas grossir. Trouver des rapprochements dans nos activités professionnelles. S’encourager. Se proposer un processus qui aide à obtenir ce que l’on veut et à réaliser nos rêves. S’inviter à une conférence. Dire des mots affectueux. Se passer le sel. Écouter. Apprécier le parfum de sa voisine de table. Parler de nos enfants. Sourire. S’émerveiller. Se demander quand on se retrouvera de nouveau. Se donner des idées. Se découvrir. Goûter le plat d’en face. Nommer ce qu’on aime dans ce restaurant. Raconter où on en est de notre épanouissement personnel. Se confier. Apprécier la joie de cette petite équipe. Créer des connivences. Accueillir l’atmosphère bienveillante. Se sentir bien : respectée, entourée, à notre place. Vouloir prendre un dessert. Saisir le bonheur. Écouter vraiment. Goûter pleinement le présent. Prendre conscience de ce moment précieux. Manger un dessert. Voir ce qui brille dans les yeux des autres. Réfléchir à sa vie. Se remémorer un film. Se donner des conseils. Se dire qu’il est l’heure de partir. Fixer le prochain rendez-vous. S’embrasser et se toucher le bras. Se quitter. Se faire coucou sur le parking. S’aimer.

Confinement Covid-19 / 25 mars 2020
Jour 9
Des livres. Des gros, des petits, des lents. Des voix pour nous parler dans la nuit. Des murs de livres, des maisons livres. Dormir dans des bras doux. Marcher entre les mots. Voyager. Enrouler sa langue à la langue des autres. Ruban dans le vent. Cerf-volant attaché à une petite corde, une ficelle minuscule. Goûter aux phrases molles, celles en sucre et en guimauve. Goûter aux phrases robustes et incendiaires. Ramasser des milliers de bruits. Syllabes accumulées dans un torrent de pages. Aller pas à pas à la blancheur prochaine. S’enfoncer dans le noir. Écouter les rumeurs, les prédictions d’apocalypse. Des mots pour nous accompagner dans un chemin de sens sensations. Le labyrinthe des regards et des spéculations. Lire. S’arracher à ce monde. Lire. S’accrocher à ce monde. Y déceler les pierres de lumière. Trouver au fond des boues l’étincelle de plaisir. Les choses à allumer pour qu’il fasse jour dehors. Remonter ce précieux butin qui éclaire nos heures. Gravir les profondeurs. S’extirper de la désolation, du dégoût, de la peur. Se rencontrer en eux. Partir. Il existe des livres qui vous rendent humains. Des mots couchés par terre qui vous mettent debout. Des idées d’autre chose. Des envolées lyriques. Des feuilles miraculées vous envolent et c’est vous. Il existe des voix intenses, présentes, amicales. Des voix qui palpitent dans un monde qui s’en va.
Attente. Quelqu’un doit nous dire ce que nous devons faire. Ce qui est dangereux, ce qui est nécessaire, ce qui est interdit. Quelqu’un doit nous dire. Un virus dévore le monde et il faut se cacher pour pas qu’il nous attrape. S’enfermer, se terrer, vivre petitement. Réduire nos mouvements, notre alimentation. Réduire nos consommations, nos déplacements, nos achats. Le monde se rapproche à portée de main, à portée de bouche. C’est notre nouvelle vie. Une vie vitale. Une vie essentielle. Une vie à notre taille, juste à notre taille. Avec pas trop de trucs en plus. Une vie avec des gens qui envoient des messages, des vêtements ce qu’il faut, du chauffage, une maison, de l’eau chaude, de la nourriture. Les gens qu’on aime tout près. Des moments partagés. Du temps. Des livres. Des présences chaudes. De quoi écrire. Du silence. Ne serait-ce pas le début du paradis ? Un commencement. Oui, il manque la nature. Oui, il manque les longues marches dans le vent. Ne serait-ce pas un morceau de bonheur ? Un bout petit de ce qui nous ressemble ? Un plus proche, un plus juste, un plus humain. Ne serait-ce pas un plus écologique-économique. Vivre avec moins. Vivre davantage. Vie à notre dimension. Une lenteur et le temps dure plus longtemps. Une hauteur. Une profondeur. Une chose qui pardonne, une chose qui sourit, une chose qui aime. Saurons-nous, lorsque toutes les portes seront ouvertes, saurons-nous ne pas nous engouffrer ? Ne pas nous tromper de monde ? Ne pas retourner à avant ? Saurons-nous garder trace de ce confinement ? Se mettre debout dans le vent, plonger ses yeux dans l’horizon, construire une vie qui ressemble à celle-là.
Où êtes-vous, les silencieux ? Ceux qui ont disparu depuis. Où êtes-vous, sœurs, frères de vie ? Ceux qui se sont tus. Ceux qui ne se manifestent plus. Ailleurs, au fond d’un lit ? Ailleurs au creux d’une tombe ? Avez-vous perdu vos mots dans la bataille ? Êtes-vous tombés en inquiétude comme on tombe en amour ? Où êtes-vous, les lointains ? Ceux qui s’étiolent dans un brouillard, ceux qui ne savent plus être. Ceux qui ignorent comment partager la peur. Oui, la peur se partage, elle est moins lourde, moins noire, moins putréfiante. Où êtes-vous, les inquiets ? Ceux qui pensent que les virus se transmettent en téléphonant, en regardant, en respirant. Ceux qui ont tiré les volets sur des fenêtres déjà fermées. Où êtes-vous, les solitaires ? Ceux qui ont rajouté des pays de silence entre les autres et eux. Ceux qui se sont absentés, absentés d’eux-mêmes. Ceux qui n’ont plus de ligne, de fil, de ficelle pour rejoindre. Où êtes-vous, les perdus ? Ceux qui sont tombé quelque part en eux-mêmes. Ceux qui vivent dans le noir. Ceux qui infiniment affamés de lumière. Ceux qui cherchent, ceux qui ne cherchent plus. Ceux qui se sont arrêtés en plein vol. Ceux qui ne savent même plus pleurer. Ceux qui ne savent même plus manger ou dormir. Ceux qui ne savent même plus respirer. Où êtes-vous ?

Confinement Covid-19 / 24 mars 2020
Jour 8
Jour gris. Jour en attente d’un autre jour. Jour tenu sur la pointe des pieds quand la respiration manque. Quand loin ne se voit plus. L’espace rétréci se rapproche. Jour sans horizon. Jour articulé aux bouches mutiques du monde. Aux corps qui tombent dans des fosses, des failles, des faiblesses innées. Chacun se ferme pour fermer son sang, son cœur, ses poumons assoiffés. Chacun respire dans son poing tout petitement. Chuchote quelques mots comptés sur le bout de la langue. Se penche au bord du monde, au balcon d’un pays qui chute. Chacun se tait, se terrestrement clôt. Chacun pleure en silence silence silencieux. Chacun pieuvre et tentacule les ombres auxquelles s’accrocher encore. Une idée de l’humanité, la silhouette d’un homme, d’une femme, d’un enfant. L’écho d’une voix après le mur après le mur après le mur après le mur. Le cri des chiens.
Ne pas s’épiler, ne pas faire la vaisselle, ne pas ouvrir la boîte à lettres, ne pas regarder l’heure, ne pas préparer son sac pour demain, ne pas se laver, ne pas chercher ses clés, ne pas faire sa liste de la journée, ne pas s’apprêter pour sortir, ne pas penser, ne pas mettre ses chaussures, ne pas s’habiller, ne pas marcher, ne pas travailler, ne pas dire bonjour à sa voisine, ne pas regarder ses mails, ne pas se brosser les dents, ne pas faire de sport, ne pas se regarder dans le miroir, ne pas passer l’aspirateur, ne pas se coucher tôt, ne pas préparer ses vêtements pour demain, ne pas programmer une sortie au restaurant, ne pas faire de lessives, ne pas imaginer une autre vie.
Passe passe passera. Passage de nuages. Passage d’oiseaux en partance. Ce qui vit sans le vent. Ce qui traverse les frontières. Un pollen, une poussière d’étoile, un virus. Ce qui se promène. Maladies en balades. Ce qui s’installe, s’arrête, déglutit. Passe passe passera. Arriver, transporter, déplacer, émigrer, aller, devancer, courir, s’écouler, transmettre, sauter, circuler, venir, partir, rendre visite, marcher, suivre, fuir, s’infiltrer, précéder, enjamber, évoluer, côtoyer, pénétrer, filer, parcourir, contourner, transférer, escalader, passer. Être un passager de la vie, du vent. Un passager vacillant du demain. De ce qui vient. Être. Assister à l’éclosion des bourgeons. La lumière s’apprête. Un chant monte, grandit et se déploie. Une chanson. La chanson d’un homme nouveau, traversé, grandi, superbe. Quand nous aurons passé dépassé ce temps incertain. Quand nous aurons vécu chaque jour comme chaque jour. Quand nous aurons vécu chaque heure comme chaque heure. Quand nous aurons vécu chaque minute comme chaque minute.
Je crois que je tombe. Je crois que je vacille, j’éternue, je tousse, je fébrile. Je flotte en mes barrières, mes barricades dociles. Mes choses apprivoisées autres autrefois dans ce qui existait avant. Je remets mes habits trop grands ou trop petits. Ces choses qui ne sont plus à ma taille. Ce qui ne va plus. Il me faut découdre le monde, les habitudes, les croyances. Il me faut découdre les certitudes. Des murs construits qui construisent des appartements, des immeubles, des routes. Des villes construites qui construisent des régions, des pays, des mondes. Des mondes construits qui construisent des planètes. Il me faut détricoter des continents d’idées fixes, des océans de preuves, de calculs, de théories. Ce qui est sûr et certain à balayer avec me petite balayette rose à pois. Il me faut nettoyer, gommer, désinfecter ce qui semble encore exister qui est pourtant mort. Une vie nouvelle prend place, définitivement autre. Il me faut penser nouvellement pour épouser ce qui reste et ce qui naît déjà.

Confinement Covid-19 / 23 mars 2020
Jour 7
Je vis dans un jardin. Une colline dans le vent. Je vis dans une herbe épousée de fleurs. Là vivent aussi des rivières, des chants d’oiseaux. De longs chemins qui s’égarent en eux-mêmes. Des cailloux petits qui tiennent dans la main. Des arbres. Ceux qui font le jour. Ceux qui font la nuit. Je vis dans un jardin. Une envolée de branches. Un sourire applaudi et secret. Une épaule glissée au bord de la lumière. Un dos qui s’agrandit. Silence au cœur chevalier. Silence aux bras endormeurs d’enfants. Je vis dans un jardin. Une douceur verte entourée de pierres. Un mur avec une porte. Et puis une serrure et puis une clé. Des parfums d’ailleurs. Des voix d’un autre jour. Un front de libellules quand il fait clair, quand il fait pluie aussi. Une ronde de feuilles, un ballet de lucioles. Ce qui flotte dans l’air. Poussière de pollen venue d’un autre monde. Je vis dans un jardin. Un creux comme une bouche où s’asseoir longtemps. Une musique blanche ou peut-être une harpe. Une main sur un tronc. Des yeux dans l’eau qui court et s’apitoie. L’ombre des jours passés, présents. L’enlacement des nuits et leur tissu soyeux. Un jardin de passage au milieu d’une enclave. Et puis après il y a le reste, le reste du pays. Colline qui voit loin et longtemps. Là-bas attendent des paysages oblongs. Des tentatives de mondes. Des habits habités de maisons, de cuisines et de chambres. Des couloirs et des portes. Je vis dans un jardin, et puis après, le monde.
J’attends que quelque chose revienne. J’attends le retour de la vie d’avant. Quand on pouvait sortir. Quand on pouvait aller librement. Et puis rencontrer les autres et puis les voir en vrai. Marcher dans une nature sauvage et dépeuplée. Sentir le vent. Et puis, il y avait aussi les rendez-vous, les mails, les sms, les appels téléphoniques, les notes dans notre agenda, les sollicitations, le travail, les choses à faire, les dossiers, les obligations. Tout manque. J’attends. J’attends que l’on me dise que c’est fini, qu’on peut sortir à nouveau, qu’on peut reprendre notre vie. Qu’on peut, à nouveau, être envahis par ce monde fou, goulu, rapide, stressé, anticipateur, exigeant, urgent, inhumain, oppressant, dépensier, démultiplié, futile, stressant, pollué, consommateur, factice, rempli, extérieur, maquillé, destructeur, superficiel, polluant, obsessionnel, inessentiel. Tout manquait. J’attends que quelque chose revienne autrement. J’attends le retour de ma vie. Une vie épaisse et dense, grossie de ce temps suspendu. Une vie de bientôt, faite de ces heures. Nourrie et décidée. Une vie lente lente lente. Une vie intérieure. Avec du moins pour faire du plus. Une vie bio. Cultiver un temps généreux, un temps de livres. Un temps qui prend toute sa dimension. Remettre sa vie à l’endroit. S’écouter, poser son rythme propre, aimer.
Confinement Covid-19 / 22 mars 2020
Jour 6
Les gens de la rue, les a-t-on laissés tous ensemble pour qu’ils meurent plus vite ? Ceux qui dorment là-bas sans maison. Ceux qui tendent la main vers rien car il n’y a plus de mains dans les villes. Les gens de la rue, ont-ils droit à plus de place, plus de liberté, plus de virus ? Le ciel se penche-t-il vers les sans toit ? Que manger dans le désert ? S’ouvrent les boulevards. Tout est trop grand, trop lent, trop loin. Les gens de la rue. Plus de bruits de circulation. Plus de pièces. Plus de nourriture à marauder. Beaucoup plus d’air à respirer. Mais l’air, suffit-il ? Dans le vide des villes errent des êtres furibonds. S’ouvre l’espace. Plus personne ne chasse l’homme de la rue. On le donne à ce qui transpire transporte ses virus dans le monde. Beaucoup plus d’air à respirer !
Le soleil se couche. Comme hier comme hier comme hier. Rien n’a changé. Tout a changé. Quand le soleil se couche, tu n’es pas avec lui. Enfin… tu comprends. C’est comme s’il le faisait sans toi. Comme si ça ne te concernait pas pour encore quelques semaines. C’est loin, ce coucher de soleil. Ça a basculé dans un endroit blanc, une parenthèse absurde, un brouillard que l’on traversera plus tard. Un ailleurs, autrefois. Un demain incertain et pourtant en attente. Un truc promis mais on ne sait pas quand. C’est comme un monde et un autre. Dedans, dehors. Et ça ne va pas ensemble. C’est séparé. C’est interdit. C’est momentanément éteint et ça ne fait pas partie de ta vie. Ça reviendra. Ça reviendra quand on te le dira. Quand on t’annoncera que tu pourras sortir. « Regarde, le soleil se couche ! ». Et ça sera un autre soleil.
Dimanche. Les cloches de la cathédrale. Cette fois je les écoute. Je retourne aux clochers des villages. À ces endroits lents restés dans le temps. Je retourne à des vies où on va à pied. Où ce qui résonne nous parle. C’était les vacances. C’était la campagne. C’était tout petit et nous allions vivre là des jours entiers, des heures pleines, des minutes de banc. Chaque chose prenait place. Chaque chose prenait son temps. Je veux dire, vraiment. Je veux dire que les choses, le temps, elles le tenaient dans leurs petites mains. Et nous marchions petitement et nous parlions petitement. Acheter le pain, faire le marché, rentrer, cuisiner. Je me souviens, c’était avec mamie. Manger, faire la vaisselle et il était déjà 14 heures. Et qu’est-ce qu’on va manger ce soir ? Et on repartait dans une chose petite, toute petite, et si grande, si abondante. Les secondes, nous les comptions en tenant la main de mamie. Les oiseaux sur le chemin, les fourmis, nous les comptions. Nous pouvions les compter un à un, une à une. Car tout avait une corpulence. Cette épaisseur de cheveux qu’il fallait coiffer. Et nous coiffions le monde, nous le peignions comme un petit enfant pour qu’il soit beau et propre et présentable.
Ferme les yeux. Derrière, au fond, une lumière ou des couleurs. Ça dépend des jours. Regarde bien. Derrière, dedans, des paupières de lune. Aurores boréales. Ça chante, ça danse. Ferme les yeux. Attends le ciel étoilé, et il vient. Un bruissement. Écoute. C’est doux, petit et chaud. Un jardin, une plage. Des fils habitent là. Membranes, entrelacs. Particules épousées par d’autres. Quelque chose se tient, se contient, et c’est toi. Quelque chose bat infiniment. Et ça respire. Écoute. Un oiseau migrateur. Une rivière. Le vent froid des cimes. Un rire. Une chanson et une balançoire. La sensation de l’herbe sur les pieds. Une dame de pique. Des voix venues de loin, des voix d’enfants. Un tambour. Un piano aussi. L’odeur de pain chaud. Le bruit de l’eau qui coule. Senteurs de forêt. Ce qui roule sous les pas quand on marche, ce qui craque. Le poids d’une main dans la sienne. Une fleur. La douceur d’une feuille. La chaleur du soleil. Une robe dans le vent. Le murmure du feu. Un corps allongé sous un arbre. Ce que sent le linge propre. Un gâteau au chocolat. Une main dans nos cheveux. La clochette du marchand de glace. Une femme et un homme dans un tableau. Quand on fait du vélo très vite et qu’on sent le vent. Un papillon. La la la, la la la la. Un cimetière champêtre. Courir dans un champ. Rire.

Confinement Covid-19 / 21 mars 2020
Jour 5
Tenir des corps légers. Rire. Se rouler par terre à plusieurs. Faire le jeu des chatouilles. Se mordre en faux. La bagarre dans le couloir. Rire. Avoir envie de faire pipi par terre. Le poids des autres. Attraper une jambe. Pincer les fesses des enfants. Attaquer. Coincer ce qui s’agite et donne des coups de pieds. Crier. Se laisser faire. S’asseoir sur les petits. Ramper. Glisser. Enlever son bras qui est sous le dos de l’autre. Entendre crier très fort et très près. Faire la bagarre pour de faux. Mettre son poids. Rouler. Serrer. S’allonger sur. Se défendre. Faire équipe. Non, chacun pour soi ! Mordre doucement. Prendre le corps, le porter. L’emprisonner. Bercer. Chanter une chanson inventée pour de rire. Se calmer. Faire croire que c’est fini. Sauter sur les enfants. Les attraper, les serrer. Les traîner par terre. Saisir un pied. Éviter les coups. Lécher la joue. Beurk ! Être essoufflée. Renifler dans le cou. Dire stop. Dire encore stop. Rire. Dire qu’on veut plus jouer. Se reposer.
Il y aura d’autres soleils. D’autres arbres naîtront dans nos yeux. Il y aura d’autres matins. D’autres rues peuplées et criardes. Il y aura d’autres visages inconnus et fugaces. D’autres oiseaux vivront sur d’autres branches. D’autres villes qui seront semblables et transformées. D’autres choses avancées dans le temps et qui habiteront pour nous. Il y aura d’autres naissances et chacun neuf, né à peine aujourd’hui. D’autres hommes les mêmes autres autrement. Il y aura un monde nouveau, une lumière limpide et nettoyée. L’univers se lave et prépare ce que nous attendons. La robe des saisons tourne et se pavane. Dans notre maison, la rivière passe sa langue sur le ciel. Tout est bleu. Tout est habillé de transparence claire. Tout rit. Le monde, le nouveau, attend l’homme, le nouveau. Et c’est bientôt.
Écoute le renard. Écoute ce qu’il te dit quand tu n’es pas là. Écoute, quand tu dors, l’abeille du souvenir. Les traces que tu suivais dans la boue. Et puis rien, ce silence d’étoile. Et puis l’ombre sur ta main et le voyage des nuages. L’enroulement lent des coquelicots, les fougères éphémères glissées le long des murs. Le murmure de l’herbe quand elle pousse en cachette. Les racines. Celles qui allongent leurs cils sous les terre tout dessous. Et pourtant tout est nuit. Et pourtant tout est jour. Souterrains de semences, souterrains de rivières, de lacs, de montagnes sous la montagne. Creuser, s’enfoncer dans les draps du sombre. Chercher, sous la surface, ce qui tente de naître. Rêve, mirage, chose insue. Nous avons vécu là il y a longtemps. Le renard, la fougère et le ciel. Nous avons vécu là. Les racines, les rivières, l’invisible de nous.
Les choses abandonnables :
– le porte-crayons en plastique rose
– les vêtements trop petits
– les vêtements trop grands
– les boutons de notre grand-mère qu’on garde pour le jour où
– la boîte en forme de poisson aux yeux morts
– les magazines qu’on ne lit pas
– les culottes déchirées
– l’encyclopédie du bricolage
– le truc qui sent bon avec des bâtonnets en bois mais ça ne marche pas
– les chaussures très très usées
– les bocaux de coquillages de Bretagne
– aussi les bocaux de cailloux de Bretagne
– tous les dessins des enfants depuis la maternelle
– les mails de 2016
– le livre photos des merveilles du monde qui pèse 5kg
– les vieilles serviettes de toilette qu’on n’a pas données quand on en a acheté des neuves
– les photos des fleurs de Guadeloupe prises par notre mère (toutes les fleurs de Guadeloupe !)
– le 7èmemanteau
– les boucles d’oreilles dépareillées : quand on a perdu l’autre (on en a compté 18)
– les médicaments périmés
– les chaussettes trouées
– toutes les cartes postales qu’on a reçues depuis qu’on est née
– les colliers cassés avec les perles éparpillées qu’on se dit qu’on va réparer quand on aura le temps mais qu’on n’aime plus
– les calendriers qu’on nous a offerts (il y en a quand même 21, on a eu le temps de compter)
– les bocaux vides pour si jamais
– les médailles militaires de notre père
– les premières chaussures de nos enfants
– les 11 photos de mariage identiques de nos parents
– les enfants. Non : ça fait des crêpes et ça chante dans la salle de bains !
Stade 1. Interdit. Animaux de compagnie. Non. Masque. Autorisation. Fermé. Illégal. PV. Respect. Attestation de déplacement. Virus. Télétravail. Réglementation. Enfermé. Soignants. Garde d’enfants. Permission. Motif de santé. Animaux de compagnie. Liberté. Gants. Sauvegarde. Ordre. Propagation. Certificat. Société. Coronavirus. Espèce. Pas d’accord. Stade 2. Achats de première nécessité. Règle. Médecin. Indispensable. Activités sportives. Motif. Laisser-passer. Animaux de compagnie. Immobilisé. Activité professionnelle. Cloîtré. Police. Mort. Je soussigné. Pensable. Pharmacie. Assistance aux personnes vulnérables. Continuité pédagogique. Consignes. Confinement. Amende. Détresse respiratoire. Animaux de compagnie. Tolérance. Article 1erdu décret du 16 mars 2020. Infirmier. Animaux de compagnie. Ordonnance. Signature. Précaution. Covid-19. Armée. Organisation. Stade 3. Animaux de compagnie.
Je pense à ceux qui vivent. Ceux qui vivent tout seuls. Ceux qui vivent dans un tout petit appartement. Ceux qui vivent dans un endroit où il pleut. Ceux qui vivent sans chat. Ceux qui vivent sans appels téléphoniques. Ceux qui vivent avec des murs devant leur fenêtre. Ceux qui vivent sans enfants. Ceux qui vivent sans chiens. Ceux qui vivent dans un lieu sans lumière. Ceux qui vivent sans amis. Ceux qui vivent sans plantes vertes. Ceux qui vivent où le silence est assourdissant. Ceux qui vivent sans ordinateur. Ceux qui vivent sans livres. Ceux qui vivent sans savoir cuisiner. Ceux qui vivent sans internet. Ceux qui vivent sans idées. Ceux qui vivent dans des habitats délaissés. Ceux qui vivent où ça crie. Ceux qui vivent sans poisson rouge. Ceux qui vivent sans intériorité. Ceux qui vivent sans travail. Ceux qui vivent où ça sent mauvais. Ceux qui vivent sans oiseau en cage. Ceux qui vivent sans chauffage. Ceux qui vivent sans créativité. Ceux qui vivent avec les personnes avec qui il ne faut pas vivre. Ceux qui vivent sans musique. Ceux qui vivent sans projets. Ceux qui vivent sans cochon d’inde. Ceux qui vivent sans rire. Je pense à ceux qui vivent sans eau chaude. Je pense à ceux qui vivent sans chanter. Je pense à ceux qui vivent sans horizon. Je pense à ceux qui vivent tristement. Je pense à ceux qui vivent sans danser. Je pense à ceux qui vivent sans aimer. Je pense à ceux qui vivent sans voisins. Je pense à ceux qui vivent sans hamster. Je pense à ceux qui vivent sans maison. Je pense à ceux qui vivent sans rêves. Je pense à ceux qui vivent.
Confinement Covid-19 / 20 mars 2020
Jour 4
Toutes les choses qui ne savaient pas quoi faire d’elles-mêmes prennent place. Elles ont attendu qu’on ait le temps. Elles ont attendu patiemment qu’on les reporte sur une autre liste une autre liste une autre liste. Elles ont tenu dans une boîte à chaussures, au fond d’un placard, sous le canapé. Et puis nos mains sont prêtes, nos yeux et notre temps. Et puis toutes ces heures accordées en surplus. Offrande pour ne plus être en retard. Pour ralentir. Pour s’arrêter. Pour ranger nos vies.
Aujourd’hui j’ai oublié de marcher. J’ai oublié de me brosser les dents. Aujourd’hui j’ai oublié de prendre mon sac à mains. J’ai oublié mes clés de voiture, j’ai oublié où je les ai mises, j’ai oublié ma voiture. Aujourd’hui j’ai oublié de m’habiller. J’ai oublié de sourire à quelqu’un qui n’est pas là. J’ai oublié de répondre à mes mails. J’ai oublié de penser à ma liste des choses à faire, j’ai oublié ma liste, je n’ai pas fait de liste. J’ai oublié qu’il y avait des choses à faire, j’ai oublié de faire, j’ai oublié les choses. Aujourd’hui j’ai oublié le rien du temps qui passe. J’ai oublié de me coiffer, j’ai oublié de manger, de dormir, de rire. Aujourd’hui j’ai oublié de respirer.
Il paraît que c’est le printemps. Il paraît que les jours s’allongent s’allongent jusqu’à devenir des nuits pleines. Jusqu’à devenir un seul jour, énorme. Jour sans fin et sans heures. Jour sans commencement. On a perdu l’origine. Ou peut-être l’a-t-on trouvée ? On ne sait plus. Il paraît que c’est le printemps. Il paraît que des oiseaux chantent plus fort que d’habitude, que la terre s’habille de fleurs, que les grenouilles s’apprêtent. Les choses interdites sont beaucoup plus vivantes. Elles s’épanouissent quand nous ne sommes pas là. Elles dansent dans notre absence. Toute chose respire mieux sans nous. Le monde retrouve sa liberté, sa croissance, sa naissance. Il paraît que c’est le printemps. Ce qui ne se voit pas existe-t-il vraiment ? Ce qui n’est pas pris dans mon regard a-t-il une corpulence de chair ? Où habite-t-il si ce n’est pas en moi ? Si je ne témoigne pas, si je n’atteste pas, si je ne nomme pas. Où va ce qui n’a pas de mots, de mains, de regards ? Moi, homme, serai-je si petit que rien n’a besoin de moi ? Moi, homme ? Il paraît que c’est le printemps. Enfermée dans ma chambre, c’est une idée saugrenue. Idée d’hier, d’ailleurs. Un égarement sans fin. Une chose qui cloche, une chose qui boite. Une chose bancale. Il suffit d’un mot dans mon agenda car mon corps ne sent plus les choses. Pour qu’elles existent, il faut que quelqu’un me les dise. Alors j’écoute ce qui s’écrit dans mon agenda. Ah ! Aujourd’hui c’est le printemps ! C’est marqué ! Il paraît que c’est le printemps. Moi, homme, serait-je si grand que tout est en moi ? Le printemps, il est dedans. Il est quand le cœur bat. Entends-tu la chanson de ton cœur ? Il est, quand, sur la langue, naissent des mots-fleurs, des mots d’amour, des tendresses folles, des chuchotements pour des enfants fatigués. Il est quand ça respire, quand ça sent les odeurs de cuisine, quand ça rit, quand un amour énorme comprend le monde entier. Il paraît que c’est le printemps, dedans.
Je me souviens. Je vais me promener le long de rivières claires. Le bruit de l’eau. Cailloux profonds faits de mille couleurs. Je suis toute petite et je ne me lasse pas de regarder ce qui coule, glisse, miroite. Ce qui passe sans moi. Le brin d’herbe et son vent malicieux. La libellule bleue posée sur un rocher. Les feuilles mortes tombées au fond. Le sable et la terre mêlés dans lesquels s’enfoncent les pieds. La lumière et l’ombre. Les arbres qui mouillent leurs racines. Les cigales chantent et les oiseaux. Poissons légers, transparents, que l’on tente d’attraper avec une épuisette. Maman crie qu’il faut rentrer. Je laisse mes yeux dans la rivière. Je les retrouverai demain.
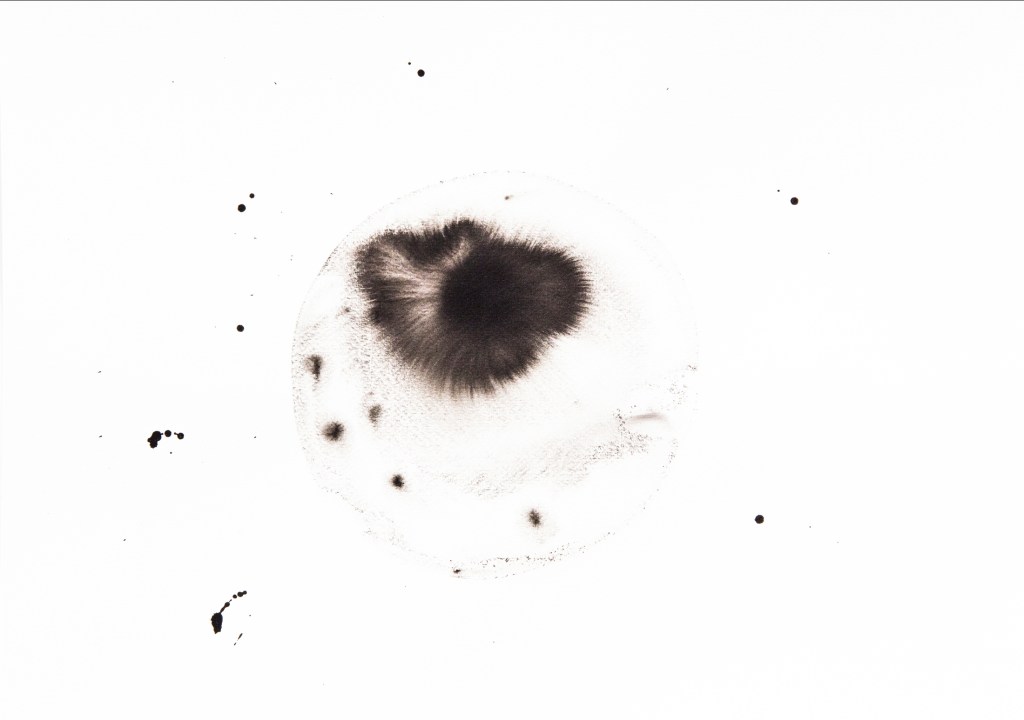
Confinement Covid-19 / 19 mars 2020
Jour 3
La nuit, j’écris. Des mots dérangent le silence. Où sont les vivants ? Dorment-ils ? Dorment-ils pour oublier ce qu’ils habitent ? Rêvent-ils de chevaux galopant dans des prairies ? Rêvent-ils de voir loin et longtemps se dessiner la mer ? Vont-ils parcourir des pays, paysages de sable entraperçus ? Des pays de pays où les frontières s’effacent. Où l’on peut courir vite. Où libre est le vent. Où la terre se balade. Pays de poissons. Pays de fougères au creux d’une rivière d’ombre. Pays perdus derrière les choses interdites.
Ne pas sortir, ne pas parler aux gens, ne pas embrasser, ne pas tenir dans sa main, ne pas s’approcher, ne pas marcher dans les rues, ne pas tousser, ne pas toucher, ne pas respirer. Comment rester vivant ? Comment tenir son corps debout quand le monde a déserté notre bouche ? Ne pas travailler, ne pas se promener, ne pas voir ses enfants, ne pas conduire sa voiture, ne pas aller à l’école, ne pas faire les magasins, ne pas aller au cinéma. Se cacher d’une toute petite chose invisible pour pas qu’elle nous attrape, pour pas qu’on l’attrape. Une chose qu’on ne peut pas voir, toucher, sentir, entendre. Se cacher d’une toute petite chose. S’enfermer dans sa maison. Se taire, se terrer. Territoire disparu et nous dedans. Se taire, se terrer. Territoire apparu qui est dedans. Est-ce si sûr. Est-ce si vrai cette chose en nous qui nous fait nous ? Est-ce si… nous ?
Jour blanc. Le possible du chemin. Jour blanc comme une page, une attente incertaine. Comme une promesse si près de la nuit. L’éblouissement d’une clarté. Les choses fugaces que nous savons saisir. Ce qui vole dans une lumière soudaine. Ce qui s’invite à notre fenêtre. Le mouvement d’une nuque. Ce qui craque sous nos pas. Surprise de l’instant. La saveur d’un fruit croqué une seule fois. Jour blanc. Le chemin du possible.
J’ouvre ma fenêtre. Un oiseau m’appelle, me tend les bras, me tend le cœur. D’autres oiseaux, des milliers d’oiseaux ont ouvert la porte du monde. Qu’est ce temps suspendu aux branches des hommes ? Qu’est ce temps suspendu pour tout ce qui ne s’est pas arrêté ? J’entends la voix des rivières si si loin. J’entends le murmure des pierres quand elles grandissent. J’écoute le ventre de la montagne et ce qu’il a à me dire. Là-bas vit une beauté. Là-bas naît la chevelure des langues. Quels mots pour tenir le réel dans sa main ? Quels chants faut-il danser pour embrasser l’instant ?
On nous a dit de ne pas marcher, courir, parler, embrasser, ouvrir sa porte, conduire sa voiture, inviter des amis, sortir, rencontrer, serrer des mains, se promener, danser dans la rue, nourrir les chats, prendre le bus, boire un café en terrasse, aller chercher ses enfants à l’école, acheter des chaussures, voir un film au cinéma, faire le marché, prendre son cours de yoga, jouer à cache cache, organiser un pique-nique, aller au spectacle, emmener ses enfants au cours de danse, toucher les gens et les embrasser en même temps, partir en vacances…
On nous a dit.
On nous a dit de ne pas.
On ne nous a pas dit de.
On ne nous a pas dit de lire, pousser les meubles du salon pour faire du sport, regarder un film en famille, téléphoner aux copains, faire un gâteau, ranger sa maison, trier tous les documents qu’on doit trier depuis 6 mois, aimer les bruits de voisinage, respirer, écouter les sons du monde, ne pas se maquiller, faire du yoga, ne pas se laver pendant 3 jours, s’allonger, ouvrir la fenêtre pour entendre les oiseaux, méditer, prendre du temps pour soi, penser à ce qu’on fera après, vider ses réserves de nourriture, écrire, faire des masques du visage, rire, revenir à l’essentiel, écouter le silence, cirer toutes ses chaussures, soutenir les gens qui sont seuls, manger des pâtes et du riz mais pas que, faire des économies, désemplir sa maison, s’émouvoir, parler avec ses enfants, se demander qui on est, fabriquer ses cosmétiques bios, peindre, prendre le temps de manger, aimer les bruits du monde parce qu’ils nous font penser aux humains qui sont tout près, écouter le silence, devenir philosophe, ne pas mettre de réveil, prendre du recul, se demander comment on va faire après pour pas faire comme avant, remercier les gens qui s’occupent des poubelles, retrouver de l’intériorité, partager ce qu’on vit avec les gens qui vivent la même chose, rire encore, dormir, dormir, dormir, aimer le chien qui aboie tous les jours, penser à tous ceux que cette situation va mettre en difficulté, vider ses réserves de produits d’hygiène, penser aux vacances, être soi-même en plus vrai.
Confinement Covid-19 / 18 mars 2020
Jour 2
Quel jour sommes-nous ? Serions-nous un jour, une heure, une minute ? Serions-nous un gramme de lumière ? Une étendue d’herbe, le bleu du ciel. Nous sommes mercredi et il fait beau. J’écoute le bruit des voisins qui devient un bruit d’humanité. Le monde se goûte autrement, tout autrement. Le son des cuisines me dit qu’il existe d’autres autres comme moi. Des gens dans des maisons des appartements des chambres. L’eau coule. La vie continue en petites portions. La fenêtre chuchote. Des arbres qui grandissent à vue d’œil. Le printemps en cachette égrène ses clochettes. Je ne suis pas invitée à cette fête ou loin ou pas maintenant. L’herbe existe sans moi et ce qui chante sous mon balcon. J’écris pour vivre encore, pour un sens, une respiration. Pour quelque chose de plus grand que nous avions oublié.
Dehors chante et siffle. Dehors est complètement lui-même. La rivière coule. Le vent s’aventure en haut des arbres. L’écureuil farandole sa pelisse. S’arrête, repart. Reviendra demain sur la branche bleue. À 14h40. Nous avons rendez-vous. La liberté des chats est une offrande. Mon temps arrêté me donne des yeux et des sourires. La brume est partie vivre ailleurs. Ce qui est là est tout là. Et je vois et j’entends. Présence multiple. Le monde fourmille de glissements et de chuchotements de nuits. Je ne dors plus. Je flambe et flambe la vie des pies, la feuille grandie éclose au goût de pain. Je flambe et flambe ce qui brille ignoré au cœur de l’invisible.
J’attends seulement les mots qui viennent manger dans ma main. La cuisine chante. Est-ce une enfant attentive à son gâteau ? La cuisine chante. Est-ce celle qui prépare les choses douces de ventre ? Des odeurs dansent et nous savons que quelque chose s’offre. Quelque chose de chaud, de plusieurs et de temps. Quelqu’un chante dans la cuisine. Quelqu’un sait le goût des mains dans la farine. Le miracle des heures dans la bouche du printemps. Quelqu’un sait ce qu’il faut de patience pour que les hommes rassemblent leurs cœurs. Une table, un bruit de lampe et l’assiette miroitante des jours meilleurs. Quelqu’un chante dans la cuisine. Est-ce l’ombre de nous-même ? Celle d’hier, d’hier encore et du jour d’avant ? Le fantôme de nous. Et pourtant, la cloche du repas a sonné. Les chaises sont prêtes. Et les yeux sont ouverts sur d’autres yeux. Sourire du moment.
Confinement Covid-19 / 17 mars 2020
Jour 1
Nous avions encore le goût des jardins. Les mains du vent dans nos cheveux. Nous avions les traces faites par nos pas sur la Terre, les traces du jour, les traces des nuits. Nous avions des corps faits d’écumes et d’horizons. Les yeux défaits de l’espoir. Nous dormions dans des lits doux, chauds. Dans des bras de tissus. Et tout restait. Tout pouvait se retrouver sous la langue du temps. Ce que nous avions traversé, ce qui nous avait traversé. Le monde avait empreinté nos corps et personne ne pouvait nous l’enlever. Ni le temps, ni l’enfermement, ni la tristesse. Nous étions nous en entier. Un autre monde à explorer avec ses respirations, ses silences, ses yeux fermés. Un autre monde, un autre nous. Une autre chanson à fredonner à ceux que nous aimions.
Une maison. Des portes, des fenêtres, des couloirs de jardins. Des choses enroulées que nous ne rencontrions pas quand dehors prenait toute la place. Des interstices de silence et le temps qui passe à peine car il habite là. Des minutes bleues et des oiseaux à travers le ciel, le ciel de nos pensées. Des fuites majestueuses. Et puis encore des portes et encore des fenêtres. Et puis des horizons blonds. Nous voyageons dans un pays intérieur. Une plaine robuste, multicolore et vive. Là, les rires. Ceux d’hier et ceux que nous n’avons pas encore dits. Les rires de bientôt quand nous découvrirons le monde à nouveau et que nous porterons les blés de notre vie.
La nuit, je rêve d’un printemps qui s’éblouit sans moi. De mains posées aux frontières du sommeil. Je vois les fleurs de lune boire la terre et aller. Je vois chaque arbre et sa vie envolée. La nuit, je rêve et tout ailleurs vit. Je reviendrai en mai dans un monde sans attente. Le vent aura coulé, et l’eau et le soleil. Des choses fragiles auront construit leurs nids. Des chants nouveaux et des prairies fertiles. La sève n’a pas besoin de moi. Ce que le temps connaît a la saveur des jours. La nuit, je rêve. Et je construis mon nid, des chants nouveaux et des prairies fertiles.
Qui sommes-nous ? Qu’avons-nous oublié ou perdu ou abandonné ? Le temps s’est arrêté et tout est possible. Où est ce tout empoussiéré, inhabité. Vêtement que nous ne portons plus. Comment naître son propre flambeau ? Comment rencontrer nos membranes sous la peau ? Je quitte le monde d’ici pour un lointain proche. Ce qui est toujours là, méconnu, ignoré. Qui sommes-nous dans les plis du sourire ? Qui suis-je ? Qui parle quand tout s’arrête et se déprend ?

Présentation de mon activité de médiatrice arts, écriture et spiritualité
à des créateurs d’entreprises à l’After Ateliers le 20 janvier 2020 :
les témoignages…
Merci de m’avoir permis de présenter mon activité. Un créneau de 2h, c’est précieux et ça permet d’approfondir son propos et de tirer profit des retours des personnes présentes. J’ai pris le temps de préparer mon intervention car je souhaitais qu’elle soit vivante. Je souhaitais également vous faire éprouver, par la lecture de mes textes, l’espace émotionnel avec lequel je travaille. Merci encore pour votre présence chaleureuse, un vrai soutien !
J’étais venue comme spectatrice, curieuse d’en connaître davantage bien sûr, mais un brin sceptique sur la capacité du thème abordé à piquer d’intérêt son auditoire. Pas simple de s’accorder un peu de temps dans des plannings très chargés, pour entendre parler d’art, d’écriture et de spiritualité… Eh bien, ce moment m’a remplie d’énormément de gratitude et d’énergie. Rozenn nous a embarqué dans son passé, son présent et son futur usant de témoignages, d’anecdotes et sa foi en l’être humain… avec une telle authenticité et une telle profondeur qu’elle nous montre le chemin. Comme elle le cite : « On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux ! » (A. de Saint-Exupéry). Ces rencontres riches de belles émotions nous aident à prendre conscience et avancer vers ce qui nous rend heureux et donc à réussir. Merci Rozenn ! *******************
J’ai été très attentive lors de la description de ton parcours professionnel et ta manière d’aborder ton métier. Tu sais captiver ton public et l’accrocher. Je ou on pourrait t’écouter pendant des heures, riche de savoirs, de poésie. J’ai eu envie d’apprendre et me laisser guider par tes mots et tes intuitions humaines. Un grand moment d’émotions. *******************
Nous avons eu la chance, le privilège (tous les participants en ont témoigné) d’écouter Rozenn GUILCHER nous présenter son activité de médiatrice arts-écriture-spiritualité. Pour ce faire, elle nous a d’abord exposé son parcours. Car sa pratique spécifique en découle. En effet, j’ai ressenti une cohérence, une grande pertinence dans ce parcours singulier d’animatrice, enseignante, éducatrice en parallèle avec tantôt des études et tantôt l’activité d’écrivaine. Ce qui émane de sa présentation, à la fois dans le ton, les mots, ses expressions ou ses silences, c’est tout d’abord une grande sensibilité, une ÉNORME sensibilité, par laquelle chaque participant a été touché. Ses préoccupations sont au-delà des conventions, normes, usages et prescriptions, pour aller vers l’unicité et l’humanité de ses « clients », « élèves », « patients ? », se mettre au service de l’âme de chacun. Bien que nous la côtoyions depuis 2 ans (avec un grand plaisir déjà), nous avons découvert une dimension plus profonde de son être. En l’écoutant, chacun de nous – je pense – a ressenti le désir d’être « accompagné » par cette belle personne qui semble pouvoir nous conduire vers un ailleurs meilleur. Un mot m’est venu à l’issue de la présentation de Rozenn : sérendipité. Elle serait pour moi une praticienne de la sérendipité ou bien un catalyseur de sérendipité. *******************
Merci à toi, Rozenn. Ça a été un vrai plaisir et une réelle émotion. Tu as le feu sacré en toi. Tu inventes quelque chose qui n’existe pas et tu nous ouvres la route et nous donnes du courage. *******************
Un vrai moment de grâce que la présentation de Rozenn lundi ! Nous sommes encore en petit comité, ce qui favorise les échanges : je peux vous confirmer que c’est précieux autant pour l’intervenant que pour l’auditoire. Ça donne un formidable élan… et l’envie d’avancer. Vivement notre prochaine rencontre ! *******************
Venez découvrir la profession de médiatrice arts, écriture et spiritualité !
Dans le cadre des After Ateliers (collectif de créateurs d’activités : http://www.after-ateliers.org), je vous présenterai le métier que j’ai inventé à partir de mon parcours atypique et de mes rencontres.
Une approche sensible de la personne et des accompagnements adaptés à chacun. Une pédagogie intuitive et plurielle qui s’adresse à tous ceux pour qui les méthodes traditionnelles formatées sont inefficaces.
Venez vivre un moment particulier où la poésie a toute sa place !

Il existe d’autres chemins pour se rapprocher de soi. Des chemins sensibles, artistiques, doux, profonds et poétiques. Des chemins pour dépasser nos blocages, nos empêchements et déployer notre plein potentiel.
Rendez-vous lundi 20 janvier 2020 de 9h 30 à 12h à la Maison de la Vie associative de Gardanne (près de la Halle – Avenue du 8 mai 1945).
Pour la gestion de la salle, vous devez vous inscrire gratuitement sur le site des After Ateliers en cliquant ici
Une année 2020
ronde, colorée, douce et sensible
à partager avec votre petite tribu !
Je vous laisse avec les mots de Ralph Waldo Emerson :
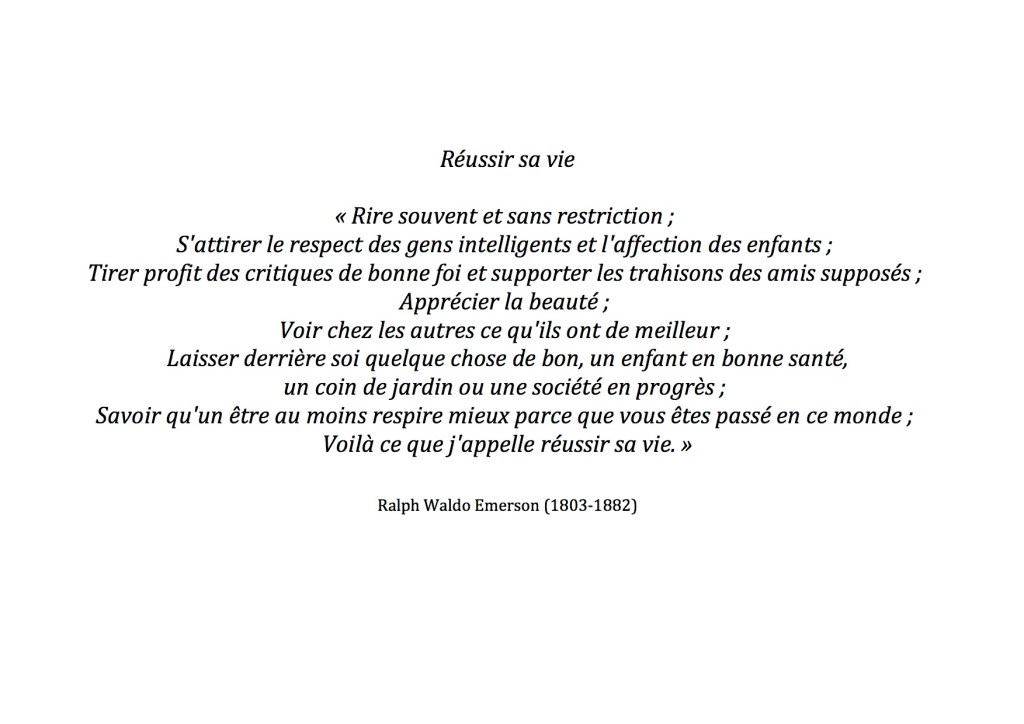

Il reste si peu de jours de 2019. Je vous les souhaite doux, lumineux et tendres. Comme ce texte écrit en massage poétique :
Courir, sauter, chanter des mots qu’on ne comprend pas.
Je savais des choses, avant, quand j’étais petite.
Je savais toutes les choses.
J’ai oublié le chemin des fourmis.
Où se cacher quand on est trop grand.
Garder nos robes, nos nounours, nos dînettes de boue.
S’attacher aux arbres comme des cheveux.
Écouter ce qui danse dans le vent.
Perdre ses dents.
Faire un collier de nos heures lointaines.
Monter sur le dos des miracles.
Chevaux, sirènes ou libellules.
Tout ce qui vole dans la lumière.
Partir avec le vent.
Nous avons rendez-vous.
Croquer des graines qui grandiront dans notre ventre.
Arbres centenaires.
Peuple migrateur qui s’enracine au cœur du silence.
J’ai perdu ce qui habite en moi.
Des clés ?
Des solitudes pointues et ensablées.
J’ai grandi sur la crinière du temps.
Quelque part où rester.
La citation du moment :
Nous allons chercher loin ce qui habite en nous.

Parce que je pense que l’écriture doit se voir, s’entendre, se rencontrer… Parce que je pense que la peinture peut se dire… Parce que la poésie prend corps dans les yeux des autres, au cœur du monde… Pour fabriquer cet espace poétique, je vous propose des lectures, des expositions, des ateliers d’écriture, des accompagnements personnalisés, des massages poétiques… Parce que l’être humain est avant tout un être de poésie. Quelques chemins pour nous rencontrer…
Actualités 2019
Ateliers d’écriture en collèges et lycée sur la création d’un livre numérique en novembre et décembre 2019
Organisés par La Marelle et Le Pôle (Pôle Jeune public de la Seyne sur mer) au lycée Langevin à La Seyne sur Mer, au collège Les Pins d’Alep à Toulon et au collège Saint-Joseph La Cordeille à Ollioules.
https://www.le-pole.fr/nouveaux-auteurs-nouveaux-lecteurs-lannee-pilote
Voici les liens pour les quatre livres numériques réalisés dans l’année scolaire 2018-2019 :
https://fenetres-sur-le-monde.la-marelle.org/#/carte
https://l-esprit-du-labyrinthe.la-marelle.org/#/
https://la-rumeur.la-marelle.org/#/
https://soiree-halloween.la-marelle.org
Fête de l’environnement au Loubatas, Peyrolles
28 septembre 2019 de 11h à 18h
« La forêt ferme les yeux. Le renard porte encore la touffeur de l’été. Cadeaux, cailloux qui roulent au bord des bouches. Vivre encore à l’horizon des racines. S’attendre au coin des arbres. Un chemin de fourmis. Une miette de temps coincée entre deux pages. Vivre sent l’herbe et la terre. Vivre a la forme d’un regard. J’attrape le rire des villes entre mes doigts. Dérouler les fougères du printemps une à une. Je dors dans la sève des forêts. Je ne dors pas. Mes cheveux sont partis avec les rivières ou avec les chevaux. Je n’en ai plus besoin. Je n’ai plus besoin de rien. Tout est là. Je respire le front des années. J’attrape les heures par la main. Et nous courons dans des champs de fleurs, de pleurs, de peurs. Nous traversons l’instant comme le vent. Nous y habitons. Nous sommes posés sur une goutte de pluie, un brin d’herbe, un pollen. Flottons à la surface de toute chose. Ici, maintenant, le poids du monde ».
Massages poétiques (https://www.massagepoetique.fr) et sieste sensorielle en extérieur avec l’association Le Voyage intérieur (www.levoyageinterieur.org/).


Festival Rêves de Cèdres, forêt de cèdres de Bonnieux.
Le 16 juin 2019 : massages poétiques (www.massagepoetique.fr) en extérieur avec l’association Le Voyage intérieur (www.levoyageinterieur.org/). Sieste musicale et massages avec l’association Le Voyage intérieur et Delphine Capron Duo (Delphine Capron et Pierre Lacube : http://delphinecapron.com).
Rozenn Guilcher proposera une écriture en direct pendant la sieste musicale et une lecture publique de son texte. Également l’exposition de tableaux et de textes de Rozenn Guilcher intitulée « Peuple-Forêt ».
Formation « Les rêves vivants »
Écriture et développement personnel auprès d’adultes porteurs de handicaps. En mars et avril 2019 à l’IRTS (Institut Régional du Travail Social).

Journée « Parentalité, soins maman-bébé »
Dans le cadre de la Quinzaine de la parentalité, à Aix en Provence le 26 mars 2019 : massages poétiques du lien (www.massagepoetique.fr) avec l’association Le Voyage intérieur (www.levoyageinterieur.org/). Massages poétiques maman-bébé et ateliers autour du livre et de la parentalité.
Ateliers d’écriture en collèges et lycée sur la création d’un livre numérique
Organisés par La Marelle et Le Pôle (Pôle Jeune public de la Seyne sur mer) au Collège Cousteau à La Garde, au collège Les Pins d’Alep à Toulon et au lycée professionnel Rouvière à Toulon. De janvier à mars 2019.
https://www.le-pole.fr/nouveaux-auteurs-nouveaux-lecteurs-lannee-pilote
Actualités 2018
Fête de l’environnement au Loubatas, Peyrolles

Le 29 septembre 2018 : massages poétiques (www.massagepoetique.fr) en extérieur avec l’association Le Voyage intérieur (www.levoyageinterieur.org/).
Les journées du Patrimoine à la Tuilerie Bossy à Gardanne
Samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre 2018 Expositions « Il est une forêt dans mes veines », photographies d’Emmanuel Curt et textes de moi. Rozenn Guilcher donnera des lectures de son texte à 12h, 15h30 et 17h.
Lecture-rencontre « Chant d’un pays de sable » sur l’exil
À la librairie-bar à vin Le Funiculaire à Marseille. Samedi 22 avril 2018 de 17h à 19h.
Exposition « Il est une forêt dans mes veines »
Photographies d’Emmanuel Curt et textes de Rozenn Guilcher. Bibliothèque Li Campaneto, Aix-Les Milles. Du samedi 17 mars au samedi 14 avril 2018. Rozenn Guilcher donnera une lecture de son texte lors du vernissage le samedi 17 mars 2018 à 17h

Festival Rêves de Cèdres, forêt de cèdres de Bonnieux. Le 17 juin 2018 : massages poétiques (massagepoetique.fr) en extérieur avec l’association Le Voyage intérieur (www.levoyageinterieur.org/).

